Une somme pas en rapport avec le travail fourni
La Pointe du Raz, haut lieu du tourisme en Finistère, classée grand site de France, attire depuis les années 1880 de nombreux touristes avides d’émotions fortes. En 1856, Michelet voyait la Pointe comme un site brumeux, légendaire, celtique et fantastique. En 1912, "Le Petit Journal" décrit la mousse ravageuse, la bave de colère formidable, cette vue sur le Raz de Sein avec son cap de pierres enchevêtrées, le phare de la Vieille qu’un souffle de l’ouragan semble vouloir coucher pour jamais, sans oublier l’Île de Sein qui apparaît au loin sur les flots bouleversés. Il faut aussi marcher jusqu’à la Baie des Trépassés qui devient sous de hurlantes rafales un paysage oublié par Dante aux profondeurs de l’enfer.
Vous resterez toujours admiratif face à cette puissance et à cette beauté, raconte aujourd’hui le dépliant de l’office du tourisme. La météo, le vent et les marées offrent tous les jours un spectacle différent.

- La Pointe du Raz et le phare de la Vieille
Lorsque la mer se lève, gronde, annonce une tempête, âmes fortes et mélancoliques, venez méditer en silence (Cambry. 1794) Aquarelle de Jean-Marie Misslen
Avant la Grande Guerre, la visite guidée coûte un franc et les archives ne disent rien sur le ressenti des touristes. Il faut attendre 1921 pour que, suite à de nombreuses plaintes relayées par la fédération des syndicats d’initiative de Bretagne, le préfet diligente une enquête. Le 30 septembre, deux gendarmes à pied à la résidence d’Audierne vont interroger onze guides. Tous, à commencer par André Normand, cultivateur et adjoint au maire de Plogoff, témoignent de leur bonne foi. Pour la visite qui dure selon les uns une journée entière, selon les autres de trois à cinq heures, il n’y a pas de tarif fixé et le client donne ce qu’il veut. Lorsque les gendarmes insistent, ils apprennent que généralement trois à cinq francs sont demandés par personne, plutôt cinq d’ailleurs.
Cela peut paraître peut-être cher pour voir des rochers, aussi beaux soient-ils. Mais ces guides sont le plus souvent des demi-soldiers, c’est-à-dire qu’anciens inscrits maritimes, ils perçoivent une maigre retraite, insuffisante pour nourrir une famille nombreuse. Ainsi, l’un d’entre eux, Clet Bloc’h, a sept enfants. D’autres sont cultivateurs ou marins de commerce. De plus, cette activité ne dure que de juillet à fin septembre.
Ils jurent tous qu’ils ne connaissent pas les noms des collègues indélicats qui exigeraient des tarifs exorbitants. Les tenancières des deux hôtels de la Pointe ne sont guère plus bavardes devant les gendarmes. L’une affirme pourtant que tous ses clients se plaignent des prix excessifs pratiqués par les guides, une somme qui n’est pas en rapport avec le travail fourni. Vous avez bien lu : tous ses clients.
Alors, Monsieur le Maire, qu’en dites-vous ? Henri Le Bloc’h, élu à cette fonction depuis 1919, ne souhaite surtout pas se fâcher avec ses électeurs qui habitent pour la plupart à Lescoff, village situé à deux pas de la Pointe. Selon lui, les guides ont une bonne conduite et ils sont tous bien considérés. Il rejoint cependant le souhait du préfet de constituer une association de guides qui, homologués par le Touring Club de France, porteraient un signe distinctif, comme une médaille ou un brassard.
Ils viennent chasser sur leurs terres
Le 27 mai 1922, dix guides écrivent au préfet. André Normand, cultivateur et adjoint au maire, prend la plume en tant que président de cette association informelle qui souhaite être reconnue. Les signataires pratiquent le métier depuis vingt ou trente ans et ils ne supportent plus la présence de tous ces marins qui, lorsque la mer est mauvaise, viennent chasser sur leurs terres. Les tarifs doivent être ainsi fixés : pour une excursion à la Pointe ou à la Baie des Trépassés : dix francs jusqu’à cinq personnes. De cinq à dix personnes, il sera demandé vingt francs.
Faute d’accord entre le préfet et le maire de Plogoff, de nombreux abus sont relevés pendant l’été 1925. Le rapport du capitaine Ruel de la gendarmerie de Quimper est alarmant. Les faux guides terrorisent les touristes, leur demandant vingt ou même quarante francs. Si des dames ne sont pas accompagnées par des messieurs, elles n’osent demander au guide de les laisser tranquilles et celui-ci va jusqu’à leur réclamer cent francs. Lorsque les gendarmes sont présents, les guides agréés ou pas sont doux comme des agneaux, mais redeviennent des bêtes féroces dès le départ de la maréchaussée.
N’oublions pas aussi les enfants qui, à l’arrivée des cars ou des voitures particulières, proposent en hurlant des fleurs ou des coquillages. N’est-ce pas une véritable mendicité déguisée et audacieuse qu’il est nécessaire de réprimer ?
Faute de réponse, Jules Talvard, pharmacien à Audierne et délégué du Touring Club, intervient auprès des guides. Une association mutuelle est créée et un arrêté municipal promulgué. Le port d’un brassard et la présentation d’une pièce d’identité seront obligatoires chez les guides sérieux qui devront se conformer à un prix d’excursion fixé chaque année. Le Touring Club applaudit, mais refuse de financer l’achat de brassards.
Les archives ne précisent pas qui finance lesdits brassards que les guides portent en mai 1926. Les premiers jours, cela pouvait aller, écrit André Normand à Jules Talvard. Ensuite, les gendarmes interviennent et dressent procès-verbal à quatre fortes têtes, encouragées par le garde maritime Kersaudy qui les excite et prêche la révolte. Il leur dit : employez tous les moyens, ne mollissez à aucun prix ; les brassards et les tarifs, c’est de la foutaise. Il affirme même que l’autorité maritime les soutient. Le résultat ne se fait pas attendre. Les plus âgés des guides se font insulter et leurs brassards sont déchirés, alors que les touristes sont plus que jamais bousculés.

- Photo de la Baie des Trépassés
- Signée Jean-Marie Misslen
Abus à la liberté du travail
Va-t-on assister à une guerre civile opposant une quinzaine de guides agréés et les marins-pêcheurs du village de Lescoff ? Jules Talvard, le pharmacien d’Audierne, doit regretter le calme de son officine. Insulté et menacé, qu’est-il venu faire dans cette galère au milieu de pêcheurs dans un état presque habituel d’ébriété ? À jeun, ceux-ci adressent une pétition au préfet. Signée par quatorze d’entre eux, elle demande la suppression de l’arrêté qui plonge les pères de famille les plus honnêtes dans une situation critique. Ils expliquent pratiquer actuellement la pêche au crabe. Les viviers sont pleins et aucun acheteur ne se présente. Alors, sans ressources, comment nourrir leurs nombreux enfants ? En colère, ils concluent : Avoir donné des brassards à quinze guides et avoir défendu aux marins de le faire occasionnellement est un abus à la liberté du travail et des citoyens.
Dans son rapport, le commissaire spécial, envoyé en mission par le préfet pour calmer les belligérants, estime que le choix des guides officiels est sujet à caution. Certains sont trop âgés, d’autres sont bien connus pour leur intempérance. Le sieur Normand, adjoint au maire, semble s’être laissé guider par des raisons de sympathie personnelle ou politique.
Après avoir mené une enquête auprès des habitants, le commissaire apprend que l’origine du conflit entre Normand et Kersaudy, le garde maritime qui prend la défense des pêcheurs, remonte à quelques années. Normand, boulanger, épicier, débitant et guide, s’est vu refuser une pension d’invalidité de la marine après un rapport de Kersaudy, demandant la radiation de deux années de navigation de son ennemi intime.
L’envoyé du préfet estime avoir réussi à ramener le calme dans la population de la Pointe. Il préconise de porter le nombre de guides à trente et de nommer aux postes ainsi créés des marins- pêcheurs chargés de famille comme Clet Carval, père de dix-sept enfants. Ainsi que ses collègues, il traverse une période difficile, le kilo de langouste ayant chuté de trente-six à quatorze francs.
Il invite aussi les gendarmes d’Audierne, chargés de la surveillance de cette région difficile en raison de son éloignement, à faire respecter l’arrêté municipal plutôt qu’à exercer une répression trop active.

- Guides et touristes à la Pointe du Raz
- Détail d’une photo de Roger Viollet
Source : "Cap Sizun". Serge Duigou et Jean-Michel Le Boulanger
Sur ces bonnes recommandations et content de sa médiation, le commissaire spécial quitte la Pointe. Il doit y revenir quelques jours plus tard, après une rixe entre Normand, le chef des guides, et Clet Carval. Le premier a frappé l’autre à l’aide d’un instrument en fer, risquant ainsi de laisser dix-sept orphelins de père. L’affaire prend un tour politique avec l’entrée en scène de Jean Jadé, conseiller général du canton et député, l’un des fondateurs du mouvement démocrate populaire, un parti centriste.
Également avocat, il conteste la légalité de l’arrêté pris par Henri Le Bloc’h, maire de Plogoff et soutien de Georges Le Bail, député radical-socialiste. Le sieur Marzin, démocrate, vice-président du syndicat agricole local, monte aussi les pêcheurs contre le fait de demander un poste de guide officiel. Méfiez-vous, leur dit-il, l’inscription maritime se tournera contre vous et vous supprimera des mois de navigation. C’est faux, rétorque le commissaire : S’ils prennent la mer au moins dix jours par mois, ils peuvent être guides pendant les vingt autres jours.
Devant le juge de paix de Douarnenez, Me Jadé défend quatre pêcheurs qui ont enfreint les dispositions de l’arrêté. Selon le juge, le maire de Plogoff n’a pas justifié suffisamment les mesures prises. Il aurait dû argumenter du fait de la dangerosité du site pour ne choisir que des guides expérimentés. Néanmoins, le magistrat, après avis du préfet, déclare l’arrêté légal et prononce des condamnations légères contre les quatre contrevenants.
Sans doute trop légères, car les troubles continuent et les lettres de réclamations s’accumulent sur le bureau du préfet. Un haut gradé de l’état-major parisien prend sa plus belle plume pour exprimer son indignation. En visite sur le site en compagnie de neuf autres touristes, chacun a dû payer en fin de visite dix francs à un guide agréé portant le brassard N° 2.
Ils ne flanquent le coup de fusil qu’après
En juillet 1927, un touriste qui préfère garder l’anonymat raconte sa visite à la Pointe. A l’approche du site, le car est arrêté pour permettre de monter à deux individus porteurs de vagues brassards avec numéro. Ils proposent de faire les guides, comme il est d’usage, disent-ils. Tout le monde accepte et, après la visite de la Baie des Trépassés et un repas dans un restaurant recommandé par les guides, les estivants poursuivent la randonnée qui dure deux heures. C’est ici que se place le point délicat. Pour récompenser les deux hommes, chacun allonge généreusement cinq francs. Que nenni ! Ces messieurs réclament le double et cette promenade leur rapporte ainsi deux cents francs. Comme ils se sont bien gardés d’indiquer leur tarif avant, ils ne flanquent le coup de fusil qu’après. Le touriste anonyme poursuit : Par amour- propre, personne n’a protesté, mais j’ai entendu dans le car plusieurs récriminations. Ces individus jeunes et vigoureux pourraient gagner honnêtement leur vie en pratiquant la pêche par exemple.
C’est ce qu’ils font le reste de l’année, mais il est si facile l’été de gagner sa vie en plumant les visiteurs !
De tels témoignages sont monnaie courante et viennent même d’Espagne. En 1929, Jean Jadé, le député blanc, s’en prend de nouveau au maire rouge. Selon lui, pour désigner des guides, l’édile de Plogoff a toujours privilégié ses relations et les membres de son conseil municipal, comme André Normand, son adjoint. Celui-ci, quand il ne propose pas la visite du site, tient un débit de boissons, fréquenté trop assidûment par certains gendarmes qui, avant de dresser procès-verbal, s’enquièrent de savoir si le guide en infraction est un ami du maire ou non.
Ledit maire a du caractère et, n’aimant sans doute pas que l’État s’occupe de ses affaires, il répond souvent sèchement au préfet. Il dit qu’il n’a rien à gagner et que c’est toujours lui qui écope. D’ailleurs, ajoute-t-il, la commune ne retire aucun avantage de la saison touristique, les commerçants et les hôteliers étant étrangers à la commune, à une seule exception.
Une sorte de soviet
Comme l’affaire n’en finit pas et que j’ai pitié de vous, ami lecteur, je vais abréger ce récit, d’autant qu’en 1938, la situation ne s’améliore guère. Ainsi, certains guides (agréés ou pas ?) menacent de crever les pneus des cars si le chauffeur ne les laisse pas monter pour proposer leurs services. Rares sont les conducteurs qui mettent en garde les touristes contre ces guides qui constituent une sorte de soviet et qui horripilent la fédération des syndicats d’initiative de Bretagne.
Depuis 1929, le département est devenu propriétaire de la Pointe du Raz. À la date où se termine ce récit, il n’est pas venu à bout des abus qui vont sans doute se prolonger encore longtemps. Mais bientôt et, pendant quatre longues années, les guides doivent laisser les lieux à des touristes d’un nouveau genre qui, avec leurs installations défensives, vont dénaturer pour un temps ce site magnifique.
Pour les en chasser, les guides agréés ou non, ennemis d’hier, vont unir leurs forces dans le Cap Sizun, haut lieu de la France résistante et combattante.

- Affiche publicitaire. 1930
Source : Archives départementales du Finistère 8 M 106 et presse ancienne.
Remerciements à Jean-Marie Misslen, Annick et Yvon Le Douget et Michel Guironnet
BLOG gratuit et sans pub : https://www.lesarchivesnousracontent.fr/
Tous les quinze jours un article court historique.













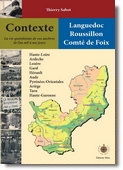


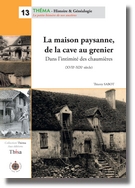


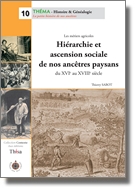


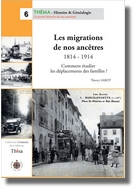



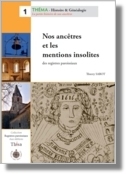


 À la Pointe du Raz, des éléments et des hommes déchaînés
À la Pointe du Raz, des éléments et des hommes déchaînés