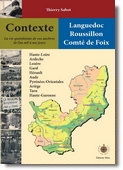Le 20 mars 1861, le baron Richard, préfet du Finistère, publie un arrêté qui, à compter du 1er mai, remplace le tour [1] de l’hospice de Quimper par un bureau d’admission. Malgré l’opposition du Conseil général et des notables de la Commission hospitalière qui craignent que cette mesure lourde de conséquences n’entraine un accroissement des infanticides, le représentant de l’État juge que la situation est devenue intenable.
En 1860, cent dix enfants de père et mère inconnus ont été exposés (déposés) dans le tour de l’hospice civil situé sur une hauteur de la ville de Quimper, appelée Creac’h-Euzen. L’entretien de tous ces enfants obère les finances publiques et de nombreuses villes ont déjà fermé leur tour [2].

- Hospice civil de Quimper, ancien grand séminaire avant la Révolution, puis hôpital militaire jusqu’en 1801.
À Quimper, l’hospice civil croule sous les dettes et doit vendre un par un ses biens affermés dans quelques communes. Les vieux lits vermoulus du dortoir des garçons ne sont pas encore remplacés par des lits en fer et, malgré les efforts des dames blanches de la communauté du Saint-Esprit, les enfants doivent dormir sur des matelas durs et infects dont un usage perpétuel a pourri la laine. Soixante-dix garcons et filles sont encore pensionnaires à Creac’h-Euzen, malgré les appels à l’aide du préfet à tous les maires :
On trouvera dans les hospices des filles saines et bien constituées et des garçons adultes qui, quoique d’une faible constitution, peuvent rendre des services à l’agriculture. Les filles sont singulièrement propres au travail manuel, au travail des champs.
Mais les paysans et les artisans sont peu enclins à prendre en charge ces enfants souvent infirmes ou au tempérament rebelle et insoumis. Les garçons trompent leur ennui en travaillant dans la ferme de l’hospice pendant que les filles sont employées à des travaux de couture et aux cuisines.
Le 24 avril 1861, un garçon agé d’environ dix jours est le dernier enfant trouvé, exposé au tour de l’hospice de Quimper. Avant qu’il ne parte chez des parents nourriciers, le patronyme de Léon-Marie Tazu [3] lui est attribué.

À compter du 1er mai, l’anonymat est désormais interdit et la mère, qui souhaite abandonner son enfant, doit expliquer les raisons de son geste. Palud, inspecteur des enfants assistés, en phase avec le Pouvoir, juge qu’il est préférable d’octroyer à la mère un secours temporaire de 6 francs par mois pendant trois ans pour élever son enfant. L’État fera des économies substantielles [4] et les chances de survie seront augmentées.
Les opposants argumentent que ce n’est pas avec cette aumône ridicule que la mère repentante et le plus souvent seule pourra s’occuper dignement de son enfant. La fille-mère préfére confier le fruit de sa chair à l’hospice qui lui offre un toit et des repas quotidiens. Malgré les directives préfectorales, elle obtient facilement de la part du maire de sa commune un certificat d’indigence, et l’enfant vient grossir le nombre des enfants mis en nourrice dans près de soixante communes de Cornouaille.
L’inspecteur constate avec regret que dans ce département l’on répugne aux idées nouvelles et qu’il faut ménager les préjugés du pays.
Peu à peu cependant, le nombre d’enfants admis à l’hospice diminue tandis que les secours temporaires augmentent au grand dam des bien-pensants qui jugent qu’il est choquant d’octroyer de l’argent à la fille-mère qui accepte d’élever son enfant alors que la femme honnête ne profite d’aucune aide pour s’occuper de son enfant légitime.
En 1872, le département doit donner asile à neuf enfants et sur les quatre premiers mois de 1873, onze petits sont déjà secourus. L’inspecteur écrit au préfet qu’il est temps de prendre des mesures devant une telle contagion qui scandalise les populations honnêtes des campagnes.
En 1874, Théophile Roussel, médecin, député et président de la Société protectrice de l’enfance, est l’initiateur d’une loi qui réglemente enfin "l’industrie nourricière". Les enfants assistés ont désormais droit à tous les égards et ceux qui étaient rejetés il y a peu sont mieux protégés que les enfants légitimes. En ménageant la santé de ces bâtards, la Troisième République espère compenser la baisse de la natalité et puiser plus tard dans le vivier de ces jeunes qui serviront les intérêts de l’État, en remerciement de tous les bienfaits qui leur auront été prodigués.
En 1889, l’admission à l’hospice est devenu une exception, le secours accordé aux femmes qui gardent leur enfant étant devenu la règle. Et pourtant,cette année-là, des enfants sont encore abandonnés dans les rues de Quimper ou d’ailleurs.
L’histoire qui suit en est la preuve :
François Gilier, contremaître de l’usine à gaz, est de service dans la nuit du 25 au 26 mai 1889. En compagnie d’un employé, il doit s’assurer du bon fonctionnement des becs d’éclairage installés dans les rues de Quimper. Il est un peu plus de deux heures et demie, lorsque, rue du Chapeau Rouge, à deux pas de l’école communale, Gilier est intrigué par le manège d’un homme qui s’approche avec un paquet encombrant qu’il pose précipitamment sur le trottoir avant d’aller se cacher quelques mètres plus loin.
Le contremaître et son second accourent et découvrent, recroquevillé dans un panier à poissons, un garçonnet d’environ deux ans qui, entre deux sanglots, ânonne quelques mots en breton. Gilier tente en vain d’extraire du panier le gamin qui semble n’avoir aucune force dans les jambes, car il retombe lourdement. Les sabots qu’il a aux pieds sont aussi beaucoup trop petits pour lui.
L’homme apporte le précieux colis à son épouse qui constate l’état de grande saleté de l’enfant. La paille sur laquelle il est couché est souillée et, malgré les deux gâteaux qui se trouvent dans le panier, le petit, affamé, dévore la bouillie préparée par madame Gilier. Un billet attaché à sa chemise porte l’indication : Henri= G Batisé 2 Ans.

- Billet trouvé sur l’enfant
À l’hospice où l’enfant est conduit, le médecin examine le petit Henri avant l’arrivée au petit jour du commissaire de police. En breton, l’enfant raconte qu’il couche habituellement dans ce panier et que sa mère le battait souvent. Comme sa mise paraît indiquer qu’il vient de Douarnenez ou des environs, les recherches s’orientent vers ce secteur.
Quelle est l’origine des deux gâteaux qui, par leur forme et leur texture, peuvent venir du pays de Douarnenez, du Cap-Sizun ou de Pont-L’Abbé ? Dès le 29 mai, la police découvre qu’ils sont fabriqués à Pont-Croix par Jean Jézéquel, qui les place en dépôt dans de nombreuses épiceries. Des revendeuses sont interrogées, comme Marguerite Quéré, veuve Cabellic, marchande de gâteaux à Poullan, mais aucune ne peut fournir aux enquêteurs la liste des acheteurs.
L’affaire commence à prendre corps, lorsque le maréchal des logis Hamayon, gendarme à cheval à la résidence de Pont-Croix, apprend qu’un enfant, dont la mère est morte il y a peu, a disparu de la commune de Meilars. En effet, Anne-Marie Pavec, domestique à Meilars, est décédée le 25 mars 1889. Née de père et mère inconnus, elle a été exposée le 29 novembre 1857 au tour de l’hospice de Quimper où il lui a été attribué le patronyme de Paver [5]. Mariée à Guillaume Gloaguen, elle vivait séparée de cet homme, domestique à Cléden-Cap-Sizun, peu recommandable sous tous les rapports et qui passe pour être un peu toqué.
L’homme ne s’est jamais occupé de ce fils que la mère élève tant bien que mal avec le secours des voisins. À la mort d’Anne-Marie, Gloaguen vend le petit mobilier et laisse l’enfant à la charge des époux Ollier, cultivateurs à Kerhoanton en Meilars. Comme il refuse de reprendre l’enfant au bout d’un mois et qu’il ne paie pas de pension aux époux Ollier, ceux-ci conduisent le petit garçon chez son oncle Daniel Gloaguen, charron au hameau de Keridreuff en Plouhinec.
Veuf depuis peu, l’homme ne sait que faire de ce fardeau et il le confie provisoirement à Jean-Guillaume Brénéol, parent éloigné qui habite au village de Kéréval en Plouhinec. Daniel Gloaguen a fait une demande d’admission à l’hospice, mais comme la réponse se fait attendre, il décide d’abandonner l’enfant dans une rue de Quimper. Pour la somme de dix francs, payable quand il aura fait la besogne, le nommé Marc-Dominique Guyader, chiffonnier de son état, accepte la sinistre mission après avoir obtenu deux francs supplémentaires pour le déplacement. Le lundi 25 mai, il quitte Plouhinec vers onze heures du soir après que Gloaguen lui a recommandé de déposer le garçonnet sur un trottoir afin qu’il ne lui soit fait aucun mal.
Arrivé vers deux heures et demie du matin à Quimper, Guyader laisse son char à bancs route de Douarnenez, dépose le panier et l’enfant qui pleure dans la première rue venue. Puis, il va voir si son cheval est toujours bien attaché, revient sur le lieu de son forfait et s’embusque près de la maison David, rue du Chapeau-Rouge, d’où il surveille le panier jusqu’à ce que deux individus s’en approchent.
La police n’a aucun mal à faire avouer les deux coupables. Le père de l’enfant n’est pas inquiété, car l’enquête établit qu’il n’a pris aucune part dans l’abandon. Le 13 juin 1889, pour avoir exposé et délaissé un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, les sieurs Gloaguen et Guyader, cupides et à peu près illettrés au dire des témoins, sont condamnés à trois mois de prison, et le premier écope en plus de deux cents francs d’amende.
Henri Gloaguen, deux ans et demi, enfant assisté, après avoir été enregistré sous le patronyme d’Henri Philippe, va suivre le même parcours que sa mère, enfant trouvée, exposée à l’hospice trente-deux ans plus tôt. Les appellations changent, mais le mal est bien loin d’être éradiqué.
Cet article est écrit d’après quelques passages de mon livre :
Les exposés de Crea’ch-Euzen - Les enfants trouvés de l’hospice de Quimper au XIXe siècle.
Tous les détails : préfaces, introduction, carte des communes nourricières sur le site de l’auteur : http://www.chuto.fr/