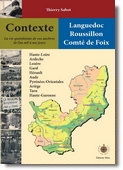Chapitre IV
La nuit, inutile de la décrire, ne fut pas des plus enchanteresses.
La tête sur mon sac à dos, de crainte des vols, j’eus bien du mal à dormir quelques heures.
C’est le lendemain, à neuf heures, que nous fûmes rassemblés à nouveau dans la cour, embarqués dans des camions militaires munis de bancs de bois, ignorant tout de notre destination finale.
J’avais, en si peu de temps, fait plus ample connaissance avec Gérard, un garçon de mon âge, classe 44, qui occupait la paillasse sous la mienne.
Gérard avait été ramassé l’avant-veille, dans une rafle, à la sortie d’un cinéma de Pontoise. Comme moi, il était réfractaire au STO, s’y étant soustrait alors qu’il était tourneur chez S.K.F., à Ivry. Il était « planqué », lui aussi, dans une ferme d’Epluches, la banlieue de Pontoise.
Très rapidement, nous avons sympathisé, et nous nous sommes promis de rester ensemble dans la mesure du possible.
Hormis un fritz en armes dans chaque camion, nous étions escortés de deux miliciens, très jeunes, que nous découvrions pour la première fois (en effet, la milice fut créée début 1943, et n’était armée alors que de la baïonnette allemande, pas d’arme à feu).
N.14, direction Paris, traversée de la capitale, et nous voici à la gare d’Austerlitz, dans laquelle nous pénétrons par les accès aux voies de triage.
Les pourtours de la gare, les quais, les abords et les rues y conduisant fourmillaient de boches, de GMR, de simples gardiens de la paix et de flics en civils.
- « Je crois qu’ils ont les « jetons » des « manifs », me souffla Gérard, et ils craignent que l’on se tire.
- Se tirer, se tirer, tu es bien gentil, nous n’avons plus de papiers, nous ne ferions pas cent mètres en liberté.!
Le comité d’accueil, sur le quai, était aussi fourni que l’environnement, et nous voici rapidement embarqués dans des wagons de voyageurs, qui ne nous permettent aucunement de déceler quelle sera notre destination prochaine. Partir en Allemagne, par la gare d’Austerlitz, nous semblait bien bizarre. Encore que, à cette époque !?
Solidement gardés, à chaque bout de wagon par un « frisé » portant mitraillette en sautoir et quelques miliciens dans chaque couloir, très vite le convoi démarrait, et nous voyions défiler la banlieue sud, que Gérard connaissait mieux que moi.
C’est seulement en fin d’après-midi, que nous commençâmes à nous rassurer à demi ; incontestablement, l’entrée en gare de Fleury-les-Aubrais, que nous venions d’atteindre après plusieurs haltes en rase campagne, nous permettait de penser qu’effectivement nous n’étions pas dirigés vers l’est.
Il nous avait été distribué un quignon de pain noir allemand, et un morceau d’une saucisse qui, apparemment n’avait vu le porc que de très loin.
Aux rares arrêts dans une gare, les miliciens descendaient sur le quai remplir au robinet des bouteillons d’eau, mis ensuite à notre disposition pour nous désaltérer.
Plus nous descendions vers le sud et plus lente était la marche du convoi, nous évitions les grandes villes.
Nous mîmes deux jours et deux nuits pour atteindre Bayonne, car c’est là que se situait notre terminus.
- « Je crois bien que nous allons rester en France, me dit Gérard, il y a de grandes chances pour qu’ils nous emploient aux travaux du « mur de l’Atlantique ».
En effet, craignant un débarquement allié jusque dans cette région côtière, les occupants avaient décidé de précipiter la construction de défenses solides par un réseau de « blockhaus », destinés à recevoir l’artillerie indispensable, pensaient-ils, pour repousser les alliés.
Nous avions, pour cela, pénétré dans la « zone rouge », profonde d’une cinquantaine de kilomètres et à l’intérieur de laquelle nous savions que toute circulation était sévèrement surveillée. De plus, la proximité de la frontière espagnole, par où pouvaient éventuellement s’échapper des évadés, ne faisait que renforcer la méfiance des occupants.
Le convoi était composé d’hommes de tous âges, mais cependant, en majorité de jeunes de 18 à 25 ans, très peu de « requis », beaucoup de réfractaires.
Sortis par les voies « marchandises », nous sommes mis en rangs, toujours encadrés de nos sbires, naturellement et en marche !
- « Comme on ne sait pas ce que l’on va faire de nous, il faut repérer où l’on va exactement, dis-je à Gérard qui ne m’avait pas quitté d’une semelle. »
La colonne marchait à bon pas, nous longions la voie SNCF conduisant d’Espagne à Bordeaux, et remontions la rue sainte Ursule.
Un immense bâtiment nous surplombait, comme une forteresse.
Nous n’allions pas tarder à comprendre.

- L’accès piétonnier, de la citadelle de Bayonne, surplombe un fossé de 30 à 40 mètres de large et de plus de 5 mètres de profondeur, parapet de 10 à 12 mètres de haut, rendant l’évasion de ces lieux impossible
Quart de tour à droite, et nous pénétrons dans la citadelle, par un plan fortement incliné en forme de pont-levis, franchissant les douves des fortifications. Les murs de l’ouvrage doivent faire une douzaine de mètres de hauteur (pour la petite histoire, la citadelle de Bayonne fût construite par Vauban en 1694 sur 30 hectares, et l’obstacle l’entourant : un fossé de 30 à 40 mètres de large et de 5m50 de profondeur, dont le glacis était battu par un parapet, à 10/12m de la contre escarpe).
Du troisième étage des bâtiments intérieurs qui nous sont « affectés », derrière les barreaux des fenêtres, nous surplombons l’Adour et la ligne de chemin de fer et, au loin, nous découvrons les contreforts des Pyrénées et derrière leurs pics, l’Espagne.

- vue aérienne de la sinistre citadelle de Bayonne

- Plan de la citadelle
Ce n’est qu’au bout de quarante-huit heures, que nous allons être « sélectionnés », le mot n’est pas trop fort.
Alignés en rangs d’oignons, dans la cour pavée, nous allons faire connaissance des officiers de la « TODT ».
La TODT était une organisation paramilitaire, mise sur pied par les nazis pour veiller à la réalisation des ouvrages de défense du Reich, et donc à la surveillance des camps de travail, et l’utilisation des personnes qui y étaient internées.
Les officiers comme les soldats portaient un uniforme noir, comme les SS.
Ces derniers, accompagnés d’interprètes, choisissaient leurs esclaves, comme le maquignon en champ de foire jette son dévolu sur une bête ou une autre. Munis d’un listing, comportant la profession de chacun et son âge, ils composaient leur équipe qui, aussitôt, était embarquée dans les camions.
Gérard, de Masson (une nouvelle connaissance) et moi, nous trouvons sélectionnés dans le même groupe. Nous sommes douze.
Le véhicule s’ébranle, traverse la ville de Bayonne, prend la route de Bordeaux. Nous ne voyons défiler le paysage que par la bâche arrière relevée.
Deux miliciens et un fritz en armes sont du voyage.
Nous allons évaluer à une vingtaine de kilomètres la distance de la destination finale. Dans le village de Labenne, le camion tourne à gauche, pénètre dans la forêt de pins par une unique route qui mène à la mer.
En quelques minutes nous entrons dans une cour sablée, nous sommes au pied des bâtiments de l’institut Helio-marin de Labenne-l’Océan, c’est inscrit en lettres blanches sur le fronton de l’aérium.

- L’Aérium de Labenne-L’Océan : neuf de quelque années, d’où les malades du poumon avaient été chassés sans ménagements, pour être transformé en base du camp d’internement.
- « On n’a pas à se plaindre, commenta de Masson, ils nous amènent en colonie de vacances ! »
En effet, la mer n’était pas à 50 mètres de là. Seule différence avec la « colo », la double rangée de « chevaux de frises », chargée s’il le fallait, de nous rappeler à la triste réalité.
Nous occupons, par chambrées de quarante-huit hommes, les salles communes qui avaient été destinées à l’origine aux malades du poumon, avant que les boches ne les expulsent de là, quelques semaines auparavant.
Nous avons « quartier libre » (façon de parler), pour l’après-midi, et pouvons enfin utiliser les douches de l’établissement (nous n’avions pas fait de toilette depuis huit jours).
De Masson, Gérard et moi allons occuper chacun des trois étages du même châlit.
Je dois avouer qu’à ce stade du voyage, nous pensons sincèrement que nous ne sommes pas trop malmenés. En effet, bâtiments propres, lavabos communs en quantité, séjour en bord de mer, dans une région des plus ensoleillées de France, la panacée, quoi !
Nous n’allions pas tarder à déchanter.
Je profitais de ce court instant de détente, pour écrire une lettre à mes Parents, espérant pouvoir là leur faire parvenir. J’évitai naturellement la description trop noire de ce que nous avions enduré depuis une semaine, espérant qu’André leur aurait annoncé la nouvelle de mon arrestation, avec ménagement.
Puis, avec mes deux amis, nous allions faire le tour du « proprio », comme dira Gérard, qui, décidément, ne manquait pas d’humour (je pense qu’il participera largement à nous maintenir le moral au beau).
Nous pouvions circuler comme nous voulions, à l’intérieur du camp, dont la seule entrée était gardée par la milice.
Très vite nous fîmes le point.
En dehors des « réfractaires », les plus nombreux, bien d’autres hommes se trouvaient là pour des raisons différentes. Certains volontaires, avec statut privilégié, « logés » à part, quelques condamnés de droit commun à qui les chleuhs avaient promis la libération pour plus tard, des étrangers (russes, polonais, yougoslaves) déboussolés de leur pays occupés, et des internés dits « politiques » (communistes, républicains, espagnols, gaullistes portant un triangle de tissu rouge cousu sur leurs vêtements).
Le bâtiment, qui ne comportait qu’un étage sur rez-de-chaussée, était équipé d’une cuisine et d’un magasin pompeusement appelé « coopérative » où les miliciens vendaient toutes sortes de denrées et produits, à des prix faisant concurrence au marché noir. Les salops s’en mettaient plein les poches.
Le Lagerfuhrer (Chef de Camps) occupait ce qui avait dû être le bureau de Direction de l’aérium et ses dépendances, au fond du hall d’entrée, au rez-de-chaussée.
Après quelques conversations, nous en apprenons plus sur le sort qui nous est réservé.
Les boches ont effectivement entrepris de fortifier leurs défenses sur cette côte. D’énormes blockhaus sont en cours de construction, et nous allons être chargés pendant douze heures par jour, des travaux les plus durs de terrassement, de transport de matériaux.
J’allais, je crois, vivre les plus pénibles journées de mon existence.
Amenés sous bonne escorte, dès le matin 6 heures, sur le chantier qui se trouvait à environ quatre cents mètres du camp, nous allions découvrir une immense excavation de près de 50 mètres sur 50 et d’une dizaine de mètres de profondeur, creusée dans le bord de la plage, à une cinquantaine de mètres de la pleine mer.
Cet immense trou est destiné à abriter la construction d’un blockhaus, devant recevoir une énorme pièce d’artillerie, ses entrepôts de munitions, les abris des servants ainsi que, toutes les annexes nécessaires pour soutenir un siège, face à des attaques venant de l’océan.
Nous sommes six dans l’équipe, gardés par un « wolksturm ». La « wolksturm », ou « armée populaire » (ultime levée de troupes de Hitler), était composée de vieux de plus de 55 ans et de jeunes de 16 à 18 ans, destinés à remplacer les soldats au front. Notre « wolksturm » était un vieux bonhomme de 62 ans, vêtu d’un uniforme trop grand pour lui, et armé d’un fusil. Il répondait au prénom de Heinz.
Pour commander les travaux, un « todt » handicapé (il traînait une jambe raide), une vraie ordure qui devait de plus souffrir d’un complexe d’infériorité et qui portait à la ceinture un fouet de cuir tressé. Il se prénommait Klaus.
Nous avions réussi, Gérard, de Masson et moi, à nous glisser dans la même équipe. Embarqués sur un énorme semi-remorque, que conduisait le boiteux, nous faisions des allers et retours, de la gare de triage de Labenne au chantier, afin de charger et décharger, soit des parpaings énormes pesant une trentaine de kilos, soit des sacs de ciment de 50 kilos. Entre temps, nous « relevions » les tas de caillasse, déversés en bordure de la route par des bennes basculantes, à proximité de l’ouvrage.
La fin d’un magnifique printemps ensoleillé, dans cette région des plus tempérées du pays, nous valut ces jours là, des températures de 38 à 40° à l’ombre.
Tirés des wagons, on nous chargeait, en travers des épaules, les parpaings ou les sacs de ciment, que nous devions acheminer jusqu’au véhicule.
Vêtu d’un seul maillot de corps, j’allais très vite, sans m’en rendre compte, être durement mordu par les rayons du soleil. La transpiration, mêlée à la poussière du ciment n’était pas faite pour calmer le feu qui rapidement me dévorait les épaules, le cou et les bras.
Ne sachant pas ce que nous allions faire, j’avais de plus, chaussé une paire de bottes de caoutchouc, cadeau de mon beau-frère avant de partir en ferme.
Les pieds en feu, gonflés et irrités par la sueur, j’avais l’impression de marcher dans un marécage brûlant.
Seule, la solidarité entre nous était, je crois, capable de nous remonter le moral. Douze heures de cette cadence me font dire maintenant, que les nuits à la distillerie ne pouvaient être que comparées au « club Méditerranée », à côté de cet enfer.
Ce soir-là, je m’écroulais sur ma paillasse sans manger, mes camarades en firent autant.
Mais nous n’allions pas être longtemps au « calme », si l’on peut appeler calme la vie de quarante-huit bonshommes, dans une « carrée » équipée de châlits de trois étages. En effet, c’est cette nuit-là que les boches, les miliciens, les Todt et les quelques volontaires avaient choisi pour fêter je ne sais quoi, dans le grand hall, à l’entrée du bâtiment. Accordéon et grosse caisse étaient chargés de faire danser toute cette racaille, à laquelle s’était jointe une demie douzaine de putains locales.
Je vous passe le récit de notre première nuit à l’arbeit-lager.
Heureusement, nous pûmes nous organiser un peu, les jours suivants.
D’une part, le vieux Heinz n’était pas un féroce, et lorsque le Klaus s’éloignait, il s’arrangeait pour nous faire baisser les cadences. _ Personnellement, je ne sais pourquoi, je lui étais sympathique au point qu’il lui arriva, plus d’une fois, de me refiler du pain ou de la saucisse qui lui était attribuée.
Quant à nous, nous allions « apprécier » la soupe d’orties verdâtre, dans laquelle nageaient quelques bouts de patate ou de rutabaga, ainsi que les sardines salées, tirées d’un tonneau de bois énorme.
C’est seulement au bout de plusieurs semaines, que le vieux Heinz se confia à moi, dans un mauvais français.
Il avait 62 ans, avait donc fait la guerre de 1914-1918, et venait de perdre son seul fils de 34 ans, à Stalingrad.
Les yeux embués, il eût même le courage de me dire :
- « Hitler, kaput ! guerre, nicht gut ! »
Quant au Klaus, il était abject.
Il avait pris de Masson en grippe et lui en faisait baver plus qu’à quiconque.
De son vrai nom, de Masson d’Authune, était enfermé là, uniquement parce qu’il était fils du général de Masson d’Authune, ayant rejoint De Gaulle, et né de mère Irlandaise (il avait tout pour plaire).
Nous étions chargés, je l’ai dit, de nettoyer la route bitumée de la caillasse qui s’y était déversée lors du basculement des bennes la transportant.
Armés de pelles, nous « relevions le tas ».
De Masson, avec il faut le dire, un esprit provocateur, rejetait les pelletées sur le bord du tas de façon à ce que la caillette, en roulant,redescende sur la route au même endroit.
- « Masson ! hurla Klaus, arbeit nicht gut !
- Pas Masson, répondit notre ami, mais DE Masson ! »
C’est alors, que Gérard nous sortit, très calmement, ce vieil extrait de l’almanach Vermot des années 20 :
- « De Masson D’Authune, De corvée, De chiottes, Demain matin, Deux fois, De Suite ! »
Toute l’équipe éclata de rire, ce qui mit le Klaus dans une fureur telle que, sautant avec peine de la plate-forme de laquelle il surveillait le travail, en quelques enjambées claudiquées, il était sur nous. Arrachant le fouet de son ceinturon, il en cingla de Masson aux jambes que son short laissait dégarnies. Son mollet était zébré de sang.
Le grand de Masson leva sa pelle, alors que Klaus lui tournait le dos, mais heureusement se ravisa.
Tout acte de ce genre lui aurait coûté très cher et à nous aussi.
Petit à petit, l’idée d’évasion nous effleura.
Conscients des difficultés que nous rencontrerions, cela nécessitait bien des réflexions : comment sortir du camp gardé jour et nuit ? repérer les possibilités de rejoindre la gare de Labenne en traversant la forêt, qui nous en séparait sur environ 3 kilomètres ? envisager les conséquences du fait que, tous nos papiers d’identité et cartes d’alimentation nous avaient été substitués ? prévoir la traversée de la zone rouge à Dax, et les éventuels contrôles jusqu’à Bordeaux ?
La semaine qui suivit nous apporta la réponse à la première question posée.
Notre vieux Heinz allait nous apprendre, que notre groupe allait faire partie de l’équipe désignée pour « couler une dalle ». Nous devions être informés que le coulage d’une dalle de béton armé se fait sans aucun arrêt des travaux, afin d’éviter un quelconque raccord, qui en fragiliserait la résistance.
La tâche fut extrêmement pénible.
Amenés sur place le matin, à 6 heures, nous ne devions quitter le chantier que le surlendemain à plus de midi, soit plus de 36 heures de labeur, avec une pause toutes les six heures, soit presque deux jours et une nuit.
C’est la nuit qui allait nous fournir des raisons d’espérer.
Comme le travail ne cessait pas, et du fait de l’organisation même du chantier, de ses allées et venues incessantes et dans tous les sens, l’ensemble était violemment éclairé de batteries de projecteurs, et nous avions remarqué le singulier relâchement de la garde de l’entrée du camp.
Complètement crevés, nous étions cependant satisfaits de nos observations.
Il devait être possible de sortir tranquillement, sans hâte anormale ; les gardes ignorant apparemment qui était, ou n’était pas, « de nuit ». Nous décidâmes donc de profiter de la nuit de « coulage de la prochaine dalle » pour faire la « belle ».
Pour nous récompenser de notre effort, nous eûmes « quartier libre » tout l’après-midi, après distribution d’un « repas » amélioré : saucisse, margarine, pain noir et oh ! surprise, un litre de vin rouge par homme, du vin synthétique, nous diront les amateurs du breuvage. Pour ma part, j’en arrosais mon voisinage, car je ne buvais pas d’alcool.
Inutile de dire que l’ambiance était chaude dans la chambrée, et en début de soirée un incident se produisit, qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Gérard, ayant passablement consommé, s’énervait de plus en plus, s’étant tout d’abord entrepris avec un « volontaire », le ton monta et, d’un seul coup, comme pris de folie, sortit sur le balcon qui surplombait l’entrée du bâtiment, il se mit à hurler :
- « À bas les boches ! Hitler, je l’emmerde ! »
Puis, debout sur la rambarde, levant le poing, il entonnait : - « C’est la lutte finale... »
Ç’en était trop...À trois ou quatre, nous le ceinturons et, en le portant plus qu’en le traînant, nous réussissons à le coucher sur sa paillasse.
Ainsi maîtrisé, le calme revint.
Curieusement, il n’y eût aucune réaction de la part de nos gardes-chiourme. Personne ne comprit !
Nous avons beaucoup de mal, on s’en doute, à percevoir les nouvelles de l’extérieur, mais certaines ont cependant filtré, de bouche à oreille : bombardement de Bordeaux par les Alliés, Bizerte et Tunis sont libérés, les Soviétiques développent leurs contre-offensives, les Allemands étant chassés d’Afrique, on évoque un éventuel débarquement allié en Italie.
Mais c’est une mauvaise nouvelle intérieure au camp qui va brusquer les événements.
Heinz nous annonce que nous allons être transférés en Italie, pour y être employés au même travail de construction de défense.
Décision est rapidement prise : nous allons nous évader lors de la prochaine « coulée de dalle ». Nous serons trois, de Masson, Gérard et moi.
Lestés d’un très léger bagage, de façon à ne pas attirer l’attention, nous sortirons du camp les uns après les autres, à quelques minutes d’intervalle.
Ayant déjà observé que c’est aux environs de minuit que les allées et venues sont les plus denses, Allemands, miliciens, « volontaires », et autres vont et viennent sans quasiment de contrôle des gardes.
Le fait, que tout soit éclairé comme en plein jour, est de nature à favoriser notre mouvement, alors que tout déplacement en nuit normale eût été impossible, sinon rapidement repéré et très dangereux.
Nous sommes au début juin.
Les nuits sont très chaudes et le jour se lève tôt.
Sortis de l’enceinte du camp, nous devons nous diriger vers le chantier, puis à une centaine de mètres, pénétrer dans la forêt où le premier attendra les deux autres : de Masson, moi-même et Gérard fermera la marche.
Il ne nous reste que quarante-huit heures d’attente, l’équipe de coulage de la dalle est déjà prévue. Nous constatons qu’effectivement tout est en place sur le chantier : ciment, parpaings, caillette, bétonneuses, fers à armer.
C’est alors que, sans raison, de Masson va être changé de camp, et nous ne le reverrons pas.
Nous hésitons, Gérard et moi, lorsque notre camarade Henri, qui, depuis un moment observait nos manèges, et avait même perçu les bribes de certains entretiens, nous demanda de fuir avec nous.
Nous acceptâmes, bien que nous ayons observé chez lui, une propension à se laisser gagner par la frousse dans maintes occasions.
Il remplacerait donc de Masson, mais sortirait le premier, alors que nous observerions, du balcon, son passage au poste de garde.
Il nous fallait sortir en bleus de travail, nos vêtements propres dans le sac.
Nous sommes convenus en dernière heure d’une tactique.
Si l’un d’entre nous a à rendre des comptes aux gardes-chiourme, il dira tout simplement :
- « On vient de m’envoyer chercher pour remplacer de Masson, qui n’est plus à son poste. »
Minuit vint vite, Henri sortit sans encombres, comme prévu le premier et nous le vîmes se diriger vers le chantier...et d’un ! À mon tour je descendais le large escalier de bois qui débouchait dans le hall, croisais deux miliciens, sans un mot, et abordais le poste.
Je ne sais pourquoi, mais je n’avais pas peur. D’un pas gaillard, mais sans hâte anormale, je franchissais le barrage et me retrouvais sur la route bitumée. Quelque cent mètres et je rejoignais Henri, dans le bois de pins.
Cinq minutes plus tard, un léger sifflet nous avertit que Gérard nous rejoignait.
Nous décidons de nous enfoncer, en biais dans le bois, et de suivre la route en parallèle, à une cinquantaine de mètres.
Après quatre à cinq cents mètres de marche tranquille, évitant tout bruit pouvant nous trahir, nous allons nous heurter à un obstacle que nous n’avions pas prévu, parce qu’inconnu de nous.
Un petit ruisseau, de trois à quatre mètres de large, nous barrait la route ; peu profond il est vrai, apparemment soixante à soixante-dix centimètres (appelé l’Anyelière).
- « MERDE, commenta Gérard, on n’avait pas prévu ça !
- C’est une vraie tuile, on ne peut pas se tremper là-dedans jusqu’à la ceinture et ensuite prendre le train, de plus nous ignorons la nature du fond, c’est trop dangereux !
- Tu as raison, il ne reste que la route et le pont. »
(Ce n’est qu’en 1963, en villégiature dans la région, que je devais découvrir qu’existait à 800 mètres plus au nord, sur Cap-Breton, un passage non surveillé, dénommé « la passerelle de Pelic ».)

- « Et le camp de prisonniers ? qu’en fais-tu ? »
Nous avions effectivement remarqué, lors des allées et venues, entre gare et chantier, que nous passions un petit pont, mais que ce dernier était en bordure d’une clairière, occupée par un camp de prisonniers tirailleurs Sénégalais qui fabriquaient du charbon de bois. Une dizaine de baraques « Adrian » les abritaient.
On distinguait les hauts cônes des fours, le tout ceint de barbelés, surmontés de quatre miradors.
Henri, commença alors à avoir la trouille, et se chargea bien de l’exprimer.
- « Moi, je rebrousse chemin, je rentre.
- Tais-toi, lui dis-je, et arrête de dire des conneries, que tu rentres de suite ou que tu sois repris, le résultat sera le même, tu le sais bien. »
Nous n’ignorions pas que toute tentative, telle la nôtre, était sanctionnée par la déportation en Allemagne. Gérard se rendit à mon avis. - « Bon, on se change, on emballe nos bleus de travail, on se chausse proprement à l’orée du bois, et on tente le coup. On passe le pont sans se précipiter, en plein milieu de la route, côte à côte, et sans un mot, la tête haute. »
Le pont, l’entrée du camp, et toute la clairière, étaient éclairés comme en plein jour. Nous distinguions nettement les projecteurs des miradors, et en ombres chinoises, le chleuh qui, sur chacune des plates-formes, veillait, armé d’un F.M. Aucun bruit de circulation de véhicule ne nous parvenant, nous nous engageons allégrement vers notre objectif.
Une centaine de mètres à faire, dans ces conditions, paraissent des kilomètres. Nos pas martèlent le bitume (surtout mes chaussures à clous).
Nous-nous attendons à chaque pas à percevoir le classique hurlement guttural.
- « Halt ! was ist das ? »
Nous franchissons le pont et, à ce moment, nous tournons le dos aux deux miradors d’entrée du camp.
Si Henri a la « pétoche », je crois que ni l’un, ni l’autre, ne se vantera d’avoir été à l’aise. Nous avons peur tous les trois, mais nous avançons.
Cinquante mètres encore, et nous pénétrons dans le bois ; l’obstacle a été contourné.
Nous ignorerons toujours, et pour cause, pourquoi il n’y eût aucune alerte de lancée.
Nous reprenons notre marche, à distance raisonnable de la route, en échangeant à voix basse quelques commentaires.
- « On est sauvés ! dira Henri, qui passait très rapidement de la peur à l’euphorie.
- Attends, lui répondis-je, tu n’es pas encore chez toi, n’oublie pas qu’il nous faut maintenant voyager sans papiers.
- Et surtout franchir la zone rouge à Dax, conclut Gérard. »
Nous atteignons la nationale 10, qui mène d’Espagne à Bordeaux, la gare de Labenne est à quelque cent mètres de là, il est quatre heures du matin, le jour ne devant pas tarder à se lever.
C’est alors qu’il me prit une envie du « gros besoin », comme aurait poliment déclaré ma Grand-Mère.
Cette gare est, comme toutes les gares SNCF de l’époque, ceinte de barrières blanches en ciment. De faible hauteur, cette dernière fut aisément franchie, et c’est entre deux trains de marchandises de le gare de triage que je satisfaisais cette légitime envie.
Nous décidons de rester à l’intérieur de l’enceinte, abrités des regards par les wagons.
Nous avions bien fait sans le savoir, en effet, dès l’ouverture de la station, deux fritz en armes et un sous-officier se plantaient devant la porte d’accès.
- « Papierens ! Bitte. »
Contrôlant ainsi toutes les entrées.
Étant à l’intérieur, nous avions passé le second obstacle imprévu.
En rigolant, j’eus ce commentaire :
- « On pourra dire, qu’on a pu prendre le train grâce à une envie de ch... »
Le train Hendaye-Bordeaux entre en gare.
Il est constitué de vieux wagons de bois, datant du début du siècle, sans couloirs desservant les compartiments, qui sont donc isolés les uns des autres.
Nous occuperons, seuls, l’un des compartiments de cet omnibus aux banquettes de bois, qui s’arrête à toutes les haltes, et qui, par son infrastructure même, nous préserve de tout contrôle, entre deux arrêts.
Le franchissement de la zone rouge étant en gare de Dax, nous décidons en cas de menace, de descendre à contre-voie dans cette gare, puis de regagner notre place, tout danger étant écarté.
C’était compter sans la malchance.
À Saint-Vincent-de-Tyrosse, montent deux SS, avec « barda » complet, sac et armement, et qui s’affalent, occupant à eux deux l’une des banquettes.
Ils ne font aucunement attention à nous, riant bruyamment. Naturellement, pas question d’éventuelle descente, interdite !
Nous atteignons enfin Dax, et un Français d’une quarantaine d’années prend place dans le compartiment qui, de ce fait, est presque complet.
Les haltes dans toutes les gares n’avaient duré que quelques cinq à six minutes, alors que là, dix minutes s’étaient écoulées, et le convoi restait immobilisé en gare.
Le brave homme qui nous faisait face avait vraiment l’air de s’être rendu compte que nous n’étions pas très à l’aise. Il entreprit de sortir de sa musette un énorme pain et un confortable morceau de Port-salut, et se mit à « casser la croûte ».
Je ne cache pas que nos regards d’envie devaient nous trahir.
Le train démarrait enfin. Nous n’avions été astreints à aucun contrôle. Je crois que nous ne comprendrons jamais pourquoi.
À la halte suivante, nos SS débarquentetl’atmosphèrese détend enfin.
- « Vous n’avez pas l’air d’être très en règle, questionne notre voyageur. »
Gérard lui explique, sans détours, notre situation : l’évasion, le voyage vers Paris, tout cela seulement au vu de sa bonne mine.
Le brave homme a tout d’abord un geste.
Il nous offre le reste de pain et de fromage qui avaient regagné le fond de sa musette, puis :
- « Je suis un « volontaire », et non « requis ».
(On saura, après la Libération, que certains « volontaires » avaient une tâche de renseignements d’une importance capitale pour les alliés). - Et dans votre situation, j’ai plusieurs conseils à vous donner. À Bordeaux, séparez vous, vous passerez plus inaperçus. Ne sortez pas de la station, ne bougez pas du Buffet de la gare. Si rien n’est changé, vous n’aurez qu’une demi-heure à attendre pour prendre le « Bordeaux-Paris », qui se forme normalement sur la voie d’à côté. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. »
À 9h30, nous entrons en gare de Bordeaux.
Les quais, les halls, le buffet et ses abords fourmillent de boches de toutes armes. Nous-nous séparons d’un « shake-hand » affectueux, et gagnons le buffet chacun dans son coin.
Pour ma part, je suis favorisé, ma carte de gratuité SNCF (que j’avais réussi à camoufler), mon père étant cheminot, m’évite tout déplacement vers les guichets et me permet même de voyager gratuitement en seconde classe [1].
Le train de Paris entre en gare, je me hisse en 2e, et je crois n’avoir jamais autant savouré le confort des banquettes rembourrées d’un wagon.
Je commence enfin à me rassurer. La joie de penser être libre me surprend à sourire.
Le voyage « Bordeaux-Paris » me semblera donc court.
Je pense à Henri, à Gérard surtout, que j’aurai appris à estimer, et qui, tous deux, voyagent certainement dans le même train.
« Paris-Austerlitz », il est 22 heures, métro Gare Saint-Lazare, je saute dans le « dernier train », le couvre-feu est à minuit.
Sartrouville est plongé dans un noir d’encre, je remonte la rue Faidherbe.
Je sonne à la porte de bois du pavillon, les volets de la fenêtre des Parents s’entrouvrent.
- « Qui est là ?
- C’est moi, Bernard ! »

- Ma Mère
Je distingue un cri de surprise. Ma Mère dévale plus qu’elle ne les descend les six marches du perron. Elle avait pris le Père de vitesse, elle se jetait dans mes bras...