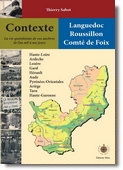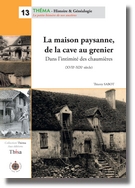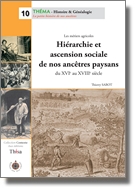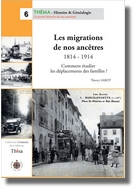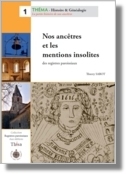Notre fidèle lectrice, Evelyne Tavernier, nous écrit : je viens de trouver dans le registre de Concriers (Loir et Cher) ce texte rédigé par le curé sur les désastres de cette année-là et je pense qu’il peut, peut-être, vous intéresser.

E-dépôt 058/2 Vue 9/181
http://archives.culture41.fr/ark:/57457/vta5331db5e3ecf9/daogrp/0#id:1705071683?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=1319.991,-1168.871&zoom=7&rotation=0.000
Les bleds semés avant lhyver de mil sept cent huit furent gelés par toutte la france
On sema en leur place orges et avoines en mil sept cent neuf. Le bled vallut iusqu’a [1] vingt francs la mesme [2] à Boisyeney [3] et vingt-cinq livres à Janville et lorge huit francs : les orges semés à la place des bleds vinrent en abondance, le pain de bled vallois cinq sols la livre, et le pain d’orge trois sols. Presque tous les noyers furent aussy gelés surtout les anciens de cent ans et au-dessous, les vignes eurent aussy le mesme malheur ce qui nous envoia a la samaritaine [4] car le moindre se vendait jusqu’à deux cent livres le tonneau et la pinte dix sols et au dessus. Elles regelèrent lhyver mil sept cent dix à scavoir le dernier jour d’avril et le premier jour de may. Sa charté dura iusqu’a l’an [5]
On fit en plusieurs endroits de la bière et des cidres de pommes et de poires. Le peu le bleds qui n’avoient été semés en mil sept cent neuf estant prets a estre moissonnés en mil sept cent dix furent battus et renversés d’un vent très furieux qui dura depuis dix heures du matin iusqu’à sept heures du soir un lundy vingthuictieme jour de juillet de la ditte année [6] et causa la perte de près de deux semences et ailleurs deux mesme de la miesme.
J’ay ptre curé de St Firmin de Concriers ssgné certifié avoir écrit et remarqué fidelement ceque dessus ne le sachant que trop et de ma propre expérience en foy de quoi soussigné les présentes.
En marge la signature : Georges ptre curé de St Firmin de Concriers
Extrait de Contexte France, fiche 1709-1710 : Les hivers 1709-1710 sont très rudes : crise frumentaire, famine et mortalité considérable (800 000 victimes). À noter que les morts de l’année 1709 sont imputés au froid polaire et à la famine et que ceux de l’année 1710 le sont plutôt aux épidémies (notamment fièvre typhoïde). / Poursuite de la chute brutale des baptêmes avant une reprise soutenue à partir de 1711. Au total, pour les deux années, on enregistre en France 2 141 000 décès contre 1 330 800 naissances, soit une perte de 810 000 personnes, 3,5 % de la population. Selon F. Lebrun, la crise de 1709-1710 « a eu des conséquences démographiques beaucoup moins dramatiques que celle de 1693-1694 », car « les grains n’ont pas totalement manqué », les récoltes d’orge ont procuré une nourriture de remplacement, et enfin les mesures de secours des autorités se sont révélées efficaces (distribution de céréales provenant de régions peu touchées ou de l’étranger, distribution gratuite de pain…). Il n’en reste pas moins que le « grand hyver » restera longtemps inscrit dans la mémoire collective. / Partout, les maisons d’assistance spécialisées (bureaux des pauvres, orphelinats municipaux, hospices pour aveugles ou pour vieillards, hôtels-Dieu et hôpitaux généraux) sont pleines (séries GG des AM et H des AD). / Des émeutes urbaines éclatent, notamment à Paris, dans les villes de la Loire moyenne, en Normandie, en Provence, en Languedoc. / En 1710, Fénelon publie un Mémoire sur la situation déplorable de la France en 1710 : « Voici ce que je vois, et que j’entends dire tous les jours aux personnes les plus sages et les mieux instruites. Le prêt manque souvent aux soldats. Le pain même leur a manqué, souvent plusieurs jours ; il est presque tout d’avoine, mal cuit et plein d’ordure. Ces soldats mal nourris se battroient mal, selon les apparences. On les entend murmurer, et dire des choses qui doivent alarmer pour une occasion. Les officiers subalternes souffrent à proportion encore plus que les soldats. La plupart, après avoir épuisé tout le crédit de leurs familles, mangent ce mauvais pain de munition, et boivent l’eau du camp. Il y en a un très grand nombre qui n’ont pas eu de quoi revenir de leurs provinces ; beaucoup d’autres languissent à Paris, où ils demandent inutilement quelques secours au ministre de la Guerre. [...] Les peuples ne vivent plus en hommes ; et il n’est plus permis de compter sur leur patience, tant elle est mise à une épreuve outrée. Ceux qui ont perdu leurs blés de mars n’ont plus aucune ressource. Les autres, un peu plus reculés, sont à la veille de les perdre. Comme ils n’ont plus rien à espérer, ils n’ont plus rien à craindre. Le fonds de toutes les villes est épuisé. On en a pris pour le Roi les revenus de dix ans d’avance ; et on n’a point honte de leur demander avec menaces, d’autres avances nouvelles, qui vont au double de celles qui sont déjà faites. Tous les hôpitaux sont accablés ; on en chasse les bourgeois pour lesquels seuls ces maisons sont fondées, et on les remplit de soldats. [...] Les Français qui sont prisonniers en Hollande y meurent de faim, faute de paiement de la part du Roi. [...] Nos blessés manquent de bouillons, de linge et de médicamens. [...] On accable tout le pays par la demande des chariots ; on tue tous les chevaux de paysans. C’est détruire le labourage pour les années prochaines, et ne laisser aucune espérance pour faire vivre ni les peuples ni les troupes. [...] Les intendants font, malgré eux, presque autant de ravage que les maraudeurs. Ils enlèvent jusqu’aux dépôts publics. [...] On ne peut plus faire le service, qu’en escroquant de tous côtés [...]. »