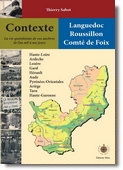"Je m’appelle Prosper GUILLEGAULT, je suis actuellement dans ma 70e année. Je viens depuis un an de cesser mon activité de maçon-tailleur de pierres. Métier que j’ai exercé pendant 56 ans en comptant mes années d’apprentissage. Après toutes ces années de dur labeur, j’ai laissé ma petiteentreprise à mes trois fils, Léon, Octave et Édouard pour prendre un repos bien mérité.
Prosper à la fin de son activité professionnelle

Depuis que je ne travaille plus, je mène une vie tranquille dans ma ville natale de Blois, plus exactement dans le faubourg de Vienne situé sur la rive gauche de la Loire, au numéro 2 de l’avenue de ’La Belle Jardinière’.
Blois fin du XIXe siècle
C’est une maison que j’ai construit avec mes fils il y a une douzaine d’années. Elle est de plein pied comprenant un rez-de-chaussée avec quatre pièces à cheminée, un grenier dessus et un toit en ardoises. Elle est entourée d’une cour et d’un jardin avec dépendances [1].
J’y vis avec ma femme Marguerite, nous nous y sentons bien dans cette maison. Nous y occupons deux pièces sur quatre. Les deux autres, nous les louons au couple DUPUIS pour un loyer annuel de 135 francs. Lui est ouvrier en chaussures dans l’entreprise ROUSSET, elle, par contre, est lingère. Ce sont de bons locataires.
Nous louons à ce couple depuis peu. Auparavant nous hébergions nos trois petits-enfants nés de ma fille Berthe décédée il y a trois ans à l’âge de 36 ans. Leur père, Michel BOURGER, ayant disparu de la circulation depuis à peu près une dizaine d’années, c’est moi qui ait été désigné par un conseil de famille, réuni sous la présidence du Juge de Paix du canton Est de Blois, comme tuteur légal des trois mineurs, Michel, Marius et Marianne.
Nous nous plaisons bien dans nos deux pièces. La première, donnant sur le jardin, tient lieu de salle de tous les jours. Elle est meublée d’une table carrée, de deux chaises, d’un lit en noyer, garni de sa literie complète, et d’un gros fourneau avec sa batterie de cuisine et un moulin à café. Sur la cheminée il y a une petite glace et une pendule entourées de deux petites lampes. Le tout éclairé par une lampe à suspension.
La seconde chambre contient une table ronde, six chaises paillées, un lit en noyer avec toute sa literie, une commode en noyer, une armoire à deux portes, aussi en noyer et une table de nuit. Le tout agrémenté d’une glace et d’un tapis. Ce dernier étant disposé sous la table. Sur cette dernière on a disposé deux services, un à café et l’autre à liqueurs. Sur la commode trône une lampe
statuette entourée par deux vases. Sur la cheminée il y a une pendule de Paris entourée par deux flambeaux. Cette pièce sert de chambre à coucher et de salle à manger pour le dimanche et les repas de famille. Cette maison et ce mobilier sont le fruit d’une longue vie de travail de ma part et de celle de Marguerite qui était couturière.
Il n’y a donc qu’une douzaine d’années que nous habitons avenue de la Belle Jardinière. Auparavant nous étions rue Croix-Boissée, au Chemin Neuf puis rue du Point du Jour, ou je suis né au N°2, le 9 janvier 1831.

Arrivant au crépuscule de ma vie, je me surprends, souvent, à essayer de la retracer. Des souvenirs les plus lointains aux plus récents. Mais avant d’en égrainer les plus marquants, j’aimerai vous parler tout d’abord de ma famille et, ensuite, du quartier où j’ai passé toute ma vie. Ce quartier de Vienne, populaire et attachant où je me suis toujours senti comme un poisson dans l’eau. Je vous en ferai un historique succinct.
Ma famille
A ma naissance mon père, Silvestre GUILLEGAULT, a 26 ans. Il exerce le métier de maçontailleur-de-pierres chez un maître maçon de Blois, Augustin RAYMOND. Mon grand-père paternel, du même prénom que mon père, demeure aussi à Blois et est lui aussi tailleur de pierres. Originaire de Levroux, près de Châteauroux, il est arrivé dans notre ville vers 1800.
Pourquoi Blois ? Parce que l’ancienne cité royale est devenue depuis la révolution un vaste chantier. En effet, la nationalisation des biens religieux, en 1790, entraîna la vente et la destruction de nombreuses églises, couvents et abbayes. Bâtiments qui occupaient, en grande partie, le secteur bas de la ville, appelé Bourgmoyen, situé entre la Loire et le château.
A la veille de l’Empire, ce vieux quartier, qui n’avait pas évolué depuis le début du XIIIe Siècle, démantelé et partiellement détruit, demandait à être réaménager. Pour cela il fallait une main d’œuvre abondante. Ce qui explique, à cette période, une importante immigration d’ouvriers du bâtiment provenant de nombreuses régions, notamment de l’Indre, du Limousin et de la Creuse [2].
Ma mère, Rose, à ma naissance a, elle aussi, 26 ans. Elle exerce le métier de couturière et est issue d’une vieille famille de Vienne, les ROUGET. Son père, François ROUGET, est sabotier et tient une échoppe rue de la Chaîne, en Vienne, sur les bords de la Loire en amont du pont Gabriel. Rue ainsi nommée, car on prétend, mais rien n’ est moins sûr, qu’autrefois la chaîne des forçats passait par le faubourg de Vienne et faisait halte dans une maison de cette rue.
Après leur mariage ils s’installent en Vienne, où ma mère a toute sa famille, au N° 2 de la rue du Point du Jour, là ou je suis né. A ma naissance, mes parents ont déjà une petite fille, Victorine, âgée d’un an.
C’est la femme LALLEMAND , une des deux sages-femmes du quartier, qui a accouché ma mère. Elle habite rue Croix-Boissée, pas loin de chez nous. L’autre sage-femme du quartier, la femme LEGER, habite, elle, rue de la Croix du Pêcheur, pas loin du domicile de mes grands parents maternels.
Mon père me déclare à la mairie de Blois le 9 janvier en compagnie de son patron, monsieur RAYMOND et d’un collègue de travail, François-René RENARD. Je suis baptisé le lendemain en l’église Saint Saturnin par le curé BESSON. Mon parrain et ma marraine sont Nicolas PICARD, un ami de la famille, et Catherine GUILLLEGAULT, une sœur de mon grand-père.
En 1836, ma sœur Victorine décède à l’âge de 6 ans. C’est la maladie qui l’emporte. Monsieur DARNAULT, le médecin de la rue Croix-Boissée reste vague dans son diagnostic. Il pense à la fièvre putride pourprée (Typhoïde), mais n’en est pas sûr.
Le 19 février 1837, j’ai eu une petite sœur du nom de Léontine. C’est toujours la femme LALLEMAND qui accouche ma mère. le 12 Avril 1841, j’eus encore la joie d’avoir une autre petite sœur que mes parents ont nommé Désirée. Enfin, le 11 Avril 1844 voit un nouvel arrivant dans la famille. C’est un petit frère que mes parents ont nommé Constant Clovis. C’est la femme PROUST, cette fois-ci, qui a accouché ma mère. C’est elle aussi qui a déclaré l’enfant à la mairie, mon père, entrepreneur à l’époque, était parti en prospection pour trouver des chantiers.
Ma mère n’a pas eu d’autres enfants. J’ai donc eu trois sœurs et un frère, je me suis toujours bien entendu avec eux. Après le décès de Victorine c’est moi qui suis devenu l’aîné.
Mon quartier de Vienne à Blois
Il est très ancien car il semble que du temps des gaulois ce soit une île située entre deux bras de la Loire. Elle aurait été nommée par les romains ’Insula evenna’ (île de rivière) et aurait abritée une concentration d’habitations où vivaient des mariniers, des pêcheurs et des gens du voyage.

A leur arrivée les romains installèrent un camp militaire sur un promontoire de la rive droite, en face de l’île. Avec le temps une agglomération s’est développée autour de ce camp, elle aurait pris le nom de ’Blésu’.
Cette nouvelle agglomération se trouve dans l’axe de circulation entre la cité des Carnutes, Autricum (Chartres), et Avaricum (Bourges). Ce qui explique son développement. Le passage des deux bras de la Loire via ’insula evenna’ se faisait à gué ou en bac.
Plus tard furent érigées des turcies et des levées (digues longitudinales formées de bois et de terre) sur les deux rives de la Loire afin de rétrécir le lit de cette rivière en la rendant plus navigable et de protéger le val des inondations. ’Insula evenna’ perdit alors son caractère insulaire. On parle alors de ’Evenna’. Cette dernière garde encore bien son identité gauloise par rapport à ’Blesu’.

Sous les mérovingiens, son nom se transforme en ’Vienne’ (rivière en gaulois) et, plus tard, au 10e siècle, sous les comtes de Blois, on l’appellera ’Vienne les Blois’ et devient une seigneurie du comté de Blois.
A la même époque est bâtie l’église Saint Saturnin. A partir de ce moment ’Vienne les Blois’’ n’est plus une concentration d’habitations mais une véritable agglomération autour de la nouvelle église.
C’est aussi à cette époque que fut construit un pont de pierre et de bois qui relie les deux agglomérations. Malgré ce ’trait d’union’, ’Vienne les Blois’ tient à garder son indépendance par rapport à Blois.
Au début du 17e siècle, le seigneur de ’Vienne les Blois’ cède à Henri IV ses droits de fief et de propriété. Ainsi le bourg intègre le domaine royal et devient un quartier de la ville de Blois.
C’est au aussi au cours de ce 17e siècle, sous HENRI IV, que furent renforcées les levées du bord de Loire qui protégeaient le faubourg. Mais ces travaux s’avérèrent inefficaces face aux grandes crues du début de ce siècle. C’est pourquoi, au milieu du 18e siècle, on construisit le déchargeoir de la Boulie (appelé plus tard déversoir).
Ce déchargeoir formé de plusieurs levées, lors des grandes crues, sert d’évacuation des eaux vers le val afin de protéger le faubourg.

Le quartier occupe essentiellement une partie de la levée de la Loire qui entoure le pont Gabriel et la rue Croix-Boissée. Cette rue a longtemps été la rue principale de Vienne, car située dans le prolongement de l’ancien pont médiéval, détruit en 1716 par un embâcle de la Loire et remplacé vers 1730 par le pont Gabriel (du nom de son architecte). C’était la route vers l’Espagne avant que ne soit ouvert le ’Chemin Neuf’ dans le prolongement du nouveau pont.
Au XVIIIe Siècle cette rue Croix-Boissée était jalonnée d’auberges et de commerces. Après la réalisation du ’Chemin neuf’ les auberges et estaminets de toutes sortes disparaissent de plus en plus et laissent la place à une population de mariniers, d’artisans et de journaliers de tous genres [3].
Actuellement c’est encore une rue très populaire avec un cachet particulier. C’est un mélange pittoresque, presque toutes les classes de la société y sont représentées. On y côtoie des fonctionnaires, des employés, des marchands, des artisans de tout ordre (de bouche, du bâtiment, du bois, de la batellerie etc...), des rentiers, des jardiniers, de nombreux ouvriers de tout ordre et surtout des mariniers, des pêcheurs et les inénarrables marchandes de poissons.
Le marché qui se tient une fois par semaine sur le terre-plein à côté de l’église Saint-Saturnin offre un véritable spectacle par la variété des étalages et son ambiance particulière. La foule bigarrée des ménagères se presse autour des étalages, toujours bien achalandés, sous les multiples harangues des jardiniers de Bas Rivière ( Quartier de maraîchage situé à l’ouest de Vienne), des marchands de bouche, de différents camelots et commerçants et surtout des poissonnières avec leur petit bonnet blanc et leur éternel et tonitruant " Poisson de Loire, poisson tout en vie !!!" [4].

Évènements qui ont marqué mon enfance et mon adolescence
Élève à l’école des frères de la morale chrétienne.
L’âge de raison est l’âge d’aller à l’école. C’est à cette époque que je suis inscrit à l’école primaire des "Frères de l’école chrétienne" [5]. Elle est située rue Clérancerie, pas très loin de notre habitation.

Cette congrégation est parvenue depuis peu à avoir le monopole de l’instruction dans presque toute la ville. Après avoir été interdite à la révolution et réhabilitée en 1804, petit à petit elle a réussi à s’implanter, à partir de 1815, en faisant éliminer un à un les anciens instituteurs.
Auparavant, en Vienne, c’était monsieur CHALUMEAU qui était l’instituteur [6]. C’était un ancien soldat de la "Grande Armée" qui, grièvement blessé en Espagne, a quitté l’armée pour être instituteur. Il était très apprécié des élèves et de leurs parents.
Pour avoir le monopole de l’instruction dans le quartier, la congrégation a réussi à lui faire supprimer sa dotation de 150 francs octroyée par la Mairie pour la location de son local, rue Poirier, près de l’église Saint Saturnin.

Ce sont donc les frères qui m’apprennent à lire, à écrire et à compter. Ils assument aussi l’instruction religieuse. Leur enseignement est gratuit et concerne les enfants des trois paroisses ; Saint-Nicolas, Saint-Louis et Saint-Saturnin. Aussi bien les enfants de riches, d’artisans ou de pauvres. Cette mixité, d’après mon père, était un atout pour mon avenir.
Leur pédagogie est stricte, la bonne tenue et la discipline sont les piliers de cette dernière. Parfois je me plaignais à mon père de la dureté des frères. Il me répondait que j’avais de la chance de pouvoir aller à l’école. Lui n’a pas pu y aller faute de moyens de ses parents. Il le regrettait énormément.
C’était un bon tailleur de pierres, son maître-maçon, monsieur RAYMOND, en a fait son premier ouvrier. En plus, il avait le sens des affaires, il aspirait à devenir, lui aussi, maître-maçon. C’est pour cela qu’il regrettait de ne pas avoir eu plus d’instruction, cela lui aurait facilité les choses.
Je dois avouer que je ne garde pas un excellent souvenir de cette période chez les frères, vu la discipline de fer qu’ils exerçaient . Mais, à leur décharge, il faut admettre que leur enseignement était de qualité, je m’en suis aperçu plus tard quand il a fallu que j’apprenne la géométrie et la stéréotomie. J’avais de bonnes bases pour aborder ces disciplines.
IL est vrai qu’à cette époque je préférais les moments de liberté à ceux passés à l’école. Les premiers se passaient souvent dans les rues du faubourg avec les enfants de mon âge et des plus grands, tous, copains d’école. L’été c’était les jeux de billes et autres jeux sur le terre-plein à côté de l’église ou dans la rue.

Mais c’était surtout, quand il faisait beau, les escapades au bord de la Loire, toute proche. Soit nous traînions, avec mes camarades, rue des Chalands, le long du fleuve, ou nous regardions les mariniers sur leurs fluteaux ( barques à fonds plats munies d’une voile qui servent au transport des marchandises sur la Loire et aussi à la pêche) qui débarquaient leur pêche.

Nous regardions aussi les "inexplosibles" (bateaux à vapeur) qui montent et redescendent la Loire ainsi que les tracteurs à vapeur qui tractent les péniches qui remontent la rivière.
Mais les meilleurs moments passés sont ceux, quand la rivière était basse, où nous rabouillions dans le sable pour prendre de belles fritures de goujons à l’aide d’un scion muni d’une fine ligne. Le soir quand je rentrais à la maison c’était la joie, mon père était friand de friture de poissons, arrosée d’un petit rosé de Meslan (village situé sur la rive droite de la Loire, en aval de Blois, à une vingtaine de kilomètres de cette ville).
Il y avait les loisirs, mais aussi les petites corvées de la maison. La plus pénible était celle que mon père appelait la ’corvée d’eau’. Munis d’un seau, j’allais tous les jours, au début avec ma mère, tirer de l’eau au puits de la rue Croix-Boissée qui se situait à peu près à 250, 300 mètres de chez nous.

Mon initiation à la pratique religieuse
L’âge de raison est aussi l’âge de consacrer ses dimanches à Dieu en allant à la messe et aux vêpres. C’est ce que je faisais régulièrement avec mes parents. Nous nous rendions donc tous les dimanches à notre église paroissiale, Saint Saturnin, le cœur de notre quartier [7].
C’est une vieille église fondée sous les carolingiens. Elle est dédiée à Saint Saturnin de Toulouse, martyr et premier évêque de cette ville. L’édifice présente différents styles architecturaux dus aux nombreuses reconstructions.

A l’origine (Xe siècle) c’était une modeste chapelle au vocable de Saint-Antoine-des-Bois. Cet édifice fut complètement reconstruit au XIIIe siècle, tout en restant modeste. Au début du XVIe siècle, Anne de Bretagne commande un agrandissement de l’église avec la construction d’un portail central, de deux portails latéraux, d’une tour latérale et les piliers de la nef, le tout dans le style de la première renaissance. Les travaux durent s’arrêter à la mort de la reine. En 1528, la confrérie des mariniers complète la partie sud de ce bâtiment avec la chapelle de Saint-Pierre (leur patron), là le style est de pleine Renaissance. C’est en 1552 que l’édifice pris le vocable de Saint Saturnin.
Après l’incendie provoqué par les protestants en 1568, l’ancienne charpente en bois qui recouvrait la nef a été remplacée par une voûte d’ogives. Marie de Médicis reprend les travaux commencés par Anne de Bretagne mais sans les achever complètement. Le clocher rectangulaire commencé au XVIe siècle est achevé au début du XVIIe. Mais il est détruit par un violent orage en 1678. Il est alors reconstruit au XVIIIe. Les autres travaux du XVIIIe siècle sont interrompus à la révolution.
L’histoire de cette église explique les différents styles qui y cohabitent.
A l’intérieur il y a, outre le chœur, deux chapelles principales :
- Celle de Notre Dame des Aydes. On raconte qu’il y a bien longtemps, des mariniers ont trouvé dans la Loire une statue de la Vierge. Ils la transportèrent dans la chapelle de Vienne-les-Blois pour la vénérer. On l’appela ensuite Notre Dame des Aydes vu les bienfaits qu’on lui attribuât. Catherine de Médicis fit construire cette chapelle pour y accueillir une statue de cette Vierge qui, d’ailleurs fut détruite à la révolution.
- celle de Saint Pierre fut construite à la demande de la riche confrérie des mariniers. Elle est située contre le mur sud de l’église, près du chœur, elle est de style Renaissance. On y trouve à l’intérieur les statues de Saint Pierre et Saint Clément, les deux patrons des bateliers.
- Il y a aussi d’autres petites chapelles, celle du Sacré Cœur et celle de Sainte Anne, la patronne des menuisiers.
Tous les dimanches nous assistions, mes parents et moi, à la messe et aux vêpres, ma petite sœur étant encore trop petite pour venir avec nous. Ma mère était très pieuse, souvent elle faisait brûler un cierge en l’honneur de notre Dame des Aydes, la bienfaitrice de notre paroisse. Mon père, lui, allait à la messe plus par habitude que par conviction.
Mes parents avaient une place attitrée, moi je me dirigeais à droite du chœur à la place réservée aux enfants qui vont à l’école des frères. Nous chantions pendant tout l’office les cantiques que ces derniers nous avaient enseignés.
Nous étions installés presque en face des bancs des confréries. Chacune d’elles a son ou ses bancs. Les deux principales sont celle des mariniers, sous la protection de Saint-Pierre et Saint-Clément, nous l’avons déjà vu, et celle de Notre Dame des Agonisants. A l’extrémité du banc des mariniers, en face du chœur, se tiennent les bâtonniers tenant fièrement les bâtons de la confrérie.
Il y avait aussi les poissonnières de la rue des Chalands et de la rue Croix-Boissée, avec leurs coiffes blanches, qui se regroupaient dans le coté de la nef latérale et chantaient les cantiques avec une ardeur et une voix comparables à celles qu’elles employaient au marché pour haranguer les ménagères.
1842 fut l’année de ma communion. C’est le curé ARCANGER-DROUAULT qui officia. Après cette cérémonie, j’étais un chrétien à part entière. Je devais aller obligatoirement aux offices du dimanche et des fêtes saintes. Je devais aussi me confesser, au moins pour le jour de Pâques et y communier. C’est ce que j’ai fait, jusqu’à mon service militaire...
Mon apprentissage à la taille de la pierre
En 1840 mon père devint Maître-maçon. C’est son patron, monsieur RAYMOND, qui l’a aidé à acheter sa charge. Il était content, c’était son rêve depuis toujours, depuis qu’il avait appris la taille de la pierre avec son père. Il se trouva dès lors à la tête de 7 ouvriers : un maçon, un mortelier, deux carriers, deux tailleurs de pierres et un voiturier.
Le 27 mars 1841, il achète, au sieur Alex JOLLY, demeurant à Blois, une carrière de calcaire à ciel ouvert à Saint-Gervais-la-Forêt, au lieu dit ’les Closeaux’, pour 60 francs. L’acte est dressé par maître TARDIVEAU, notaire à Blois.
Les carrières de Saint-Gervais, comme celles de la région proche de Blois, extraient des pierres calcaires, d’un calcaire dit lacustre ( zone orangée sur la carte géologique, ci-dessus). Ces pierres sont faites d’anciens limons mélangés, depuis des centaines de milliers d’années, avec des fossiles, des débris d’animaux et des coquillages laissés par la mer quand elle s’est retirée du continent. Ce sont ces pierres provenant de Saint-Gervais et Vineuil qui sont en bout du pont Gabriel et un peu partout dans les gros ouvrages de Blois. Elles ne sont pas sujettes à se déliter, mais sont difficiles à tailler à cause de leur extrême dureté.
Après ma communion et ma scolarité chez les ’frères’, mon père me fait alors travailler avec lui pour apprendre la taille de la pierre. Je suis enthousiaste à l’idée de travailler ce matériau, surtout avec lui.
Mes premières armes sur les chantiers comme ’arpète’.
Au début j’étais un peu déçu car il me faisait aller sur les chantiers avec lui, l’ouvrier maçon, Jean LEGROS, et le mortelier, Edouard MASSION. Ce sont des gens que je connaissais déjà car ils habitaient rue Croix-Boissée, comme le reste de l’équipe d’ailleurs, les tailleurs de pierres et les ouvriers carriers.
Pendant une bonne année ma journée de travail se passait ainsi ; le matin, au lever du jour avec toute l’équipe nous attendions au bout du pont GABRIEL le voiturier, Pierre GAGNIER, qui venait nous prendre de la route de Saint-Dyé, où il habitait, pour nous mener à la carrière. C’était un homme un peu rustre mais sympathique. Il venait avec son charriot et ses quatre chevaux de trait, des ’boulonnais’ à la robe blanche et à la crinière généreuse.
Nous partions avec lui à la carrière en prenant le ’chemin neuf’ prolongé par la route de Saint-Gervais. Avant ce village, après le pont sur le Cosson, nous montions une bonne côte. Deux cent ou trois cents mètres après cette dernière , nous prenions sur la gauche le ’chemin des carrières’ qui nous menait aux ’Closeaux’, notre lieu de travail.
Arrivés à destination, les tailleurs de pierres et les carriers se mettaient au travail. Nous, avec le maçon, le mortelier et le voiturier, nous chargions la charrette avec les pierres taillées la veille et nous partions sur le chantier.
Là, je passais le plus gros de mon temps à faire le manœuvre d’Édouard, le mortelier. Il m’apprenait comment faire le mortier et me faisait faire aussi toutes les basses besognes. Il me montrait les bonnes proportions pour mélanger la chaux du chaufournier ( calcaire calciné), le sable et l’eau, afin d’obtenir le mortier adéquat pour ce que l’on veut faire. Parfois, mon père et Jean, son maçon, me montraient comment poser les pierres avec le fil à plomb et le niveau.
Le soir nous retournions à la carrière retrouver les tailleurs de pierres et les carriers, puis Pierre, le voiturier, nous ramenait à Blois. Les samedi soirs, au retour, nous nous arrêtions, à l’auberge du bas de la côte de Saint-Gervais où mon père nous payait à boire pour clôturer la semaine de travail.
De l’extraction à la taille de la pierre [8].
Après avoir fait le manœuvre pendant plus d’un an, mon père me mit à la taille de la pierre. J’ allais enfin apprendre le métier auquel j’aspirais depuis tout petit.
A partir de ce moment, je restais toute la journée à la carrière avec les deux tailleurs de pierres, Louis PRUDHOMME et Jean BESSE. Louis était le premier ouvrier de mon père. C’était un excellent tailleur de pierre à la grande expérience.
Il y avait aussi les deux carriers, François DUBOIS et Auguste RIBROL. C’étaient deux forces de la nature au sang vif. Ce dernier trait de caractère était peut être dû à leur travail très éprouvant qui les incitait à avoir recours, assez régulièrement, surtout quand il faisait chaud, à la dive bouteille pour garder force et courage. Mais c’étaient de bons ouvriers et de bons collègues.
Ce sont eux qui extrayaient la pierre en séparant les différents bancs ( couches superposées de calcaire) par délimitation horizontale des blocs en suivant les fissures et en exécutant des tranches verticales perpendiculaires au front de taille (ligne de fissure). Ils utilisaient pour cela de longues barres d’acier qui possédaient un taillant en arc à une extrémité et un pic à l’autre extrémité, ce sont les "aiguilles. Ils utilisaient aussi pour cela des pics, des coins de fer et de grosses pinces, tout cela étant manié à la force des bras.

C’est un travail éprouvant qui demande une grande force physique. Nos deux carriers n’en étaient pas dépourvus. Ils n’arrêtaient pas car ils étaient payés au débit. Le seul repos qu’ils se permettaient était une sieste rapide dans notre loge de carrier après avoir pris leur repas à la gamelle.
Après le levage du bloc qui se fait à l’aide de la pince, les carriers le chargeaient, à l’aide de la même pince, sur un diable ’crapaud’ pour l’emmener aux tailleurs de pierres.

C’est là que Louis et Jean intervenaient pour dégrossir le bloc en le sciant à leur convenance avec la scie passe-partout ou la scie ’crocodile’.


Une fois le bloc scié à leur convenance, les deux hommes le dégauchissaient. Ils rendaient ses faces régulières et parallèles entre elles de façon à avoir un parallélépipède rectangle, ou un cube, parfait. Pour cela ils se servaient soit de la scie passe-partout, soit du marteau taillant.
La pierre, une fois prête, Louis traçait, sur la face de référence, la forme à lui donner grâce à un gabarit qu’il avait confectionné. Ce dernier est un profil, une sorte de patron, fait sur un fin panneau de bois afin de tracer sa forme sur la pierre à l’aide d’une craie noire.

A l’aide d’un ciseau il suivait le trait afin de faire une ciselure. Cette dernière terminée, avec la pioche à pierre dure et le marteau taillant il faisait sauter toutes les parties de la pierre qui dépassaient le plan de la ciselure. Puis il régularisait sa taille à l’aide d’une boucharde ( Marteau à têtes carrées taillées en pointes de diamant), avant de finir le poli à la ripe.
Quand mon père décida de me mettre à la taille de pierres, Louis me prit en mains et me mit à la taille des moellons. Ce sont des petits blocs de pierre calcaire qui sont utilisés pour les murs en
élévation aussi bien que pour les soubassements à moitié enterrés, et les fondations.

C’est une taille qui n’est pas facile car la pierre étant très dure on ne peut utiliser que le ciseau ou le marteau taillant. Les coups doivent être très forts et, surtout, précis car la surface à travailler est assez restreinte. Le ciseau ou le taillant peuvent riper ce qui peut occasionner, vu la force de la frappe, un déséquilibre du bras qui peut se casser à cause de la forte vibration du choc.
C’est ce qui m’arriva au début de cet apprentissage, je me suis cassé la bras gauche. Louis et mon père, qui ont assisté à la scène, me réprimandèrent sérieusement et finirent par me dire que c’était le métier qui rentrait... J’ai pourtant été quelques temps à ne pas pouvoir tailler la pierre.
L’hiver, période où l’activité tourne au ralenti, mon père m’initiait à la géométrie et à la stéréotomie [9] (art de découper des volumes en volumes plus petits, formant un ensemble qui « tient debout ». Par exemple, la division d’un arc en plusieurs pierres) pour pouvoir réaliser, moi-même, mes gabarits. Pour cela je me servais de la règle, de l’équerre et du compas. Merci aux frères de m’avoir inculqué les bases suffisantes pour pouvoir exécuter sans peine ces travaux.
Avec le temps je faisais de réels progrès dans la taille, aussi dès lors je travaillais sur des blocs plus volumineux que les moellons. Blocs qui servent à réaliser les encadrements de portes, de fenêtres et de lucarnes. Là le travail doit être beaucoup plus rigoureux que pour la taille des moellons. Il faut que les surfaces soient parfaitement planes et d’équerre car les pierres sont juxtaposées et non liées par un mortier comme pour les moellons. Ma période d’apprentissage devait se poursuivre jusqu’à l’âge de 17 ans.
Il y avait le travail, bien sûr, mais aussi les loisirs qui ne pouvaient s’exercer que le dimanche. L’hiver, après les vêpres, souvent, avec ma mère, nous jouions aux dominos ou au jeu de l’oie pendant que mon père allait jouer au tarot au café de "La Sologne", au Chemin Neuf à proximité du pont GABRIEL. Parfois, Marguerite, la fille de Louis PRUDHOMME, qui avait mon âge, venait jouer avec nous. Elle était l’apprentie de ma mère pour devenir couturière.
L’été, mon principal loisir, toujours le dimanche, était la pêche à la ligne en Loire avec les copains du quartier. Cette rivière avait un véritable pouvoir d’attraction sur nous.
L’entreprise de mon père fonctionnait bien et faisait des bénéfices. Le 29 Septembre 1843, il acheta, pour la somme de 300 francs, une parcelle de vignes mesurant 5 ares 6 centiares, dans la commune de Vineuil, commune voisine de celle de Saint-Gervais, à proximité du cimetière. Sur l’acte de vente dressé par Maître TERRASSE, notaire à Blois, il était bien précisé que l’acquéreur ‘ a toute propriété du terrain et qu’il en pourra faire et disposer comme bien lui semblera’.
C’est bien ce qu’il fit puisqu’il arracha les vignes et transforma le terrain en carrière. La nature du sol était la même qu’à Saint-Gervais, c’était le même calcaire taillable, peut-être un peu plus tendre. Cette petite carrière lui permettait d’extraire des moellons. J’y allais relativement souvent pour tailler ces derniers.
Le 26 Septembre de cette même année, il acheta une boulangerie au 21 de la rue Croix-Boissée à proximité de l’église Saint Saturnin, et une ‘gâte’ ( remise servant de magasin), au 17 de la rue du Poirier qui est adjacente à la rue Croix-Boissée. Cet acte fut aussi dressé par maître TERRASSE et fixait le prix en une rente viagère et annuelle de 300 francs versée aux anciens propriétaires de la boulangerie, prédécesseurs du vendeur.
En outre, il s’engagea à construire, pour le vendeur, dans un délai de deux ans, un four à boulangerie ou à pâtisserie de trois mètres de diamètre au lieu indiqué par ce dernier, ce qu’il a fait plus tard. L’idée était de détruire ces vieux bâtiments pour, éventuellement, construire du neuf.
La crue de 1846 [10].
C’est un évènement qui m’a énormément marqué. J’avais 15 ans, je m’en souviens encore maintenant comme si c’était hier. Après un été très sec et chaud qui rendait le travail à la carrière pénible et harassant, s’installa un automne très pluvieux qui, à force, fit grossir la Loire.
Le 20 octobre au matin quand nous nous rendîmes, avec les autres ouvriers, au pont Gabriel pour attendre Pierre le voiturier, afin de nous rendre à la carrière, nous constatâmes une nette montée de la Loire. Cette dernière ne nous inquiéta pas car des hausses de niveau de cette nature sont relativement fréquentes à cette époque de l’année.
Quand nous sommes rentrés le soir, le niveau d’eau dépassait les 4 mètres à l’étiage du pont. Nous savions qu’à 5 mètres les flots passent le déversoir de la Bouillie situé entre la levée de l’éperon et celle des parcs. Ce déversoir a été établi en 1800 afin de protéger la ville. Les choses devenaient sérieuses.
Le 21 au matin la Loire continuait à monter. Le garde champêtre, le sieur CARREAU, nous apprit au son du tambour que la crue risquait d’être très forte et nous invitait à prendre toutes mesures de précaution.
Bien sûr nous ne sommes pas allés au travail, avec ma mère et mon père nous déménageâmes tout ce qui était transportable à l’étage. Le reste était surélevé le plus haut possible. Cela nous prit une bonne partie de la journée.
En milieu d’après-midi deux de nos voisins, les sieurs HABERT et BRISSARD, le premier, garde national, le second, pompier, vinrent à la maison pour nous dire qu’ils cherchaient des volontaires pour surveiller et aménager les points susceptibles d’être inondés.
Au bout d’un moment nous nous retrouvions, mon père et moi, avec une cinquantaine d’hommes. Nous installâmes sur tous les points névralgiques des pots de feu de façon à pouvoir surveiller la crue durant la nuit. Ce travail terminé, mon père et moi sommes retournés à la maison pendant que les gardes nationaux, les policiers et les soldats de la garnison restaient pour palier à toute éventualité durant la nuit.
Vers cinq heures du matin nous fûmes réveillés par le tambour du garde-champêtre. La levée des Acacias venait d’être rompue en trois endroits et l’eau commençait à envahir le faubourg et le quartier des jardiniers, Bas-Rivière.

En effet, au milieu de la nuit la Loire a dépassé, à l’étiage du pont Gabriel, les cinq mètres. L’eau s’est donc engouffrée dans le déversoir de la Bouillie. Au bout d’un moment la levée des Ponts-Chartrains fut rompue, les flots envahirent l’espace entre la levée des Acacias, la levée de Pingres et la route de Saint-Gervais qui était surélevée. Vers 3 heures du matin, il se produisit alors deux brèches, l’une sur la levée des Acacias à proximité des Ponts-Chartrains et l’autre sur la levée des Pingres.
Les flots envahirent donc, du côté de la première brèche, les jardins situés au sud de la rue de la Chaîne (rue qui borde la Loire en amont du pont Gabriel) et du côté de la seconde brèche, l’espace situé entre la levée des Pingres, la route de Saint-Gervais et la levée de Saint-Gervais qui borde le Cosson.
La Loire n’arrêtant toujours pas de monter, au bout de deux heures les flots firent deux brèches sur la route de Saint-Gervais, l’une à proximité de la levée des Pingres et l’autre au niveau du pont du Cosson qui fut affouillé à 5mètres de profondeur et dont deux arches sur trois se sont écroulées.
S’ensuivit alors deux brèches sur la levée des Acacias, l’une au niveau de l’octroi, l’autre plus à l’ouest. A partir de ces deux brèches l’eau envahit le côté ouest du faubourg et le quartier de Bas-Rivière.
Une heure environ après l’appel du garde-champêtre, c’était l’affolement général. Les habitants de Bas-Rivière évacuèrent leurs bêtes qui furent dirigées de l’autre côté de la Loire vers le haut du faubourg Neuf.
La rue Croix-Boissée qui est en contre bas de la Loire fut vite submergée des deux côtés. Le Chemin Neuf qui est un peu plus en hauteur, lui, ne le fut pas entièrement.
Avec les hommes du quartier, les gardes nationaux et les soldats de la garnison, mon père et moi nous nous sommes activés pour porter secours, rue Croix-Boissée, aux familles qui habitaient au rez-de-chaussée des maisons.
Les mariniers se transformèrent en sauveteurs avec leurs fluteaux. Ils allèrent récupérer, à Bas-Rivière, les gens qui s’étaient réfugiés sur le toit de leur maison. Dans le même moment la Loire ralentit sa montée. A l’étiage du pont elle s’arrêta à 7 mètres 50.
Nous, nous avions de la chance car notre habitation était située à toute proximité du Chemin Neuf et du pont, ce qui fait que nous étions plus en hauteur par rapport à la rue Croix-Boissée et à la rue de la Chaine, de l’autre côté. Aussi mon père ayant dressé un petit muret devant notre porte d’entrée et notre porte de jardin, nous n’avons pas été inondés bien qu’il y eut eu 5 à 10 centimètres sur la chaussée . Mes grands-parents maternels qui habitaient rue de la Chaine, eux, ont dû évacuer.
Les malheureux sinistrés, démunis de tout, furent dirigés vers l’autre rive de la Loire où ils furent accueillis au bureau de bienfaisance, à l’école chrétienne, à l’école mutuelle, à la caserne et même à l’évêché. Le lendemain, la Loire restait haute, c’était toujours la désolation dans le quartier. La décrue se faisait lentement. Il a fallu attendre quelques jours pour que l’eau s’en aille totalement. En Vienne et au bas Saint-Gervais, 600 maisons ont été inondées.
Une fois la décrue terminée, nous sommes repartis travailler à la carrière. Le matin toute l’équipe se rendit route de Saint-Dyé chez Pierre, le voiturier, qui nous emmena aux "Closeaux" en passant par Vineuil.
En effet nous ne pouvions pas prendre la route habituelle car le Chemin Neuf était avarié sur plus de 300 mètres, la route de Saint-Gervais, elle, rompue en deux endroits, au niveau de l’octroi et à l’encontre de la levée des Pingres. En plus le pont sur le Cosson était partiellement détruit, il ne lui restait qu’une arche.
Quelques souvenirs de ma jeunesse
L’épidémie de choléra de 1849
A partir de 1847, à l’âge de 16 ans, je suis devenu ouvrier à part entière dans l’entreprise de mon père. Dès lors, je taillais la pierre à la carrière et sur les chantiers. Le travail ne manquait pas.
1848 est l’année du passage de la monarchie constitutionnelle à la IIe république. Je n’ai pas de souvenirs particuliers de cet évènement. Mon père ne s’intéressant pas à la politique, seule son entreprise comptait, moi même je n’y apportais guère d’importance. A Blois il n’y a pas eu, à ma connaissance, de crise comme, parait-il, à Paris.
Le 21 Mars 1849, Mon père vendit à la ville de Blois le terrain de 19 ares 56 centiares situé rue Croix-Boissée pour la somme de 300 francs. C’est le terrain sur lequel se trouvait la boulangerie achetée en 1844. Boulangerie que nous avions détruit entre temps. L’acte de vente fut dressé par maître LEMAIRE, notaire à Blois.
Le 6 juillet 1849 fut le début d’une période calamiteuse qui dura près de trois mois. Ce fut la propagation du choléra à Blois [11]. Notre quartier de Vienne fut le premier touché. C’est André DELAUNEY qui fut le premier contaminé. Tout le monde connaissait bien ’Dédé’ en Vienne, c’était notre cantonnier. Il était aussi connu par sa fréquentation assidue des cabarets du quartier.
Le 6 juillet, donc, dans l’après midi, il fut pris d’un grave malaise. Il dût arrêter son travail et rentrer en son domicile, rue des Chalands. Le docteur BLAU se rendit à son chevet. Le diagnostic qu’il porta à première vue le rendit circonspect. Il demanda l’avis de ses collègues. C’est bien ce qu’il pressentait, c’était le choléra. Malgré les soins prodigués, ’Dédé’ devint cyanosé au bout de trois heures et mourut dans la nuit.
L’épidémie se propagea rue des Chalands aux domiciles contigus de celui du cantonnier pour aller de jour en jour envahir une grande partie du quartier. En juillet on déplora 23 décès, c’est la rue Croix-Boissée qui fut la plus concernée on en en compta 6. En août on en évalua 35 dont 10 dans la rue des Chalands et 20 dans la rue Croix-Boissée. En septembre le nombre total de cas létaux tomba à 13 dont 5 dans la rue Croix-Boissée [12].
De très nombreuses familles furent impactées par la maladie. Heureusement toutes n’ont pas eu à déplorer de décès. Dans notre rue, la rue du Point du Jour, il n’y a eu qu’un cas létal, Michel MENANT, le cabaretier. C’est chez lui que, souvent, nous jouions aux cartes le dimanche, après les vêpres.
En ce qui nous concerne, nous avons eu de la chance, mon père et moi nous avons été contaminés par une forme atténuée de la maladie que les médecins nommaient ’cholérine’. Sans traitement cette dernière pouvait se transformer en choléra.
Elle avait souvent l’aspect d’une gastro-entérite non fébrile. Elle se différenciait de ce dernier par l’absence de vomissements et de crampes. Dés les premiers signes symptomatiques le docteur BLAU nous a prescrit un remède à base de chlorure de calcium et de chlorure d’oxyde de sodium.
Et surtout, il nous a recommandé de nous tenir au chaud et aussi de bien aérer nos pièces de façon à empêcher toute humidité. Cette dernière, nous dit-il, est le lit de la maladie.
Comme je vous l’ai dit, ce sont la rue des Chalands et la rue Croix-Boissée qui ont été le plus impactées. Ce sont des rues dont les bâtiments sont très anciens, certains, parfois, datent du 16e ou 17e siècles. Depuis la crue de 1846 ils sont restés très humides, beaucoup pensent que c’est cette humidité qui a favorisé la progression de la maladie.
Au plus fort de la crise, poussés par le deuil et l’inquiétude, les habitants de Blois, et ceux de Vienne en particulier, pressèrent l’évêque de Blois, Monseigneur FABRE DES ESSARTS, à reprendre le pèlerinage de Notre Dame de Aydes, interrompu en 1830, pour implorer la Vierge d’arrêter l’épidémie.
Une procession de toute la ville eut lieu en Vienne le jour de l’Assomption de la Vierge, le 15 août. Je me rappelle encore ce souvenir inoubliable. Nous étions à peine rétablis, mon père et moi, ma mère insista pour que nous assistions à la cérémonie.
Après les vêpres, fortes en émotions, dites par monseigneur l’évêque, lui même, dans notre église de Saint-Saturnin, le cortège s’ébranla pour la procession dans les rues du quartier. Une foule conséquente le suivait, mené par le prélat [13].
Ce dernier était suivi par les prêtres et leurs servants des trois paroisses de Blois, Saint-Saturnin, Saint Nicolas et Saint Louis. Suivaient ensuite les différentes confréries dont celle des mariniers dont quatre membres portaient sur leurs épaules une sorte de brancard sur lequel était posée la statue de Notre Dame des Aydes.
La procession défila, chantant des cantiques, dans différentes rues autour de Saint-Saturnin, notamment celles les plus touchées par l’épidémie comme les rues des Chalands, Croix-Boissée, Clérancerie, etc...
Arrivé à l’angle de la rue du Poinçon Renversé et de la rue du Poirier, le cortège s’arrêta et l’évêque bénit une statue de la Vierge qu’on fit, plus tard, déposer dans une niche pratiquée à cet effet dans l’encoignure de la rue.

Ensuite le cortège rejoignit Saint-Saturnin pour y déposer dans sa chapelle la statue de Notre-Dame des Aydes. Puis les gens se dispersèrent dans un silence religieux, on pouvait voir sur leur visage une expression particulière qui reflétait à la fois la tristesse, bien sûr, et la satisfaction d’avoir mis tous leurs espoirs dans la bienveillance de leur bienfaitrice.
Cette bienveillance se concrétisa petit à petit, le nombre de décès commença à diminuer le 25 Août pour finir par s’annuler un mois plus tard.
Notre déménagement avenue de Saint-Gervais (anciennement Chemin Neuf)
Le 1er Novembre 1850, mon père acheta un terrain mesurant 10 ares 14 centiares, en Vienne, avenue de Saint-Gervais. L’acte est dressé par maître LEMAIRE, notaire à Blois. Il a l’intention d’y construire notre maison.
A cette époque l’avenue de Saint-Gervais commence à être bordée par un certain nombre de maisons, souvent de beaux bâtiments car c’est maintenant l’artère principale de Vienne.
Dès l’achat du terrain, commence la construction de la maison. J’y participe activement, je pose les moellons et surtout je taille et pose les pierres d’encadrement des portes, des fenêtres et des lucarnes. La maison est terminée à l’automne 1851.

Cette maison est donc située au N°15 de l’avenue de Saint-Gervais. Elle comporte un rez-dechaussée, un étage et un grenier ouvert par deux lucarnes. Derrière il y a un jardin de près de 7 ares. C’est une maison de type bourgeois. Mon père voulait qu’elle corresponde à sa situation sociale. Elle comporte quatre pièce habitables, deux au rez-de-chaussée et deux à l’étage. Toutes les pièces contiennent une cheminée et une fenêtre. Ces dernières, à l’étage, sont garnies d’un balcon en fer forgé.
Nous quittons donc la rue du Point du Jour pour nous installer dans notre nouvelle demeure. Quand je dis nous, ce sont mes parents, mes deux sœurs Léontine et Désirée, mon petit frère Clovis et moi même.
Cela nous changeait de la petite maison du N°2 de la rue du point du jour où nous étions un peu à l’étroit. Mes parents ont gardé nos anciens meubles, mais en ont acheté de nouveaux comme, entre autres, une magnifique armoire en noyer que j’ai hérité au décès de ma mère.
Mon recrutement dans l’armée
Le conseil de révision
C’est pendant cette même année 1851, l’année de mes 20 ans, que j’ai passé le conseil de révision à l’hôtel de ville de Blois, de l’autre côté du pont. L’année précédente, au mois de février, j’avais participé au tirage au sort, toujours à la mairie de Blois. J’avais tiré le numéro 108 qui me mettait en 108e position sur la liste du contingent du Loir et Cher.
C’était un numéro bas, il y avait donc de très de grandes chances que je sois recruté pour 5 ans, car après le conseil de révision j’allais certainement descendre de rang à cause des inaptes au service qui peuvent se trouver devant moi. Ce sont les numéros les plus forts qui étaient exemptés ou ne faisaient qu’un an de service.
Cela ne me chagrinait pas car, comme pour beaucoup de jeunes de mon âge, le service militaire était un passage obligatoire qui nous ouvrait de nouveaux horizons et nous permettait de nous aguerrir.

Je passe donc le conseil de révision en décembre 1851. Louis-Napoléon BONAPARTE venait d’être proclamé président de la République. Quand j’arrivais devant l’hôtel de ville, vers 8 heures du matin, il y avait déjà foule sur le perron. Nous attendions que le garde champêtre nous appelle par numéros avec sa voix de stentor. Pour patienter je discutais avec quelques gars que je connaissais plus ou moins. Vers 10 heures c’était à mon tour, le numéro 108.
Je suis entré dans une pièce où un gendarme vérifia mon identité, le nom de mes parents, mon adresse, mon métier et le numéro que je tennais à la main. Ensuite il me fit déshabiller entièrement. Je ne fus pas surpris, je connaissais la procédure. Puis il me fit entrer, toujours mon numéro à la main, dans une grande salle, probablement celle qui servait aux mariages.
Au milieu de la salle trônait une toise, devant elle, il y avait une grande table derrière laquelle se tenait, sous le portrait du prince président et deux drapeaux tricolores, tout un aréopage. Il s’agissait du préfet, Monsieur SOHIER, entouré d’un conseiller général, d’un conseiller d’arrondissement, d’un officier général, dont je ne me rappelle plus le nom, d’un membre de l’intendance, du commandant de recrutement et d’un médecin militaire. Monsieur PORCHERGUIBERT, président de la commission municipale de la ville de Blois, était présent mais seulement à titre consultatif au sujet de tel ou tel conscrit.
Le médecin me plaça immédiatement sous la toise, d’une voix forte il cria à la cantonade ma mensuration, 1m 675 mm. Tout l’aréopage acquiesça de la tête, la taille minimum étant de 1 m 540 mm. Puis il me fit ouvrir la bouche, probablement pour voir l’état de mes dents, il ne fit aucun commentaire. Puis il m’inspecta sous toutes les coutures pour finalement déclamer : "bras gauche fracturé, bon pour le service ! " [14].
Le préfet se tourna vers monsieur PORCHER-GUIBERT et lui demanda s’il avait quelque chose à ajouter à mon sujet. Sur le signe négatif de ce dernier, il se tourna vers moi et me dit : " Félicitations jeune-homme, vous avez le N°98 sur la liste définitive de recrutement, vous recevrez bientôt votre feuille de route, vous pouvez aller vous rhabiller".
Je m’exécutai alors et sorti de la mairie. Dehors c’était un peu la bousculade. Les conscrits étaient harcelés par des vendeurs de babioles ; rubans tricolores, gibus de conscrits, etc... Je sacrifiai à la tradition et achetai rubans et gibus sur lequel je fixai mon numéro.

Au bout d’un moment, quand tout le monde était passé, nous nous sommes regroupés, nous les aptes au service, et avons défilé dans les rues de Blois en un cortège joyeux et bruyant sous, parfois, les applaudissements de passants. La soirée se terminant dans différents cabarets de la ville.
Les lendemains du conseil se passèrent dans l’attente de la réception de la feuille de route. Mon quotidien se partageait, comme avant, entre le travail, la semaine, et les loisirs, le dimanche après les vêpres. Mes distractions ne sont plus les mêmes que lors de mon adolescence.
Souvent, le dimanche après midi, avec une petite bande de copains, nous allions danser dans différentes guinguettes du bord de Loire, l’été. L’hiver, nous allions au ’ Dauphin’, avenue Saint-Gervais. Notre préférée était l’auberge de la ’Creusille’, quai de la Chaîne. Là nous chaloupions avec les jeunes filles du quartier qui, souvent étaient chaperonnées par un frère ou un cousin.
Dans notre petite bande il y avait Louis PRUDHOMME, le fils du tailleur de pierres de mon père. Il était parfois accompagné par sa sœur Marguerite, l’ouvrière couturière de ma mère. Je connaissais bien Marguerite, c’était une amie d’enfance, je dois avouer que j’avais déjà, à l’époque, un faible pour elle.
C’était une jeune fille agréable à regarder, une belle blonde aux yeux bleus. J’aimais bien sa personnalité. Elle était toujours aimable, gracieuse, sensible, elle rougissait quand elle était touchée par un compliment. De plus elle était humble et réservée. Parfois, par contre, elle manquait de confiance en elle.
En un mot, vous avez compris, j’étais devenu, avec le temps, amoureux d’elle. Je pense que je ne lui étais pas indifférent, car quand je l’invitais à danser elle acceptait toujours avec le sourire. Mais je n’ai jamais osé lui déclarer ma flamme.
Lorsque j’ai reçu ma feuille de route en juin 1852, j’ai senti chez elle comme un mélange d’inquiétude et de tristesse. Cela m’a conforté dans le fait que je ne lui étais pas indifférent...
Je devais donc rejoindre le 1er Régiment de Génie, en garnison à Arras, le 3 juillet 1852. Ce que je fis après un départ sans trop d’effusions.
Le 1er Régiment du Génie à Arras
Conformément à ma feuille de route, je me rendis au château où casernait le 72e RI. On me fit monter dans un fourgon hippomobile qui faisait partie d’un convoi de trois véhicules. Je ne me souviens pas beaucoup de ce voyage car dans le fourgon on ne voyait rien de l’extérieur, je passais mon temps à discuter avec mes voisins et à dormir. Le trajet dura deux jours nous nous arrêtions dans des garnisons pour manger où déposer des conscrits. Nous dormirent dans une d’elle avant de reprendre la route.
Nous arrivâmes le 3 juillet 1852 au quartier des ’Tourelles’, appelé quelques temps plus tard quartier ’SCHRAMM’, situé dans la citadelle de la ville. Là nous nous installons dans le casernement du 1er RG. S’ensuit alors l’incorporation proprement dite, où je suis assujetti du matricule 3891, la visite médicale succincte et la réception du paquetage. Je suis ensuite affecté à la 2e Compagnie du 1er Escadron.
Peu de temps après mon incorporation, le 2 décembre 1852, ce fut la proclamation du second Empire. Louis Napoléon Bonaparte, Prince Président, devenait Napoléon III Empereur des Français pour un peu moins de 20 ans.

Je suis resté dans cette caserne tout le long de mon service tout en changeant 4 fois de compagnie. Je n’ai pas de grands souvenirs de cette vie de garnison, monotone et parfois ennuyeuse, passée entre entraînements militaires, manœuvres et quartiers libres dans la ville d’Arras avec des camarades vite perdus de vue après ma libération. Cette dernière a eu lieu le 31 décembre 1856, le certificat de bonne conduite en poche.
J’avais du temps pour correspondre avec ma famille, c’était Marguerite qui écrivait les réponses à mes lettres car mes parents ne savaient pas le faire. Mes permissions, bien sûr, je les passais à Blois.
Le décès de mon père
C’est au cours de l’une d’elles, en mars 1853 que le drame arriva. Comme à mon habitude, je passais ma permission sur les chantiers de mon père pour donner un coup de main. Cette fois là c’était un chantier au hameau ’Hôtel Pasquier’ au quartier des Grouets, sur la rive droite de la Loire à l’extrémité ouest de Blois.
Ce hameau est composé de quelques maisons qui entourent un vieux manoir qui a donné son nom au lieu dit. C’est une de ces maisons que mon père, avec ses ouvriers bien sûr, était entrain de construire. Le chantier avait pris un très gros retard à cause de l’hiver rigoureux qui a sévit du mois de novembre jusqu’à fin février.
Mon père a donc profité de mon séjour pour accélérer le chantier. Lui même a mis la main à la pâte alors que d’habitude il ne faisait que superviser. Il fallait travailler vite car le propriétaire commençait à s’impatienter sérieusement et menaçait de ne pas payer.
Le troisième jour, le 22 mars, alors qu’il montait sur l’échafaudage, tenant sur ses épaules une palanche chargée de deux seaux de mortier que le mortelier lui avait préparé, en haut de l’échelle, il glissa sur un barreau et, entraîné par la charge, il bascula en arrière et s’effondra sur le sol, 4 mètres plus bas.

Nous nous sommes tous précipités vers lui, le pauvre était mal en point, sa tête avait heurté un tas de moellons, il ne pouvait plus bouger . Nous le transportâmes sur le chariot et je le ramenais à la maison. Malgré l’intervention du docteur BLAU, il eut son dernier soupir à 5 heures du soir. Il avait 44 ans...
Ce fut un évènement dramatique pour toute la famille et pour moi en particulier. Je vénérais mon père, c’était pour moi l’exemple à suivre. Ma mère se retrouvait seule avec encore trois jeunes enfants, Léontine, Désirée et Clovis, respectivement de 16, 12 et 9 ans. Étant à l’Armée je ne pouvais pas l’aider beaucoup, mais c’était une femme courageuse. je savais qu’avec son métier de couturière elle allait s’accrocher et arriver à s’en tirer.

L’inhumation eut lieu à l’ancien cimetière de Vienne, rue Clérancerie, après une messe dite par le curé ARCANGER-DROUAULT. Il y eut beaucoup de monde qui accompagnèrent le défunt. Il était connu et apprécié comme entrepreneur. Il y avait ses ouvriers, bien sûr, et aussi beaucoup de monde du quartier.
Peu après, ma mère dût vendre, entre autres, la carrière de Saint-Gervais et celle de Vineuil. Le produit de ces ventes lui permit de régler le passif de l’entreprise de mon père qui s’élevait à environ 2 900 francs.
L’inondation de 1856 [15].
Après le décès de mon père je retournais à ma vie de garnison, à la caserne à Arras. Marguerite continuait à me donner des nouvelles d’elle et de ma famille. C’est ainsi qu’en 1856 elle me raconta les terribles moments qu’ils durent passer en mai et en juin de cette même année lors de la terrible crue de la Loire qui dévasta les parties basses de la ville et particulièrement le faubourg de Vienne.
D’après ses récits et les coupures du ’Journal du Loir et Cher’ qu’elle joignait à son courrier, j’avais pu me faire une idée précise des moments qu’ils ont passé.
A la différence de la crue de 1846, la montée des eaux de la Loire a commencé après 6 mois de pluie continue. A partir du 15 mai il y eut 3 crues consécutives, la première, ce même 15 mai, l’étiage du pont indiqua 4,90 m, la seconde, le 20 mai l’eau monta à 5,22 m et enfin la troisième, le 3 juin, fut la plus terrible puisqu’elle culmina à 7,20 m.
Marguerite me racontait dans ses lettres ces terribles journées du 3 et 4 juin. En début d’après-midi du 3, vers 2 heures, une partie des habitants de Vienne, dont elle et son frère Louis, qui s’activait à consolider un batardeau destiné à préserver le faubourg des eaux du déversoir qui ne cessaient de monter depuis le milieu de la nuit, virent l’étiage descendre de 25 à 30cm. Ce fut, m’écrivait elle, l’affolement général, car riches, si l’on peut dire, de l’expérience de 1846, ils supputèrent l’effondrement d’une digue en amont de Blois, probablement celle de Montlivault, comme lors de la première crue centennale.
A partir de ce moment, la panique s’empara de tout le monde. Les cloches de Saint-Saturnin sonnèrent le tocsin et l’Hôpital Général fut évacué. Les habitants, dont Marguerite et ma famille, commençaient à partir vers la ville où on les accueilli au château et à l’évêché. Les miens furent hébergés dans ce dernier.
Effectivement la digue de Montlivault céda quelques temps après et les flots dévastateurs déferlèrent le long des vallées des villages de Saint-Claude et de Vineuil. S’ensuivit, peu de temps après, la rupture de la levée des Pingres à hauteur de l’octroi.

Les flots se mêlant à ceux du déversoir qui étaient tout aussi impétueux et qui venaient de rompre le batardeau qui protégeait le dit déversoir, la levée des Acacias ne put résister et s’écroula en grande partie, formant une énorme brèche où s’engloutirent les flots qui envahirent les maisons du faubourg, à certains endroits, à une hauteur considérable.
De toutes parts on demandait du secours. Les barques sillonnaient les rues basses. Les gendarmes, sur pied depuis 72 heures, se précipitèrent pour sauver femmes et enfants. Ils le firent aussi bien à la nage qu’à cheval. Dans la soirée l’eau stagna pour, ensuite, commencer à baisser assez rapidement.
Le lendemain à 10 heures du matin, la Loire a décru de plus d’un mètre, l’étiage marque 5,90 m alors que la veille il marquait, au plus haut, 7,20 mètres. Mais les flots étaient aussi impétueux. Les rues basses de Vienne étaient parcourues par des torrents qui entraînaient murs et clôtures. On passait en bateau sur les haies et les murailles.
Les sauvetages continuèrent, mais dans plusieurs maisons il se faisaient avec difficulté. Le ’journal du Loir et Cher’ relata la mésaventure de monsieur DE SAMPIGNY, conseiller de préfecture. Accompagné du commissaire de police, monsieur SUZANNE, et de deux habitants de Vienne, ils s’étaient avancé en barque au secours d’une famille en détresse. L’embarcation, mal dirigée, heurta un mur et se fracassa, laissant les sauveteurs au milieu du torrent. Les deux premiers purent s’accrocher au mur et être secourus. Les seconds disparurent sous l’eau mais purent, plus loin, s’accrocher à une tonnelle et attendre là les secours.
D’après Marguerite, des actes héroïques comme celui-là il y en eut plein, tous les habitants de Vienne qui le pouvaient ont participé au secours.
Les jours suivant, la Loire a continué sa décrue et retrouva son lit originel. Les réfugiés ont pu retrouver leurs habitations aux sols envahis par la boue et toutes sortes de déchets... Ma mère, mes sœurs et mon frère purent réintégrer le 15 de l’avenue de Saint-Gervais après leur exil dans les hauts de la ville.
Marguerite me disait dans ses lettres qu’ils avaient été très bien traités grâce à la sollicitude de l’administration et de l’évêché où ils ont été hébergés Ils n’ont manqué de rien que ce soit pour la nourriture comme pour le couchage.
La maison, elle, a tenu le coup, seuls les murs qui entouraient le jardin ont été partiellement détruits. Les sols du rez-de-chaussée étaient couverts d’une épaisse couche de boue. Les meubles qui n’ont pu être évacués, vu le départ précipité, ont presque tous été submergés, mais beaucoup restaient récupérables.
Je ne pus avoir une permission qu’en juillet. Les stigmates de la crue étaient encore bien visibles, c’était apocalyptique. Devant un tel spectacle , je ne pouvais imaginer qu’il n’y avait pas eu de victimes. L’avenue de Saint-Gervais présentait de nombreux ravinages qui, parfois, atteignaient 6 mètres de profondeur. Pareil pour la route basse de Paris qui longe la Loire en amont du pont GABRIEL.
La dizaine de maisonnettes qui se trouvaient dans l’île des Ponts-Chartrains, appelée parfois ’l’île des fainéants’, allez savoir pourquoi, ont toutes été détruites et leurs jardins complètement ravagés. La levée des Acacias, elle, avait presque totalement disparu. Partout il y avait encore des tas de déchets, arbres arrachés, débris de charriots, des planches, des tonneaux et toute sorte d’autres objets qui n’avaient pas encore pu être ramassés.
Après cette permission, je retournais à ma vie de garnison à Arras jusqu’à la fin de l’année. J’ai été libéré le 31 décembre 1856. Le 1er janvier 1857, je fus enfin auprès des miens."
A suivre...
Remerciements : un grand merci à Odile JUBLOT pour son aide précieuse dans la rédaction de ce récit.