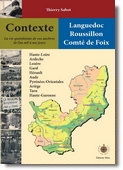Comment croire que nous sommes déjà au troisième dimanche du printemps [1], tant le froid glace encore les os à travers l’épaisse couverture de chanvre tissé, dans laquelle Anne s’est entortillée avant d’emprunter le chemin du bas Vezin [2].
Comment croire que nous sommes déjà au troisième dimanche du printemps [1], tant le froid glace encore les os à travers l’épaisse couverture de chanvre tissé, dans laquelle Anne s’est entortillée avant d’emprunter le chemin du bas Vezin [2].
Ce mois de mars n’a été qu’une alternance de giboulées glacées, de neige fondue et de gelées nocturnes durcissant la terre à ne pouvoir la travailler. Cet hiver 1789 restera le plus rude, dans les mémoires de ceux qui survivront à la famine qui sévit partout dans les campagnes.
Après la sècheresse torride et les grêles de l’été ruinant les récoltes, le prix du blé a doublé sur les terres du duc de Penthièvre [3].
Les huches sont le plus souvent vides, quand il faut trois livres [4] de pain en moyenne par jour pour nourrir chaque bouche à la maison, et davantage encore dans la froidure.
Le prix du travail d’une journée de brassier [5] ne suffit plus à payer le grain.
Ainsi vont les pensées de celle que l’on nomme, la Morinays de Pontchâteau.
Assurant lentement chacun de ses pas pour éviter la glissade, elle se rend comme chaque semaine à l’église Saint-Pierre [6], distante d’un quart de lieue [7] au cœur du petit bourg.
À trente-deux ans, déjà vieillie, Anne a l’allure volontaire des femmes dont on devine qu’elles se doivent assumer les rudesses de la vie.
Tôt mariée [8], veuve la même année, elle n’a pas retrouvé d’épousé. Elle jouit pourtant d’une solide réputation de travailleuse acharnée. Mon frère lui a confié l’exploitation de la métairie dite « de Pontchâteau [9] ». Dure avec elle-même, toujours à la tâche, il ne lui reste pas le temps de chercher un homme.
Élancée, droite dans son corps comme dans sa tête, le visage émacié aux traits sculptés, le regard pénétrant tiré par un chignon poivre et sel serré sous le capot [10] gris, elle est le portrait de sa mère, dont elle assure le rôle depuis plus de vingt ans déjà.
Jacquette, « la Rouxel » comme on l’appelait, est morte à l’âge de sa fille aujourd’hui, après avoir donné naissance à huit enfants Morinays, dont trois seulement vivront adultes. Anne est l’aînée du premier mariage de son père.
Elle vit à Pontchâteau, avec ses deux frères qu’elle apprit à élever alors qu’elle avait tout juste dix ans. Joseph, vingt-huit ans, et Simon, vingt-cinq à présent, sont toujours célibataires et à sa charge.
La métairie peine à nourrir la fratrie, quand il faut acquitter le cens [11] en argent et le champart [12] en nature, les impôts dus au seigneur du lieu [13].
Le propriétaire exige une rente sur la terre concédée, en plus du prélèvement qu’il opère sur les récoltes, sans se préoccuper de savoir si elles sont suffisantes. Viennent s’ajouter, la taille royale [14], la dîme [15] du clergé, les corvées [16], autant de droits féodaux et seigneuriaux qui écrasent les paysans les plus courageux, ces « pieds gris » qui ne portent pas de chaussures comme les gens de la ville mais des sabots paillés.
Anne est une « pieds gris » qui, en ces temps de disette, reste une privilégiée pour les journaliers [17] et la masse des mendiants, des vagabonds, des chemineaux [18], ces voyageurs sans ressources ni domicile fixe, errant en petites bandes par tous les chemins.
Dans le raidillon de la Longrais [19], Anne s’arc-boute, pour résister au blizzard dévalant la pente après avoir pris de la vitesse sur le plateau du haut, balayant tout sur son passage. C’est la dernière côte, avant la longue ligne droite qui mène à découvert jusqu’aux premières maisons de Vezin ; le Guenzen [20], comme disent encore les vieux Bretons, qui prétendent que ce lieu était planté d’arbres à l’époque de Jean de la Motte [21].
L’air est vif et tranchant, à crevasser la peau pourtant si bien tannée par le travail aux champs. Les sifflements stridents de la bise enflent jusqu’à devenir des sortes de hurlements du vent, alternant comme de longues plaintes, venant et courant par tout le pays gémissant.
Arrivé sur le plat, le clocher de Saint-Pierre guide la marcheuse de plus en plus courbée, vent debout.
À main droite, on perçoit les volutes des premiers feux de la capitale provinciale, à une lieue d’ici.
Même si la distance n’est pas très grande, l’écart est immense entre la misère des cultivateurs de la campagne bretonne et les conditions de vie des notables, ces bourgeois qui détiennent les trois quarts des richesses de la ville.
Et pourtant, la proximité de Rennes permet à Vezin de vivre mieux que la plupart des villages de la Bretagne profonde.
Enfin parvenue à l’abri, protégée par les premières masures bordant le seul chemin de pierres du bas Gwezin [22], Anne peut reprendre son souffle et continuer sa route à pas mesurés.
Passant entre les maisons qui se resserrent les unes contre les autres comme pour se réchauffer, elle devine parfois, une présence aux aguets, masquée sournoisement par des volets entrouverts.
Colleu, debout sur son perron, l’interpelle.
— Ça ira ?
— Ah ! ça ira, père Colleu.
— I s’ra dit qu’la Morinays n’manquera jamais l’appel de Pierre Ruault [23]
…
— Surtout pas celui-là !… Bien que je n’aie aucun droit d’y participer ! Vous n’étiez pas à la fabrique [24]de lundi passé ?
— Non, mais j’ai lu l’affiche que le curé a posée sur la porte de l’église.
Alain MORINAIS