Bien avant l’avènement de Louis XVI, une des lointaines aïeules paternelles de Jean était convaincue de la noblesse de l’art que l’on pratiquait dans l’atelier familial de serrurerie. Tant et si bien qu’au moment où, clouée au lit par la maladie, elle comprend que sa vie est compromise à court terme, elle fait promettre à son mari devant notaire d’employer les biens qu’elle laisse en héritage pour assurer à leurs six enfants encore mineurs non seulement le gîte et le couvert jusqu’à leur vingtième anniversaire, mais aussi l’apprentissage d’un métier. Pour les quatre garçons, ce sera le métier de serrurier comme leur père, pour les deux filles un métier de couture ou de lingerie ou, à défaut, celui de leur choix [1]. Propos d’une grande dame et d’une femme en avance sur son temps qui reconnaît expressément à ses filles le droit de choisir un métier.

- La donation de 1689
Lorsqu’il quitte sa Bourgogne natale, Jean Buret n’a encore que seize ans. Depuis la mort de son père, il a pris conscience que son avenir dans l’atelier familial est compromis à plus ou moins court terme. En ces temps d’agitation prérévolutionnaire, la riche clientèle des ferronniers et serruriers d’art a d’autres priorités que l’embellissement des habitations par l’installation de ferronneries de prix aux portails et aux balcons. En revanche, le frère aîné Jean-Baptiste, a priori sans état d’âme, a pris la suite de son père.
Jean est serrurier et n’entend pas changer de métier. Il n’a dès lors pas d’autre solution que d’aller chercher ailleurs un atelier dans lequel il pourra utiliser et améliorer les compétences acquises en fréquentant l’atelier familial depuis son plus jeune âge. Dans son périple d’un atelier à l’autre, d’une ville à l’autre en direction du Sud, Jean pose finalement sa besace à Marseille. On est en 1782, la ville en plein développement connaît une grande activité en rapport avec celle du port et avec les opérations de construction immobilière, dans les nouveaux quartiers de Paradis, Saint-Ferréol, et Rome notamment. Le besoin de main d’œuvre qualifiée et de professionnels, l’existence d’une clientèle fortunée, telles sont quelques-unes des informations qui ont vite fait de se répandre dans le petit monde des artisans, serruriers et autres ferronniers.
Pendant son apprentissage de ville en ville, Jean a appris aussi le mode d’emploi de la vie de compagnon. Dès son arrivée à Marseille, il se rend directement rue Lapalud chez celle qu’on appelle la mère des serruriers. C’est elle qui est missionnée par le corps des serruriers de la ville pour accueillir les nouveaux arrivants et leur trouver à la fois un atelier susceptible de les embaucher, et un gîte. Même si l’on compte dans la ville une cinquantaine de boutiques de serruriers comme on disait, c’est dans le quartier des Fabres [2] que Jean va trouver très vite à s’embaucher et à loger sur place avec les autres garçons de l’atelier, comme c’était alors l’usage. Dans la rue des Fabres, il existe deux grands ateliers, celui des maîtres-serruriers Joseph Vachier et Jean-Baptiste Gabriel ; l’un comme l’autre emploie au moins une dizaine de garçons venus de tous les coins du Royaume et même de contrées extérieures. Dans la rue voisine de l’Étrieu [3], plus modeste, l’atelier du maître et prieur Pierre Carbonel a un effectif réduit.

- Extrait de la liste des serruriers.
On peut penser que Jean-Baptiste Gabriel a été séduit par le profil professionnel du jeune bourguignon et n’a pas hésité longtemps avant de l’embaucher. Et deux ans plus tard, le frère aîné Jean-Baptiste vient rejoindre Jean cadet comme on l’appellera désormais. L’expérience de son jeune frère déjà familier de la place, de la clientèle locale, de la manière de vivre et d’appréhender la société marseillaise, avait fini de vaincre les réticences de celui-ci au point d’envisager finalement de quitter le pays natal. Lui aussi va trouver tout de suite une place dans l’atelier de la rue des Fabres et logera avec son frère. Mieux encore, il n’attendra pas longtemps avant de séduire la fille de la maison qu’il épouse à l’automne 87. Et pour faire bonne mesure, François le petit frère, le troisième de la fratrie, débarque à son tour accompagné de la mère ayant fait le voyage depuis la lointaine Bourgogne pour voir ses trois fils réunis.
Avant d’être pleinement intégrés dans le corps des serruriers de Marseille et être autorisés à ouvrir leur propre boutique, Jean-Baptiste l’aîné et Jean cadet devaient faire la preuve de leur compétence. Comme c’était alors le cas dans la quasi-totalité des corporations de maîtres artisans, les maîtres-serruriers de Marseille disposaient de l’entier pouvoir de choisir les membres de leur corporation. À cet effet, les postulants étaient tenus de réaliser un chef d’œuvre, c’est-à-dire une œuvre de serrurerie reconnue comme tel par un jury d’experts. Une fois franchie cette étape, ils devraient alors jurer de respecter toutes les règles et conventions en usage chez lesdits maîtres-serruriers, ainsi que les règlements de police correspondant. La qualification de maître-serrurier du corps des maîtres-serruriers de Marseille leur serait alors accordée. On ignore quel a été chef-d’œuvre respectif des deux jeunes bourguignons – la Révolution est passée par là – en revanche, il est établi qu’ils ont prêté serment au corps des serruriers de la ville de Marseille le 27 octobre 1788. Très solennelle, la cérémonie a eu lieu à l’hôtel de ville en présence des lieutenants généraux de police, du procureur du Roi et des quatre prieurs de la confrérie parrainant chacun l’un des postulants [4].

- Les signatures sur le serment au corps des serruriers.
A partir de ce moment-là, Jean-Baptiste l’aîné et Jean cadet pouvaient envisager d’ouvrir, chacun, son propre atelier en qualité de maître-serrurier. Et chacun d’eux pouvait vraisemblablement compter sur le beau-père pour l’aider à trouver les fonds nécessaires. Jean-Baptiste l’aîné venait d’épouser la jeune Marguerite Gabriel, fille du maître-serrurier de la rue des Fabres, et Jean cadet était sur le point d’épouser Thérèse Carbonel, la fille du maitre-serrurier de la rue de l’Étrieu.
Mais voilà, les temps n’étaient peut-être pas tout à fait propices à ce genre de projet. Les esprits s’échauffaient, la population des porte-faix sur le port et des autres travailleurs de chantiers cherchait à se faire entendre, les mères de famille se plaignaient de la cherté des produits alimentaires, partout on s’inquiétait de ce que l’avenir immédiat pouvait réserver. Fréquentant de plus en plus souvent la rue de l’Étrieu et l’atelier de son beau-père, Jean cadet suivait de près l’évolution de la situation. Pierre Carbonel et son frère Joseph le ferblantier sont, l’un et l’autre, tout entiers investis dans les actions prérévolutionnaires qui agitent la population marseillaise. Pierre est alors prieur de la confrérie des maîtres-serruriers. A ce titre directement concerné, il va prendre en charge la rédaction du cahier de doléances de la profession. Ainsi le 26 mars 1789, il signe avec les trois autres prieurs de la confrérie le cahier de doléances du corps des maîtres-serruriers. La préoccupation première de ceux-ci est de conserver le monopole du choix des maîtres ayant le droit d’ouvrir un atelier de serrurerie dans la ville. Ils demandent pour cela de supprimer « le privilège accordé aux maitres des villes capitales, de s’établir dans les autres villes des provinces, et, si ce droit leur est conservé, (dire) qu’ils ne pourront, à l’instar des maîtres reçus à Paris, en jouir qu’après avoir exercé pendant plusieurs années leur profession dans la ville où ils auront obtenu la maitrise ».
Et plus tard, lorsque les Marseillais décident d’investir les trois forts de la ville [5] pour empêcher les troupes royales d’y pénétrer et sauvegarder l’indépendance de la ville alors sérieusement menacée, le beau-père de Jean cadet se trouve au nombre des cinquante volontaires qui investissent le fort de ND de la Garde le 30 avril 1790. Quant à Joseph, il continue malgré son âge d’être très présent dans la patrouille bourgeoise chargée d’assurer la sécurité de son quartier ; lorsque la Garde Nationale prend la suit des patrouilles bourgeoises, il occupe alors la fonction de capitaine de la cie n°16.
Même si Jean cadet ne manque pas de joindre souvent sa voix à celles des manifestants toujours plus nombreux à faire entendre leurs revendications, sa préoccupation première demeure l’ouverture de sa propre boutique de serrurerie. Sans attendre, dès l’année 1790, avec l’aide de son beau-père, il accroche son enseigne de maître-serrurier dans la partie neuve de la ville. Selon le plan d’agrandissement ordonné par Louis XIV au siècle précédent, ce nouveau quartier avait été théoriquement prévu pour accueillir les maisons bourgeoises et aristocratiques qui n’avaient plus leur place dans la vieille ville devenue trop insalubre. En réalité, on retrouve bientôt là et aussi longtemps que les prix du terrain ne seront pas excessifs, tout type d’habitants, notamment des artisans spécialisés. Pourquoi la mixité des habitants pratiquée dans la vieille ville n’aurait-elle pas cours aussi bien dans les nouveaux quartiers ? Ainsi, l’immeuble somme toute modeste où Jean cadet choisit tout à la fois d’exercer son activité de serrurier et d’habiter au 48 rue Cincinnatus (redevenue rue Paradis après la Révolution), côtoie des immeubles très chics, tel le n°52 aux fenêtres et balcons enrichis de sculptures et de ferronneries élégantes par le commissaire principal des galères qui l‘avait fait construire cinquante ans plus tôt.
La situation de Jean-Baptiste l’aîné est différente. Après le décès prématuré en couches de sa jeune femme laissant deux tout jeunes enfants, il envisage très vite de se remarier. Il quitte alors l’atelier de la rue des Fabres pour s’installer dans l’un des nouveaux quartiers encore peu fréquenté. La démolition du couvent des Feuillants et de toutes ses dépendances, vendus comme biens nationaux en 1791, a libéré des terrains offrant de grandes possibilités. Jean-Baptiste l’aîné achète l’un d’eux et fait construire un immeuble d’habitation sur quatre étages tandis que, sans attendre, il a d’ores et déjà installé son atelier juste en face, au 20 rue des Feuillants.
Dès cette époque, les chemins des deux frères vont apparemment se séparer. Comme si la compétition dépassait le seul cadre de leur activité professionnelle. Dans l’immédiat et en l’état de la période troublée que connaissent la ville et ses habitants, l’activité de serrurerie proprement dite en liaison avec la sécurité des personnes et des habitations connaît d’année en année un fort développement. L’esprit créatif de Jean cadet va puiser là de quoi stimuler son imagination de serrurier. Dans le même temps, il reste actif au sein de la profession pour préserver la qualité du métier et, tout particulièrement, le monopole que les maîtres-serruriers continuent de revendiquer. Quand bien même depuis 1791 les corporations de métiers sont interdites, les maîtres-serruriers entendent conserver le contrôle de l’installation dans la ville de toute nouvelle enseigne de serrurier. La chasse aux faux-serruriers sous le contrôle de Monsieur le Maire en sa qualité de chef de la police municipale, est un objectif auquel Jean cadet n’hésite pas à participer.
Peu à peu, la vie avait repris un cours normal, quand bien même depuis l’avènement de la République, les temps et les mœurs étaient quelque peu différents. Pour tenter de remédier à une grande insécurité des personnes et des biens régnant dans la ville, les autorités multipliaient arrêtés municipaux et mesures de police tant et si bien que la fabrication de serrures, de clés et de tout système de fermeture sécurisée devint un métier à part entière. Un métier réglementé et fortement contrôlé par l’autorité publique. Le maire était désormais seul compétent pour fixer les conditions d’exercice de l’activité de serrurier, comme il en était d’ailleurs pour toutes les professions relevant des corporations de l’Ancien Régime (arrêté municipal 31 décembre 1816 ci-joint). Dans le même temps, il se développait une concurrence sévère entre les ateliers de serruriers confrontés à une clientèle plus exigeante pour tout ce qui concerne sa sécurité personnelle.
Dans ce contexte, le souci de Jean cadet fut de développer son savoir-faire de serrurier dans un registre un peu différent et plus novateur. Il entreprit de fabriquer des coffres destinés, pour les particuliers, à protéger leurs papiers et biens les plus précieux. De longue date, les capitaines et armateurs équipaient leurs navires de coffres spécialement conçus pour résister aux attaques de la mer, du feu, et du pillage aussi. La fabrication de coffres en fer dotés de serrures suffisamment sécurisées pour être à usage de coffre-fort devint dès lors l’activité principale de Jean cadet. Et cette innovation, jointe au commerce du fer qu’il pratiquait de manière connexe, lui permit de gagner vraisemblablement beaucoup d’argent.
Jusqu’au jour où un concurrent de poids s’installa à Marseille. Venant de Portoferraio - le port du fer de l’île d’Elbe - Georges Charf débarque en 1820 avec le projet de commercialiser le fer de Portoferraio à l’état brut mais aussi sous forme de coffres de marine et de coffres forts. Avec un avantage inestimable sur ses concurrents : il maîtrise le prix de la matière première dès son point de départ et peut ainsi proposer à sa clientèle des prix reconnus fortement compétitifs. L’activité de Jean cadet devint dès lors de plus en plus difficile. Et à partir des années 1830, la crise ayant marqué le passage vers un début d’industrialisation avec son lot de fermetures d’ateliers et de faillites, ajouta encore aux difficultés de Jean cadet.
Dans le même temps, Jean-Baptiste l’aîné s’était retiré des affaires, dépassé lui aussi par la concurrence rude que menaient les nouveaux fabricants de coffres forts. Il avait finalement vendu son affaire à André Perreymond devenu dès lors, après Georges Charf, le 2e fabricant de coffres forts de la ville (ci-dessous la photo d’un coffre-fort de marine, Musée d’Histoire de Marseille).

Pascal, le fils aîné de Jean cadet, avait assez vite compris que le métier de serrurier tel qu’il avait été exercé par son père, aussi brillante qu’ait pu être son enseigne sur la rue Paradis au début du siècle, n’était plus à la hauteur des enjeux des temps modernes. A l’évidence, le négoce du fer à l’état brut était plus rémunérateur.
A la mort de son père, Pascal a 44 ans. La perspective d’une part d’héritage confortable le conduit peu à peu à envisager son existence sous un tout autre jour. Pourquoi pas une vie de gentilhomme campagnard ? À la manière de ces riches négociants marseillais qu’il a l’occasion de rencontrer ici ou là dans les cercles où il est de bon ton de se montrer. Il n’hésita pas longtemps. Trois ans à peine après avoir enterré son père, il laisse la rue Paradis à son jeune frère et à son neveu qui constituent entre eux une société de commerce de métaux ; la société aura en fait une durée de vie relativement courte et ne résistera pas à la crise des années 1830/40.
Pascal achète alors une élégante bastide dans la campagne marseillaise et, dans la foulée, il se marie. Avec douze hectares de terres cultivées et une famille de fermiers dévoués, le fils aîné de Jean cadet va passer les trente années suivantes à l’abri du besoin, dans un environnement paisible et suffisamment proche de la ville pour pouvoir continuer de participer à la vie sociale marseillaise. Cela devient alors une autre histoire.
Soixante ans après l’arrivée à Marseille du jeune compagnon-serrurier bourguignon, Jean cadet, le statut de notable est officiellement reconnu à Pascal, son fils aîné. C’était le 27 juillet 1848, à l’issue des journées de révolte des ouvriers travaillant sur le chantier de construction du canal de la Durance à Marseille.











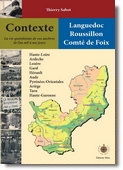


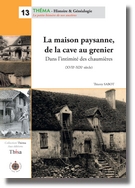


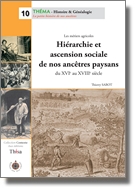


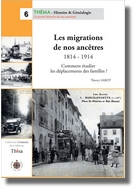



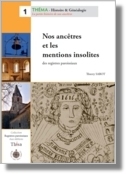


 Serrurier, artisan d’art de l’Ancien Régime, d’une Révolution à l’autre
Serrurier, artisan d’art de l’Ancien Régime, d’une Révolution à l’autre