A mon grand père...
Mes différentes mutations à travers l’Algérie
Mostaganem
Nous avons donc déménagé à Mostaganem avec Francesco et Rosa qui ont vendu leur ferme de Birkadem et nous ont suivis pour rester avec nous pour leurs vieux jours, Francesco venait d’avoir 72 ans.

Située dans l’Ouest algérien à 80 km à l’Est d’Oran, la commune de MOSTAGANEM, dominant à 104 mètres d’altitude, sur le bord du plateau côtier, comprenait, quand nous sommes arrivés, environ 21000 habitants. C’était une cité moitié arabe, moitié européenne, décorée, dans sa partie nouvelle, de larges rues, de grandes places à arcades, de maisons bâties avec goût, de nombreux édifices publics parmi lesquels on distinguait la mairie, l’église, le théâtre et de belles plantations. Elle était dominée par des minarets et des forts, dont les cigognes, toujours perchées sur leurs hautes cimes, donnaient à la ville entière un air oriental.
La prison était une maison d’arrêt et de correction assez conséquente pouvant détenir 500 prisonniers. Mes conditions de travail étaient quasiment les mêmes qu’à Birkadem, la paye étant un peu plus élevée.
Avec Francesco, Rosa et les deux garçons nous emménageâmes, Marie-Joséphine et moi, dans une petite maison en bordure du centre ville, que nous louions. La cohabitation avec mes beaux parents se passait bien. Ils s’adaptèrent assez facilement à cette ville car la communauté espagnole y était assez importante, ils avaient même une partie de leur famille de Tarbena qui y habitait.
A l’automne de l’année 1917 je fus muté à Frenda, sur les hauts plateaux, comme surveillant chef de 3e classe.
Frenda
Nous partîmes de Mostaganem en diligence avec tout notre barda pour nous rendre à Frenda en passant par Mascara. Après cette ville, à Cacherou, nous suivîmes, invariablement, les interminables couloirs tortueux de la route qui serpente à travers le djebel Moualek, au milieu d’une luxurieuse forêt de jeunes pins. Nous passâmes ensuite le col d’Ain-Guergour à 759 mètres d’altitude, là nous nous arrêtâmes dans une auberge où nous pûmes nous restaurer, et les chevaux de la diligence se reposer. A Tagremaret, nous traversâmes l’oued El-Abd pour nous rendre à Martinprey au pied du superbe amphithéâtre du djebel Gaada recouvert de magnifiques forêts de pins d’Alep. Nous arrivâmes enfin à Frenda à environ1000 mètres d’altitude, village qui domine la verdoyante plaine de l’oued d’El Taht. Une plaine généreuse, avec son lac collinaire qui prend sa source au Chott Chergui situé plus au sud, ses amples oliviers alignés en rangs d’oignons et ses carrés interminables de pommiers.

Arrivés à Frenda nous aménageâmes dans la prison. C’était une ancienne geôle de douar à l’époque de la conquête, transformée en prison communale. Elle était située à proximité de la gendarmerie. C’était un vieux bâtiment comprenant un logement pour le gardien et une douzaine de cellules.
Ces dernières n’étaient pas toujours occupées, elles servaient pour la plupart à accueillir des prisonniers en transit qui se rendaient sous escorte de leur lieu d’arrestation à Mostaganem où ils étaient jugés. Il y avait aussi, parfois des prisonniers à courtes peines sans jugements, pour la plupart des ’voleurs de poules’, souvent des indigènes miséreux qui volaient pour leur survie.
C’est à Frenda que j’ai connu mon premier hiver sous la neige en Algérie, beaucoup plus rigoureux que ceux vécus à Orléans et à Pantin. Par contre les étés étaient très chauds. Cela nous changeait énormément du climat côtier de Mostaganem qui était le même que celui de Birkadem.
1918 fut l’année de la fin de la première guerre mondiale et aussi celle du décès de Francesco à Mostaganem. Rosa, devenue seule dans cette ville vint nous rejoindre à Frenda.
C’est en 1919 que je fus muté à Tiaret comme surveillant chef de 2e classe, mon passage à Frenda n’a duré que deux ans, deux années où il ne s’est rien passé de particulier.
Tiaret

Nous partîmes de Frenda, toujours en diligence, la route suivait la bordure du haut plateau et n’était pas trop tortueuse et toujours bordée, sur notre droite, par de magnifiques forêts de pins. Entre Palat et Tiaret nous aperçûmes à quelques dizaines de mètres de la route sur 5 ou 6 km, une quinzaine de ’dejdars’, grands tombeaux indigènes en forme de pyramides à gradins. Puis nous arrivâmes à Tiaret située dans un col à environ 1000 mètres d’altitude sur les pentes du djebel Guezoul.

- Arrivée de la diligence à Tiaret.
Quand nous sommes arrivés à Tiaret, c’était un gros bourg d’environ 7000 habitants dont à peu près 3000 européens. C’était une petite ville assez particulière comprenant quatre groupes de constructions : -Le quartier militaire appelé ’la citadelle’ assis sur un mamelon qui dominait la ville. De son versant sud on pouvait voir les vastes plaines du Sersou, le djebel Sidi-el-Abed, les steppes et, à l’horizon, le djebel Amour. -Au delà du ravin de l’oued Tiaret, et sur la rive droite de ce ruisseau qui traversait le bourg en cascades et faisait tourner les roues des moulins, la ville haute avec sa place Carnot, ses hôtels et la mosquée. -La ville basse avec son marché couvert, la poste, l’église, les écoles, la mairie et la justice de paix. Le quartier ’administratif’ de la ville. -A l’ouest, sur une colline faisant face à celle de la citadelle et dominant la place Carnot, il y avait le village indigène, appelé le ’village nègre’, dominé par la koubba de Sidi-khaled.
La prison, elle, était située dans la ville basse à proximité de la justice de paix. C’était une prison annexe, c’est à dire une prison située dans un chef-lieu de canton judiciaire ou siège un juge de paix à compétence élargie. Elle n’accueillait que les condamnés dont la peine d’incarcération était inférieure à 2 mois. A Tiaret sa contenance était faible, elle ne comprenait qu’une vingtaine de cellules. Durant mon passage elle n’a jamais été totalement occupée.
Six mois après notre arrivée à Tiaret, Rosa, très éprouvée par la disparition de son mari, nous quitta. Nous fûmes tous très attristés par ce décès, car elle était une bonne mère et aussi une bonne grand-mère, mes deux fils l’adoraient.
En février 1920, plus exactement le 3 février, se passa un évènement tout à l’honneur de Marie-Joséphine. C’était un mardi, comme tous les mardi en fin d’après midi, j’étais allé jouer aux cartes avec trois de mes amis, Monsieur CABRERA, l’épicier, monsieur CRES, le commissaire priseur et monsieur COHEN-SCALI, le comptable.
Vers 19 heures, alors que nous étions attablés à l’un des cafés de la place Carnot, je vois mon chien Dick, un beau berger allemand, venir à vive allure vers moi en aboyant. Surpris et étonné, je me dis qu’il se passait quelque chose à la prison. Je m’y rendis immédiatement, précédé par mon chien.
Arrivé dans la cour de la prison je vis Marie-Joséphine tenir en respect, avec mon arme de service restée à la maison, un détenu qui avait tenté de s’évader. Elle avait envoyé le chien me chercher. Je pris tout de suite les choses en main et réincarcérait sans peine le malheureux fugitif.
C’était un jeune indigène, Abdelkader Aouni de son nom, originaire d’un douar du djebel Chemakr. Un petit voleur de poule tout à fait inoffensif. Malgré sa courte peine il se languissait de ne pouvoir regagner sa tribu. Aussi, ayant repéré mon ’manège’ des mardi soir, il décida de tenter sa chance. Ce fait, qui malgré tout reste anecdotique, valut à Marie-Joséphine une lettre de félicitations de la part du gouverneur général de l’Algérie par l’intermédiaire du préfet d’Oran.
Un autre évènement marqua mon passage à Tiaret. Durant l’hiver 1921 une épidémie de typhus frappa la ville. Cela commença mi-janvier au moment où le froid fit descendre le mercure jusqu’à plusieurs degrés au dessous de zéro. Ces basses températures favorisèrent la venue en nombre d’indigènes miséreux des douars alentours, souvent en état d’épuisement complet.
La municipalité transforma la Halle aux grains en camp d’hébergement fermé avec un poste de garde et un magasin de vivres, pour accueillir ces pauvres malheureux. Dans ce camp, petit à petit, se multiplièrent les décès (74 en deux semaines) dus à différentes maladies comme la bronchite grippale, la typhoïde, le paludisme et la variole.
Mi-février le typhus devint la maladie dominante, l’agent de police MARIANO qui était chargé de gérer le camp de la halle aux grains en fut l’une des premières victimes. A la prison, deux indigènes arrêtés pour avoir provoqué une rixe mi-janvier à la halle succombèrent eux aussi à la maladie.
J’activai rapidement le protocole pour lutter contre l’épidémie : -L’épouillage de tous les détenus avec de l’huile camphrée et du vinaigre car les poux sont le vecteur principal de cette maladie. -L’ébouillantage de leurs vêtements et leur en donner des propres. -Demander à ma hiérarchie l’évacuation de la prison pour pouvoir la désinfecter totalement par sulfatage.
Fin février la maladie continuait à faire des ravages en ville, les écoles furent fermées. Le camp de la halle aux grains fut remplacé par un autre camp, plus grand, situé à l’extérieur des murs. Ce dernier ressemblait plus à un camp d’internement qu’à un camp de réfugiés, avec ses barbelés et ses postes de garde. Il y avait aussi une tente médicale, une morgue et une cuisine ambulante.
Début mars des barrages armés furent établis autour de la ville et des patrouilles furent organisées afin d’arrêter les mendiants qui auraient pu passer les barrages.
Mi mars l’épidémie recula petit à petit pour être complètement éradiquée fin mars. Le 4 avril vit la réouverture des écoles, le démantèlement du camp dont les occupants sont tous repartis dans leurs tribus et, en ce qui me concerne, la reprise d’activité de la prison.
Cette période fut très difficile à vivre pour tout le monde. La municipalité, reconnaissante, décora à titre posthume l’agent de police MARIANO de la médaille d’or des épidémies. Pour ma part, l’administration pénitentiaire me décerna la même médaille, mais en bronze, pour, me fit-elle savoir par lettre, mon dévouement durant cette épidémie.
Marie-Joséphine a sa part dans l’attribution de cette médaille car elle s’est impliquée largement dans l’épouillage des détenus et l’ébouillantage de leurs vêtements.

Après cette difficile période la vie reprit comme auparavant jusqu’au printemps 1922 où je fus muté à Duvivier comme gardien-chef de 1re classe.
Duvivier

- Duvivier vers 1920.

Quand nous sommes arrivés à Duvivier, Bou-chagouf pour les indigènes, c’était une petite ville del’Est algérien située à 52 km au Sud de la ville de BÔNE et à environ 80 km de la frontière tunisienne, dominant la rive droite de la vallée de la Seybouse et comprenant environ 4000 habitants dont à peine 400 européens.
La vallée de la Seybouse, de Duvivier à Bône, était à l’époque la plus fertile de l’Algérie avec ses immenses oliveraies, ses vignes abondantes et ses lauriers roses. Le climat y était de type méditerranéen avec des étés chauds, cela nous changeait du climat de Tiaret.
Dans le village, comme bâtiments officiels, il y avait la mairie, la poste, l’église, la justice de paix, l’école, la gendarmerie, tous situés dans la rue principale. La prison, elle, était à proximité de la gendarmerie. C’était comme à Tiaret, une prison annexe à faible effectif. Je remplaçais le surveillant chef VINCILEONI qui venait de partir à la retraite.
Notre passage à Duvivier n’a duré qu’une année, nous nous y plaisions bien. Contrairement à Tiaret il n’y eu aucun fait marquant durant ce séjour. J’ai eu peu de détenus et aucun n’a été récalcitrant.
Durant ce séjour notre vie de famille a suivi son petit train-train habituel. Marie-Joséphine s’occupait de la maison et des enfants. Ces derniers étaient tous les deux à l’école de garçons de Duvivier , cette année là, dans leur classe, il y avait 18 élèves dont seulement 5 européens.

Je quitte donc la prison de Duvivier le 20 octobre 1924 pour aller intégrer celle de Teniet-el-Haad, dans le massif de l’Ouarsenis.
Teniet-el-Haad


L’accès à ce village du sud-ouest de l’Ouarsenis était assez difficile. La route sinueuse, parfois tortueuse et en forte pente, côtoyait une multitude de précipices au fond desquels fleurissaient des lauriers roses. On pouvait voir autour de nous de nombreux monts en ’pain de sucre’ ou en ’troncs de cônes’, véritables pyramides, au sommet desquels poussaient des pins d’Alep.

Quand nous sommes arrivés à Teniet-el-Haad, situé à 173 km au sud-ouest d’Alger et à environ 1100 mètres d’altitude, c’était une petite ville d’à peu près 4000 habitants dont environ 900 européens. Son artère principale, le boulevard de France, orientée nord-sud était très longue, bordée d’arbres, de maisons et de commerces. Il y avait aussi l’église et la mairie. La prison, elle, était dans une rue adjacente, le boulevard de Tiaret qui terminait la route Teniet-Tiaret. Cette dernière ville était à une centaine de kilomètres au sud-ouest. C’est sur cette route à l’entrée du village que se tenait le grand marché arabe.
Deux mamelons entouraient la ville, l’un au nord-ouest où était assise une ancienne forteresse qui servait de caserne. L’autre, à l’est, sur le versant duquel se trouvait le village indigène que l’on appelait le’ village nègre’. Comme à Tiaret et Duvivier, la prison était une prison annexe pour courtes peines inférieures à deux mois qui comprenait aussi une vingtaine de cellules qui, d’ailleurs, comme dans mes précédents postes, n’ont jamais été toutes occupées durant mon séjour.

- Eugène, son fils Georges et le fameux chien Dick devant le bâtiment cellulaire en 1925.
Ce poste à Teniet est celui, des postes occupés auparavant, que j’ai le plus apprécié : d’abord par l’ambiance qui régnait dans ce village et alentours. Les deux communautés, l’indigène et l’européenne, s’entendaient bien, les deux cultures cohabitaient sans heurts. Peut-être est-ce la rigueur du climat et la dureté de la vie dans ces montagnes qui favorisait une certaine solidarité. La place du village était le lieu de nombreuses rencontres de toute la communauté ténietoise. Teniet semblait vivre continuellement à l’heure de festivités : fêtes nationales, locales et religieuses.
Ensuite par son environnement, en effet à 3 ou 4 km au nord du village s’étendait, sur plus de 1000 hectares, la magnifique forêt de cèdres de la montagne du Meddad. Cette forêt a été proclamée ’Parc national des cèdres’ en 1923, juste un an avant notre arrivée.
L’été dans les fortes canicules, lors de mes temps libres, nous allions en famille, comme beaucoup de ténietois, y pic-niquer pour nous rafraîchir à l’ombre des cèdres et à la fraîcheur des ruisseaux serpentant dans le creux de vallonnements, parfois profonds.

1926 fut l’année où nous avons passé un mois à Orléans auprès de ma famille. Nous avons été hébergés chez ma petite sœur Madeleine et son mari, Paul GODEFROY. Nous en avons profité pour aller nous recueillir sur la tombe familiale où étaient inhumées ma mère Rose, mon frère Jules et mes deux sœurs Marie et blanche qui elles aussi, comme Jules, sont décédées de la tuberculose.

- Cette photographie nous montre Eugène (3), Marie-Joséphine (2) et leur fils Georges (8) au N°4 de la rue de la Binoche à Orléans chez Madeleine (6), la sœur d’Eugène, et son mari Paul GODEFROY (1) en présence du cousin Eugène PROUST (5) et de sa femme Gabrielle RICOIS (4). La petite fille (7) est Paule, la fille de Madeleine. C’est probablement Pierre, le frère aîné de Georges qui a pris cette photo.
1926 fut aussi l’année où Pierrot eut son certificat d’études. Nous étions contents.
En avril 1928 je fus muté à Boufarik, dans la plaine de la Mitijda, toujours comme gardien chef de 1re classe, suite à la demande que j’avais formulée pour me rapprocher d’Alger.
Boufarik

Quand nous sommes arrivés à Boufarik c’était un opulent village en pleine expansion comprenant environ 4000 habitants, à la population bien partagée puisqu’il y avait autant d’indigènes que d’européens. Il était entouré à perte de vue par de vastes espaces de vignes, d’orangeraies, d’oliveraies, de champs de tabac et de différentes cultures ; maraîchères, de plantes à parfum ( géranium rose) et de céréales. Ces espaces étaient parsemés de nombreuses grandes fermes aux bâtiments spacieux avec leurs toits de tuiles rouges qui ressemblaient aux fermes françaises.
Cette expansion était due à la création récente de plusieurs coopératives, celle des agrumes, celle des essences à parfum, celle du tabac et les coopératives de la cave et de la distillerie. Ce développement était dû aussi à l’implantation de plusieurs banques dont la banque d’Algérie et la banque Agricole.
C’était un joli village avec ses longues et larges avenues se coupant à angle droit, avec ses boulevards ombragés tout du long par d’énormes platanes, avec ses espaces de fraîcheur et d’ombre ; ses quinconces, ses squares avec bassins et jets d’eau, et enfin sa statue du sergent Blandan, héros de la conquête de l’Algérie.

Les maisons y étaient coquettes et bien bâties. Les bâtiments administratifs, comme la mairie, les écoles, la justice de paix, etc..., étaient identiques à ceux de la métropole. Il y avait aussi de nombreux cafés restaurants et même un théâtre. L’église Saint-Ferdinand se dressait toute droite devant la mairie de l’autre côté de la place de la république.
Marie-Joséphine et moi, nous étions contents de nous installer dans cette ville, nous retrouvions l’ambiance de Birkadem qui n’était pas du tout celle des hauts plateaux ou celle de l’Ouarsenis. Nous retrouvions cette ambiance méditerranéenne qui m’a tant plu lorsque je suis arrivé en Algérie.
La prison, elle, était comparable à celles que nous avions occupées auparavant dans le bled. C’était encore une prison annexe avec une vingtaine de cellules. Elle se trouvait rue de France, rue qui débouche sur la place du sergent Blandan.

- Rue de France vers 1930.
Quand nous nous y sommes installés il n’y avait pas encore l’électricité alors que la ville était électrifiée en grande partie. Je demandais alors à la municipalité de faire son possible pour remédier à cela, chose qui a été faite rapidement. Le maire, monsieur FROGER, était un édile dynamique et efficace.
Une fois installés, mes deux garçons reprirent l’école, Georgeot, le benjamin, passa son certificat d’études pour ensuite intégrer l’école supérieure pour préparer le brevet élémentaire. Pierrot, lui, après le certificat d’étude et trois années de cours complémentaires, suivit les cours d’une classe de préapprentissage qui était en même temps un cours d’instruction pratique et une classe d’orientation professionnelle. A la fin de cet enseignement il fut embauché à la distillerie coopérative comme apprenti chimiste.

- La famille THORET à Boufarik.
Nous nous plaisions bien à Boufarik, les garçons s’y sont bien intégré. Pierrot qui était sportif s’est inscrit, sur mon conseil, au cercle d’escrime. En effet, quand j’étais à Alger au palais du gouverneur, j’allais souvent au cercle laïque d’Alger où monsieur MAGINOT pratiquait l’escrime, j’aimais bien assister aux assauts. Aussi, à Boufarik, j’ai pensé que cela serait une bonne activité pour mes garçons. Pierrot aimait ça, il a même été, plus tard, au championnat de Tunisie et a participé à des compétitions internationales. Georgeot, lui, moins sportif, préférait assister aux matchs de foot ou de boxe avec ses copains.
Avec Marie-Joséphine nous allions souvent à Birkadem rendre visite à son frère Raphael devenu expéditeur de fruits et légumes et à la belle famille de Jean-Baptiste, les BARCELOT. Nous allions aussi à Blida ou son frère aîné François était devenu courtier en vins. C’est lors de l’une des visites de ce dernierà Boufarik qu’il nous annonça son départ pour l’Amérique latine où, nous dit-il, la viticulture était en plein essor. Il comptait sur sa connaissance de l’espagnol et sur son expérience dans le domaine viticole pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Depuis ce jour là nous n’avons plus eu de nouvelles de lui...
Moi aussi je m’étais bien intégré dans cette nouvelle communauté. Je m’étais fait beaucoup d’amis, tous les dimanches après midi nous nous retrouvions au boulodrome pour finir en début de soirée au café du Glacier devant une anisette et une assiette de Kémia.
Sur le plan professionnel il ne s’est rien passé de marquant durant ce séjour, c’était, si je peux m’exprimer ainsi, la routine. Le 31 juillet 1931 je reçus la médaille d’honneur des services pénitentiaires.

- Coupure du journal "L’Écho d’Alger".
Le 30 septembre 1932, je fus admis à faire valoir mes droits à la retraite à partir du 1er octobre 1932. En octobre 1933 je quittais donc l’administration pénitentiaire pour intégrer un emploi réservé aux fonctionnaires retraités, comme gardien de jardin public au ’Jardin d’Essai’ dans le quartier du Hamma à ’Alger, près d’Hussein Dey, le 1er janvier 1934.
Mon retour définitif dans l’agglomération algéroise
Alger à notre arrivée en 1934

L’Alger de 1934 n’avait rien à voir avec l’Alger de 1905 que j’avais connu. D’abord, le centre ville s’était déporté vers l’est de la ville de la place du Gouvernement à la Grande Poste. Cette dernière, de style néo-mauresque, située au carrefour de la rue d’Isly et de la rue Michelet, a été construite en 1913 à la place d’une chapelle désaffectée.

A partir de 1920 le style néo-mauresque a été abandonné au profit d’un style plus moderne et plus méditerranéen, immeubles avec grands balcons et terrasses en guise de toit. Un peu dans le style espagnol de l’époque comme les immeubles du haut de la place Laferriere (photographie ci-dessus). A partir de 1931 c’est le style ’moderne’ qui l’emporta porté par des architectes de l’école de LE CORBUSIER comme l’immeuble du Gouvernement Général.

- L’immeuble du Gouvernement Général vers 1935.
La ville s’était aussi construite sur les hauteurs :
A Mustapha supérieur, le chemin du Télemly, élargi et bitumé, était de tout son long bordé d’immeubles, de villas et de parcs comme le jardin Saint-Saens ou le parc de Galland. Ce n’était plus le chemin sinueux, ombragé et pas très bien carrossé que j’avais connu en 1902.
C’était la même chose pour la rue Michelet qui maintenant était bordée d’immeubles jusqu’au parcde Galland situé à l’intersection avec le chemin du Télemly, à deux cent mètres du Palais d’Été.

A Bab-el-oued, les nouvelles constructions avaient tendance à occuper de plus en plus le versant de la Bouzareah.

Si Alger avait changé sur le plan de l’urbanisme, elle avait aussi changé sur le plan ethnique. Je n’ai pas retrouvé l’Alger de 1902 où les ethnies étaient relativement mélangées. Dans la casbah il y avait, certes, une grande majorité d’indigènes mais aussi une bonne proportion d’européens qui peuplaient surtout la moyenne et la basse casbah. Dans le quartier européen il y avait aussi des indigènes surtout aux abords de la casbah et dans le quartier de la Marine, près du port.
Dans l’Alger de 1934 que je découvrais, les deux communautés étaient bien distinctes sur le plan géographique. Les européens avaient déserté la casbah, seuls les juifs y étaient restés dans sa partie basse. Du square Bresson à Mustapha Supérieur la population était entièrement européenne, seuls quelques quartiers périphériques comme Belcourt, à l’est de la ville, ou la Robertsau, aux abords du Télemly, comptaient encore une certaine proportion d’indigènes.
Mais ce qui m’a le plus frappé et qui n’existait pas en 1902, c’était les bidonvilles dans la grande périphérie de la ville. Le développement de cette dernière, son industrialisation et son commerce florissant avaient attirés une forte population, malheureusement miséreuse, venue de l’intérieur du pays.
J’étais choqué car après une dizaine d’années passées sur les hauts plateaux et dans l’Ouarsenis où les douars ou les villages nègres étaient souvent pauvres, je n’avais jamais vu d’habitations précaires comme les bidonvilles. C’étaient des petites mechtas souvent rustiques mais toujours en dur et avec un minimum de confort.
Un autre changement m’avait interpelé, c’était celui de la vie politique. Cette dernière en 1902-1905 était ’vivante’ mais restait calme dans l’ensemble. Il n’y avait jamais de très gros remous lors des élections qu’elles soient locales ou nationales.
Par contre l’Alger de 1934, comme à Paris, fut le siège de manifestations, parfois violentes. Elles étaient le résultat de l’affrontement des ligues de droite et des partis de gauche du front populaire.
Alger qui jusque là était une ville plutôt à gauche vit à cette époque une prépondérance des ligues de droite surtout celle des ’croix de feu’. Cette dernière étant au départ une association d’anciens combattants décorés au feu. La section d’Alger devint vite, en nombre, la deuxième après celle de Paris.
Les tensions durèrent quasiment jusqu’en 1939 en passant par 1936, l’année où le front populaire accéda au gouvernement.
Notre vie au jardin d’Essais du Hamma
Nous avons donc aménagé au jardin d’Essais le 1er janvier 1934. Nous logions dans la maison de gardien. C’était une petite habitation de plein pied comprenant quatre pièces. C’était assez confortable avec eau courante, électricité et tout à l’égout.

Nous y étions bien, les deux garçons avaient chacun leur chambre.
Pierrot ne venait que les fins de semaines car il travaillait toujours à Boufarik à la distillerie de la coopérative, toujours comme chimiste.
Georgeot, lui, venait d’embaucher à la Compagnie Algérienne de Crédits et de Banque. C’était un emploi que je lui avais trouvé par l’intermédiaire d’un cadre de l’administration Pénitentiaire dont le beau frère était chef du personnel de cette banque. En plus de son travail, il suivait des cours de comptabilité aux cours commerciaux de la chambre de commerce de la ville d’Alger.
Marie-Joséphine, toujours fidèle femme au foyer, s’occupait toujours de la maison. Elle se plaisait bien à Alger car grâce au Tramway elle pouvait se rendre facilement à Hussein-Dey ou à Alger pour faire ses courses ou rendre visite à des amies ou à sa famille, cela la changeait de sa vie dans le bled.
Moi aussi je me plaisais bien là. Ce poste en fin de carrière me convenait bien car après près de 30 ans dans l’administration pénitentiaire j’aspirais à plus de tranquillité. Et puis dans ce jardin jeretrouvais un peu de ma jeunesse. Cela me rappelait quand j’étais jardinier au palais d’Été dans son merveilleux jardin à la végétation luxuriante.
Ici mon travail consistait à parcourir de long en large ce merveilleux parc afin de vérifier que tout se passait bien, de repérer les éventuelles dégradations faites par les promeneurs et aussi d’intervenir en cas d’altercations violentes afin de garantir le calme des lieux. Pour cela je tenais toujours en laisse un chien de garde qui était mon arme de dissuasion.
J’aimais parcourir toutes ces allées qui me transportaient dans différents continents. Durant monséjour au palais d’Été j’avais appris à reconnaître toutes sortes de plantes et d’arbres exotiques. Dans l’allée des bambous je me plaisais à me croire en chine méridionale, dans celle des ficus se côtoyaient toutes sortes de figuiers le Ficus Américana qui, comme son l’indique venait d’Amérique, le Ficus Banian de l’inde, le Ficus Benjamina ou figuier pleureur d’origine asiatique et océanique, le Ficus Elastica qui produit du caoutchouc et vient d’Asie et bien d’autres espèces encore.

Il y avait plein d’autres allées où je pouvais laisser vagabonder mon imagination comme par exemple l’allée des platanes, l’allée des palmiers dattiers, l’allée des Magnolias et l’allée des eucalyptus.
Dans les espaces découverts il y avait des plates bandes, larges de 4 à 5 mètres, réunissant par groupes de familles toutes les plantes d’un intérêt horticole reconnu. Il y avait aussi un petit zoo où on pouvait voir des autruches, des Alpacas, des lamas , des zèbres et des gazelles.
Tout au fond du parc il y avait le musée des beaux arts, de style moderne, qui venait d’être construit.

le 18 juin 1935 avec Marie-Joséphine nous sommes allés une semaine à Casablanca voir son frère Baptiste et sa famille. Nous avons visité la ville qui est belle mais c’est Alger qui restait ma préférée.
C’était malheureusement la dernière fois que nous avons vu Baptiste car il est décédé en 1939.
Le 15 octobre de cette même année Georgeot a été incorporé pour son service militaire. Comme il a effectué la préparation militaire, il a pu choisir son lieu de casernement. Tout naturellement il a choisi Orléans pour être près de notre famille orléanaise. Le 23 octobre, il intègra le 30e Régiment d’Artillerie Automobile cantonné à la caserne Dunois à Orléans.
Avec Marie-Joséphine nous voilà tout seuls dans la maison du jardin d’Essai. Cela nous faisait tout drôle car c’était la première fois que nous vivions sans les enfants.
En 1936 Pierrot est allé à Tunis où il avait trouvé une place de chimiste dans une distillerie de cette ville. Le 8 mai 1937 il se maria au consulat de France de Tunis avec Germaine NAUD, une jeune femme dont le père était vigneron métayer à Sidi-Moussa, village situé à une trentaine de kilomètres au sud d’Alger. Ils se sont connus à Alger. Le jeune couple s’installa alors à Tunis.
La même année j’ai quitté mon poste de gardien de jardin public pour prendre ma retraite définitive. Nous nous sommes installés dans un petit appartement rue des deux-Prosper à Hussein-Dey, commune limitrophe du quartier du Hamma.
Notre vie à Hussein-Dey.
L’appartement de la rue des deux-Prosper était occupé par une tante de Marie-Joséphine, Marie MASCARO, qui venait de décéder. C’est ainsi que nous avons pu y emménager. C’était un petit logement de trois pièces au premier étage d’un petit immeuble. Il possédait toutes les commodités, nous y étions bien.
Le 1er octobre 1937, nous venions tout juste de déménager, Georgeot revint à Alger, libéré du service militaire. Il vint s’installer chez nous et reprit son emploi à la Compagnie Algérienne.
En 1939 nous déménageâmes de la rue des deux Prosper pour aller nous installer rue Lamoricière, toujours à Hussein-Dey. Le 2 septembre de cette même année, la veille de la déclaration de guerre contre l’Allemagne, Georgeot fut mobilisé à Orléans alors qu’il était en vacances chez ma sœur Madeleine. Il incorpora le 266e Régiment Nord Africain d’Artillerie Lourde et fut fait prisonnier le 14 juin 1940 prés de Dijon, avant d’être transféré dans un camp de prisonniers de guerre, prés de Lintz, en Autriche.
Ce fut une période pénible car nous nous faisions du souci pour Georgeot, à la guerre. Nous n’avions que peu de nouvelles de lui, c’est la Croix Rouge qui, tardivement, nous informa de sa captivité. Nous pûmes alors lui envoyer des colis par l’intermédiaire de cet organisme. Colis qui, malheureusement, n’arrivaient pas toujours à destination.
Heureusement pour lui, Pierrot ayant eu un petit garçon âgé d’un an, n’est pas parti au front. Il a été mobilisé sur place à Tunis.
A Alger le 25 juin 1940, jour de la proclamation de l’armistice, fut organisée une cérémonie au monument aux morts en hommage aux victimes de la guerre. Avec Marie-Joséphine nous y sommes allés, nous n’avions pas encore de nouvelles de Georgeot. La foule était dense, partagée entre la colère et la douleur. Les visages étaient crispés et tristes, bien des yeux étaient rougis... Un sentiment de résistance semblait s’emparer de la foule.
Mais avec l’installation du général WEYGAND, comme gouverneur Général, par le gouvernement de Vichy, présidé par le maréchal PETAIN, ce sentiment s’estompa peu à peu, surtout à HusseinDey où les anciens ’Croix de Feux’ étaient prépondérants. Beaucoup de juifs du quartier, surtout des hommes, furent envoyés dans des camps dans l’intérieur.
En 1941, Germaine, la femme de Pierrot, vint à Alger pour voir ses parents et nous rendre visite. Elle était venue avec son petit garçon, Guy. Cela nous fit du bien au moral, cela nous a changé les idées. Le gamin était adorable. Nous étions fiers de notre petit fils.

- Marie-Joséphine et Eugène avec Guy, au jardin d’Essai.
En 1942, avec l’arrivée des américains, Alger prit un tout autre visage. A Hussein-Dey les anciens ’Croix de Feux" devinrent beaucoup plus discrets. Quand le général DE GAULE est arrivé à Alger en 1943 il a été acclamé en ville, par contre à Hussein-Dey, lors de son passage en venant de l’aérodrome de ’Maison blanche’, les ovations furent timides...
A partir du moment où le ’Général’ s’était installé à Alger nous reprîmes espoir en la fin de la guerre. L’espoir aussi de revoir notre fils, qui était emprisonné depuis 3 ans en Autriche, revenir dans un avenir que nous espérions pas trop lointain.
Le 8 mai 1945, c’était enfin la victoire. ’L’Écho d’Alger’, mon journal habituel, en faisait sa ’une’. La guerre était terminée enfin nous allions pouvoir revoir notre fils !

Ce n’est que le 13 mai que la presse a évoqué les évènements graves de Sétif, dans le Constantinois, qui s’étaient déroulés le 8 mai. Ce jour là, lors de la célébration de la victoire, la manifestation a dégénéré. Pour la première fois le drapeau nationaliste algérien est apparu. Devant le refus d’un jeune indigène de jeter son drapeau, la police le mit en joue. Le maire socialiste de la ville, un Européen, la supplia de ne pas tirer. Il fut abattu de même que le jeune indigène. La foule, évaluée à 8.000 personnes, se déchaîna et 27 Européens furent tués dans d’atroces conditions. L’insurrection s’étendit à des villes voisines, faisant en quelques jours 103 morts dans la population européenne.
La répression fut d’une extrême brutalité. L’aviation elle-même fut requise pour bombarder les zones insurgées. Après la bataille, les tribunaux ordonnèrent 28 exécutions et une soixantaine de longues incarcérations. Officiellement, les autorités françaises estimèrent que le drame aurait fait 103 morts chez les Européens et 1500 chez les musulmans.
Quand j’ai lu l’article de ’L’Écho d’Alger’ du 13 mai, j’étais stupéfait. Après presque 10 ans passés dans les Hauts-Plateaux et l’Ouarsenis, jamais je n’ai décelé la moindre rébellion contre la France de la part des indigènes. Pourtant comme gardien de prison j’étais bien placé...
A midi quand je suis allé boire mon anisette au café du coin de la rue, les commentaires allaient bon train. D’aucuns disaient que la répression n’avait pas été assez forte, d’autres au contraire disaient qu’elle était disproportionnée et que cet état de choses était la faute des américains qui ont mis dans la tête de la population musulmane des idées d’indépendance. J’approuvais totalement cette dernière hypothèse.
Le 15 mai nous apprîmes par la Croix Rouge que Georgeot avait été libéré par les américains le 5 mai. Il arriva à Alger à la mi juin et fut démobilisé le 22 juin au centre de démobilisation de ’Maison-Carrée’, près d’Alger. C’est à cette date qu’il nous a rejoint au N°2 de la rue Lamoricière.
A son arrivée, Marie-Joséphine et moi, nous le pressions de questions sur sa longue détention. Il y répondait volontiers en omettant, j’en étais sûr, les plus mauvais souvenirs. Il nous dit aussi que durant sa captivité il avait eu une relation épistolière avec une jeune bourguignonne.
C’était un de ses copains de captivité, garde forestier en Bourgogne, libéré prématurément, qui l’avait mis en relation avec la fille du garde qu’il avait remplacé. Avec cette jeune femme, Yvonne, il a donc correspondu pendant quatre ans. Elle était infirmière puéricultrice à Dijon.
Après sa libération, dès qu’il le put, il alla dans son village bourguignon pour enfin la voir en chair et en os. Ils se sont plus et ont décidé de se marier l’année suivante, après son retour d’Alger où il allait reprendre son travail à la banque pour pouvoir financer le mariage et le voyage.
Marie-Joséphine était ravie que son deuxième fils ait trouvé ’chaussure à son pied’, disait-elle. Georgeot resta donc une année avec nous en reprenant son travail à la Compagnie Algérienne. Souvent, le dimanche il nous amenait le jeune frère d’Yvonne, Roger, qui, après avoir été résistant, faisait son service militaire au fort l’Empereur. C’était un garçon très sympathique ce qui présageait que du bon pour sa sœur.
Le 15 août 1946 ce fut le mariage à Louesmes dans le châtillonnais bourguignon. Avec Marie-Joséphine nous regrettâmes de ne pas pouvoir nous y rendre, elle souffrait de phlébite et ne pouvait pas faire de grands voyages. Aussi je demandais à mon cousin Eugène, d’Orléans, de nous remplacer. Il s’y rendit avec sa fille Élisabethe et son gendre Marius. Ce dernier fut le témoin de Georgeot.
A la fin du mois d’août nous fîmes enfin la connaissance d’Yvonne qui avait suivi Georgeot à Alger. Elle nous a fait très bonne impression, le courant est tout de suite passé entre elle et Marie-Joséphine.
Le jeune couple s’installa dans un appartement de la rue de Constantine, pas loin de chez nous. C’étaient des cousins de Marie-Joséphine, les GALIERO, qui, allant au Maroc, libéraient leur appartement pour une année.
L’année 1946 fut aussi l’année de la naissance de Lyne, la fille de Germaine et Pierrot qui étaient toujours à Tunis. Guy avait maintenant une petite sœur. 1947 fut, elle, l’année de la naissance de Claude, le fils d’Yvonne et Georgeot.
A cette époque Marie-Joséphine souffrait toujours de ses jambes, elle ne pouvait plus se déplacer. Yvonne, qui maintenant habitait avec Georgeot sur les hauteurs d’Alger, venait la voir régulièrement avec le bébé. Elle avait aussi beaucoup de visites de sa famille, notamment de son frère Raphael.
Avec le temps son cœur s’affaiblissait toujours plus et le 2 septembre 1949 Marie-Joséphine nous quitta à la suite d’un malaise cardiaque fatal.

Sa disparition m’a profondément bouleversé, pendant 41 ans elle a toujours été à mes côtés et m’a épaulé et soutenu dans les moments difficiles comme, par exemple, lors de l’épidémie de typhus à Tiaret. Elle a toujours été une bonne épouse et une bonne mère.
Maintenant elle me manque énormément, malgré les attentions de mon entourage je n’arrive pas à combler ce vide. Des fois, je l’avoue, il m’arrive de penser que je serais mieux auprès d’elle..."
Eugène est décédé au N° 2 de la rue Lamoricière à Hussein-Dey, le 6 janvier 1951 à la suite d’une mauvaise grippe, à l’âge de 74 ans.











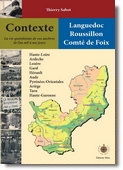















 D’Orléans à Alger, l’itinéraire d’une vie, (1877-1951) (3e Partie)
D’Orléans à Alger, l’itinéraire d’une vie, (1877-1951) (3e Partie)