
Le jeune garçon.
« Je m’appelle Maurice LEGENDRE, nous sommes en août 1940, je viens d’avoir 11 ans le 25 mai dernier. J’habite chez mon père et ma belle-mère dans le quartier des Hautes-Granges à Blois au n° 90 de la rue du même nom, une maison à toute proximité d’un pont de chemin de Fer de la ligne Orléans-Tours.

Mon père, Joseph LEGENDRE, fait partie de la Police Municipale comme Garde Champêtre du quartier. Ma mère, Régina HOUETTE, étant décédée en 1935, terrassée par la tuberculose, il s’est remarié un an plus tard avec Gisèle JUFFRAULT. Ils ont eu une petite fille qu’ils ont nommée Annick.

Le 3 septembre 1939, avec la déclaration de guerre de la France contre l’Allemagne, il a été mobilisé sur place en affectation spéciale dans la police municipale.
C’est au début du mois de mai qu’arrivèrent sur la route de Vendôme les premiers réfugiés. Cela nous arrivait avec Jacqueline et Raymonde GOUMIN, deux voisines de mon âge qui habitaient rue de la Mare à 50 mètres de chez mon père, de nous rendre au bord de cette route, à 500 mètres de chez nous, pour voir ce sinistre défilé.

C’était de longues colonnes composées de charrettes à chevaux, de voitures et de personnes à pied qui avançaient lentement vers la ville. Mon père qui, avec ses collègues de la police, faisait la circulation afin de les diriger sur l’autre rive de la Loire, nous disait qu’il s’agissait de belges et de néerlandais qui fuyaient les allemands qui avaient envahis leur pays.
A partir de début juin, après une courte accalmie, avec l’attaque sur la somme, l’exode recommença plus intense. Cette fois-ci, il s’agissait de français du nord et de la Picardie. Ils avaient l’air harassés et apeurés. Une fois, un vieux monsieur qui s’était arrêté sur le bas côté pour se reposer, assis à côté de sa petite valise, nous raconta qu’ils avaient été mitraillés par les avions allemands, deux jours auparavant. Lui s’en était sorti indemne, mais cela n’avait pas été le cas d’une famille proche de lui qui avait été décimée. Il a même vu, plus loin, deux enfants de trois, quatre ans, pleurer sur le cadavre de leur mère. Après nous avoir raconté cela, il ne put empêcher les sanglots l’envahir. Avec les filles GOUMAIN, nous aussi, nous avions les larmes aux yeux.
A partir du 12 juin se mêlèrent à la foule des réfugiés, des militaires battant retraite. C’étaient des camions et voitures militaires, des pièces d’artilleries hippomobiles et des fantassins qui avaient du mal à se frayer un chemin au travers de la masse des déplacés.
Les jours suivants, à Blois, la situation s’empira. Quand il rentrait le soir, mon père nous disait combien il leur était de plus en plus difficile, à lui et à ses collègues, de régler la circulation. Les trois routes principales qui convergent vers la ville, la route de Vendôme, celles de Châteaudun et d’Orléans étaient complètement congestionnées. Il fallait six heures pour parcourir les deux kilomètres qui mènent de l’entrée en ville, par l’avenue de Vendôme, jusqu’au pont sur la Loire.
Lui et ses collègues s’évertuaient à dégager les voies nord-sud, celles venant de Vendôme et de Châteaudun, si bien que les voitures venant d’Orléans, par l’avenue Maunoury, étaient obligées de stationner plusieurs heures.

Le 14 juin mon père rentra tard à la maison après une longue journée harassante. Il nous apprit que le préfet avait décidé l’évacuation des enfants de plus de 13 ans et des hommes mobilisables. Bien que nous n’étions pas concernés, ma belle mère commença à paniquer.
Nous allâmes nous coucher, je n’ étais pas très rassuré. Vers 2 heures du matin nous fûmes réveillés par le hurlement des sirènes et des éclatements de bombes qui nous parurent assez proches. Nous nous précipitâmes dans la cave de la maison. Mon père nous dit que c’était probablement le pont
des Granges qui venait d’être bombardé. Ma belle-mère était dans tous ses états, ma petite sœur n’arrêtait pas d’hurler, ayant été réveillée en sursaut. Au bout d’une heure, n’entendant plus aucun bruit à l’extérieur, nous remontâmes nous coucher.

Le lendemain je me suis réveillé un peu tard, après mon petit déjeuner ma belle-mère me demanda d’aller porter la gamelle de mon père au commissariat. Je pris mon vélo et partis vers le centre ville par la rue de la mare.
Au pont des Granges, je m’arrêtais pour voir les dégâts. L’édifice était intact, seulement quelques maisons à proximité avaient été touchées. Il ne restait debout que quelques pans de mur, les pompiers étant repartis, quelques hommes s’affairaient avec des seaux d’eau pour éteindre de rares flammèches qui persistaient.
Je me dirigeais vers un groupe de personnes en grande discussion. C’est ainsi que j’appris qu’il n’y avait pas eu de victimes, tout le monde s’étant réfugié dans les caves. Les gens étaient étonnés de la maladresse des pilotes car le pont et la gare étaient épargnés, seules quelques maisons alentour et le cimetière avaient été touchés.

Je repris ma course pour aller au commissariat. Je descendais donc la rue de la Mare, la rue du Pont du Gast pour arriver au square Victor Hugo, au bas du château. Jusque là, tout allait bien, je roulais normalement bien que quelques habitants se préparaient à partir, probablement affolés par le décret préfectoral de la veille.
Arrivé au square les choses changèrent, la rue Porte côté était envahie par une marée humaine venant de la rue Gallois. Je m’engageais dans la foule de réfugiés, obligé parfois de forcer le passage avec ma bicyclette.
Au niveau de la rue Porte-Chartraine, ce fut l’arrêt complet pendant un bon quart d’heure. Des collègues à mon père laissaient passer le flot de réfugiés qui venait de la rue Porte-Chartraine et se dirigeait vers la rue du Commerce.
Au bout d’un bon moment j’arrivais au pied de l’escalier Denis Papin. L’escalier monumental était bourré de monde, certains se restauraient d’autre dormaient à même la pierre. Tous avaient l’air éreintés.

Je quittais la foule des réfugiés qui suivait la rue Denis Papin, en empruntant la rue Haute qui me dirigeait vers le vieux Blois, en bas de la cathédrale. Là, j’étais plus tranquille, la rue était quasiment déserte, je pouvais foncer. J’enfilais la rue des Juifs, celle de la Foulerie pour arriver au commissariat où je déposais la gamelle de mon père.
Pour le retour ce fut plus facile, je suis passé par la place Louis XII, au dessous du château, et en suivant les fossés de ce dernier j’arrivais au square Victor Hugo pour reprendre la rue du Pont-du-Gast et la rue de la Mare.
Tout ce trajet me prit deux bonnes heures, alors qu’habituellement j’en avais pour même pas une heure. En arrivant à la maison j’étais éreinté et extrêmement troublé par ce spectacle de misère dont j’ai été le témoin.
C’est le lendemain, le dimanche 16 juin, que, nous aussi, nous quittâmes Blois pour rejoindre la foule des réfugiés qui allait vers le sud.
En tout début de matinée je fus réveillé par des éclatements de bombes provenant du centre ville. Mon père était déjà depuis longtemps parti au travail à faire la circulation. Ma belle-mère était dans tous ses états, elle se faisait du souci pour son mari.
Vers 9 heures du matin, nous le vîmes arriver en vélo, tout essoufflé, il nous dit que la police avait reçu l’ordre de se replier. Il nous dit aussi que les bombardements avaient fait de nombreuses victimes car les gens, n’ayant pas été alerté par les sirènes, n’ont pas été dans leur cave pour s’abriter. C’était une escadrille de sept avions qui remontait la Loire, qui après le bombardement se dirigeait vers Orléans. D’après lui, pas des avions allemands car ils avaient une cocarde, peut-être des italiens…
Après avoir dit à ma belle-mère de préparer quelques affaires, il alla chez les GROUTEAUX au 6 rue de la Mare, un vieux couple de cultivateurs amis de mon père, pour leur dire qu’il fallait partir. Le père GROUTEAUX attela une charrette chargée d’affaires à deux de ses chevaux et proposa à mon père de nous amener. Il voulait se rendre chez un de ses cousins qui était fermier dans un petit village, la Rabotière, au sud de Montrichard.
Nous descendîmes la rue de la mare, passâmes le square, là nous étions suffoqués par les fumées des incendies venant de la place Louis XII qui avait été bombardée au petit matin. Arrivés au pont nous pouvions voir les fumées qui s ‘échappaient de ce quartier.

Nous mîmes deux heures pour passer le pont sur la Loire au milieu des civils et des militaires qui battaient retraite. Ces derniers étaient pris en charge, à l’extrémité de l’édifice, par un officier. En effet des soldats étaient dissimulés derrière des sacs de sable de chaque côté du pont face à la Loire, il y avait même quelques pièces d’artillerie légère. Parmi les militaires les uniformes étaient divers, on pouvait même voir, d’après mon père, des tirailleurs sénégalais, marocains et des zouaves.
Une fois le pont passé, nous allâmes tout droit dans la direction de Saint-Gervais-la-forêt, un village situé à environ 3 km de la ville. Nous traversâmes le faubourg de Vienne pour arriver au pont du Cosson. C’est à ce moment, il était à peu près midi, qu’il y eut un second bombardement de la ville.
Alertés par le bruit de leurs moteurs, nous vîmes arriver les avions sur nous venant de la direction de la basilique. Il y en avait de 15 à 20, je n’ai pas eu le temps de les compter précisément. Ils délestèrent leurs bombes sur la ville puis foncèrent au dessus de nous dans la direction de Cellettes.

Après le passage des avions nous montâmes la côte de Saint-Gervais, à côté de notre charrette, seul monsieur GROUTTEAUX conduisait cette dernière. La montée fut harrassante, au milieu des autres réfugiés à pied ou en auto et il faisait très chaud. Arrivés au sommet, sur notre gauche, au niveau des carrières des Perrières et des Clouseaux, nous vîmes une demi-douzaine de pièces d’artillerie lourde sous leur camouflage. Ce qui expliquait qu’elles n’aient pas été bombardées par les avions.

La côte montée, madame GROUTTEAUX, ma belle-mère et ma sœur montèrent dans la charrette, mon père et moi suivions à pied. Nous continuâmes donc notre route, en dépassant le village de Saint-Gervais, jusqu’à la patte d’oie. Arrivés à cette dernière nous prîmes la direction de Cellettes pour passer le Cher à Montrichard. Là, le flux des réfugiés fut moins dense, la plupart des gens allèrent tout droit en direction de Romorantin. Nous étions moins serrés et pouvions allonger un peu plus le pas. Mais nous étions toujours gênés par les vélos qui forçaient le passage à travers les piétons , les charrettes et les automobiles qui roulaient au pas.
C’est dans ces conditions que nous avons traversés le forêt de Russy, toujours sous une chaleur épouvantable. Au sortir de la forêt nous nous arrêtâmes dans une petite ferme au bord de la route pour faire boire les chevaux et nous restaurer avec les provisions que nous avions amenées avec nous. Le fermier nous a très bien accueillis et même proposé de nous mettre à l’ombre et à la fraîcheur dans une de ses granges. Après s’être substanter, le soir venant, nous décidâmes, avec l’accord du propriétaire, de passer la nuit dans la grange, car nous étions tous épuisés. Je me suis vite endormi dans un sommeil lourd et accablant…
A la toute fine aurore, je fus réveillé en sursaut par le hennissement d’un cheval. J’eus peine à reprendre connaissance, je me retrouvais au milieu de la cour de la ferme, ne sachant pas où j’étais, mi inconscient. C’est la fermière, déjà levée, qui me ramena à la grange où tout le monde dormait encore. Elle réveilla mon père en lui disant que j’avais fait une crise de somnambulisme. Crise probablement due à la dureté des évènements vécus la veille...

Vers 9h du matin, nous reprîmes la route en direction d’Ouchamps. Le trajet se fit dans les mêmes conditions que la veille, sous la chaleur mais avec un peu moins de monde car un bon nombre, à Cellettes, ont pris la direction de Selles sur Cher.
En mi journée, nous fîmes boire les chevaux à la fontaine du petit village de Chevenelle puis nous nous sommes arrêtés à l’orée d’un petit bois situé à proximité de la bourgade. Là, nous pûmes nous restaurer et nous reposer.
Au bout de près de 2h d’arrêt nous sommes repartis vers Ouchamps. C’est en fin d’après midi que nous sommes arrivés à proximité de ce village sur un terre-plain qui bordait la route. Nous nous installâmes là pour nous restaurer et passer la nuit. Les réfugiés continuant de défiler sur la route en direction de Pontlevoy, mon père et monsieur GROUTTEAUX décidèrent, pour la nuit, de monter la garde alternativement comme à l’armée, disaient-ils, pour dissuader toute tentative de vol.

Après une nuit au sommeil agité, nous reprîmes la route en direction de Pontlevoy. Même scénario que la veille et dans les mêmes conditions. Après une assez longue pause, à midi, à proximité de Sambin, nous arrivâmes à Pontlevoy en fin d’après midi. Nous nous arrêtâmes sur la place du marché où déjà de nombreux réfugiés s’étaient installés pour passer la nuit.
Là, nous apprîmes l’occupation, dans la journée, de Blois par les allemands et l’appel à cesser le feu, la veille, du maréchal Pétain. Ces deux nouvelles nous mirent dans l’expectative, qu’allions nous faire le lendemain ?… Après longue réflexion, monsieur GROUTTEAUX décida de continuer comme c’était prévu : aller à la Rabotière, chez son cousin, et après, prendre une décision selon les circonstances.
Après une nuit aussi agitée que la précédente nous partîmes pour Montrichard, en milieu de matinée, il nous restait une dizaine de kilomètres pour y arriver. A mi chemin, nous entendîmes le bruit d’une énorme déflagration. Monsieur GROUTTEAUX redoutait que ce soit le pont qui ait sauté.
En descendant dans la vallée, à l’entrée de la ville autour de la place du marché ce n’était que ruines. Nous apprîmes plus-tard que Montrichard avait été bombardée le même jour que Blois, probablement par les mêmes avions que nous avions vus bombarder notre ville. Nous continuions à descendre vers le centre pour arriver au pont. Les craintes de monsieur GROUTTEAUX s’avérèrent fondées. La quatrième arche du pont avait disparue. Les soldats français l’avaient fait sauter pour retarder l’avance allemande.
Impossible de traverser le cher. Le vieux paysan pestait car, d’après lui, nous n’étions, à vol d’oiseaux, qu’à environ 3 km de la Rabotière, de l’autre côté de la rivière… Nous restâmes donc à Montrichard pour passer la nuit.
Le lendemain matin nous repartions pour Blois. En sortant de la ville nous rencontrâmes des convois de soldats allemands qui s’apprêtaient à investir l’ agglomération. Le voyage fut plus rapide qu’à l’aller, il nous a fallu à peine deux jours pour apercevoir, du haut de la côte de St Gervais, à quelques petits kilomètres de là, la ville de Blois dominée par le château, la cathédrale St Louis et la basilique.

Nous traversâmes le faubourg de Vienne par l’avenue Wilson, sur notre droite nous aperçûmes la centrale électrique partiellement endommagée par un bombardement. Plus nous avancions vers le pont, plus il y avait de ruines de part et d’autre de l’avenue. Ces dégâts avaient été provoqués, nous a-t-on dit, par l’artillerie allemande qui a pilonné pendant deux jours nos soldats qui ont vaillamment empêché les allemands de passer la Loire avant d’être obligés de se replier pour ne pas se faire prendre à revers par l’ennemi qui venait de prendre Romorantin, plus au sud.
Arrivés au pont, notre marche fut ralentie car l’arche centrale, ayant été détruite par le génie français quand les allemands sont entrés dans la ville, fut remplacée, par les allemands, par une passerelle en bois relativement étroite.
L’édifice traversé, le spectacle de désolation était encore plus terrifiant. Des deux côtés de la rue Denis Papin ce n’était que chaos. Toutes les habitations étaient en ruines, soit par les incendies provoqués par les bombardements allemands, soit par les tirs de l’artillerie lourde française, située en haut de la côte de Saint-Gervais, qui défendait le pont.

Nous sommes enfin arrivés dans notre quartier des hautes-Granges, quitté depuis une semaine, après avoir croisé de nombreux soldats allemands. Contents de retrouver nos logements et de pouvoir reprendre une vie quasiment normale malgré l’occupation allemande, mon père ayant retrouvé son poste à la police municipale.
Le jeune rappelé sous les drapeaux
« Je m’appelle Georges THORET, je viens d’avoir 25 ans le 13 février dernier. Avant la guerre j’habitais chez mes parents dans la périphérie d’Alger. J’étais employé de banque à la Compagnie Algérienne dans cette ville.
J’ai été mobilisé le 2 septembre 1939 à Orléans, alors en vacances chez la sœur de mon père. C’est à proximité de cette ville que mon régiment, le 266e R.A.N.A.L, régiment hippomobile d’artillerie lourde, s’est formé. Je fus affecté à la 13e batterie comme chef de pièce. Puis nous sommes partis dans le nord à Obies entre Valenciennes et Maubeuges.

Là, nous sommes restés 5 mois où le temps était partagé entre l’entretient du matériel et des chevaux, les parties de foot entre copains, les parties de cartes et, de temps en temps, quelques agapes.

La guerre (02 avril 1940 - 11 juin 1940)
* A la frontière de l’Est.
Le 4 avril 1940 nous partîmes en train vers l’est pour arriver à Jarville, près de Nancy. De là, le régiment se reforma et au bout de de plusieurs étapes, nous arrivâmes à Neufgranges, près de la ligne de front à proximité de Sarreguemines, le 30 avril, en attente de relever en ligne une autre batterie de notre régiment.
Dés notre arrivée nous fîmes le baptême du feu et reçûmes fusants et percutants de l’artillerie ennemie. A partir de ce moment là, il y eut, pendant une dizaine de jours, une très forte activité des deux artilleries.
* En Champagne.
Le 17 mai, tout le régiment fit un repli stratégique, en plusieurs étapes, jusqu’à Dieuze, à une cinquantaine de kilomètres plus au sud, où nous embarquâmes le 26 mai pour la champagne. Nous arrivâmes le lendemain à Cuperly situé à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Reims.
Après plusieurs étapes plus ou moins longues, nous arrivâmes le 10 juin à Nogent-le-Sermier où nous mîmes en batterie. Nous avons tiré de 7h du matin jusqu’à 17h, nous avons aussi été bombardés, mais les pièces n’ont pas été touchées, car elles étaient très bien cachées derrière un mur et de grands arbres, les rendant invisibles aux avions ennemis.
Nous partîmes de Nogent le Sermiers vers 20 heures. Nous reculions car l’ennemi n’était pas très loin (4 ou 5 km).
Nous arrivâmes à Hautvillers vers 6 heures du matin. En cours de route nous avons rencontré des chevaux crevés et des canons de 75 abandonnés le long de la route, probablement abandonnés par les 14e et 15e batteries de notre régiment qui étaient devant nous.
Arrivés dans le village déjà presque encerclé et défendu par le 6e RTA (tirailleurs algériens), nous mîmes les canons à l’abri dans une espèce de grotte et nous nous camouflâmes dans les caves des maisons, car l’artillerie ennemie nous bombardait sans arrêt. On a ensuite mangé la soupe sous le préau de l’école. Puis je me suis camouflé dans la grotte avec les canons. Pendant ce temps là, la canonnade continuait presque sans intervalle. On se voyait déjà faits prisonniers. Une heure après, le capitaine prit la décision de nous faire tirer de la place du village, pour soutenir le 6e RTA qui se défendait avec acharnement. On a tiré douze coups de canon et on a eu, de suite, la riposte, très accentuée, de l’ennemi. C’est alors que le commandant de groupe a ordonné de se sauver où on le pouvait. C’est à ce moment que la retraite a commencé pour notre régiment, nous étions le 11 juin.
La retraite et la capture ( 12 juin 1940-17 juin 1940)

« Dès la prise de décision de battre en retraite, nous avons essayé de ré-atteler la batterie. Seul un canon sur les quatre était en bon état, nous dûmes saborder les trois autres. Nous partîmes donc avec quelques chariots et quelques fourgons dont celui de la roulante (cuisine).
La sortie du village fut chaude, nous roulions à brides abattues, protégés sur les deux flancs par les tirailleurs, certains se battaient à corps à corps. Cette déroute se déroulait sous les tirs des mitrailleuses et de l’artillerie allemande. Nous nous en sommes, ma foi, bien tirés...
Donc, nous sommes partis du côté de la Marne avec tout le matériel que nous avons pu amener. Nous avons traversé un petit village tout en feu et Ay, sous un bombardement intense, en nous protégeant tant que faire se peut. Nous sommes quand même arrivés à passer le pont sur la Marne et le pont sur un canal. Ces deux édifices ont sauté juste après notre passage.
Nous sommes arrivés à Avize sous une pluie battante, nous étions trempés comme des canards. Nous nous sommes arrêtés prés de la gare pour manger un peu et, vers 6 heures, nous changer avec le linge qui nous restait. Nous sommes repartis vers 21 heures, après avoir dormi une heure. Nous avons profité de la nuit qui nous protégeait des avions.
Le 12 juin 1940 à 6 heures nous étions à Vertus. On s’installa dans le parc d’un superbe château abandonné où j’ai goûté du vin de 1876. C’est le Champagne qui nous menait, car le pain et le ravitaillement nous faisaient défaut. Je me suis même rasé au champagne…
Nous sommes sortis de Vertus vers 16 heures en direction de Pierre-Morains nous avons dépassé ce village et sommes arrivés dans un bois, prés de Gourgançon, où nous nous sommes installés pour manger et passer la nuit. Nous étions exténués.
Le 13 juin, nous sommes repartis vers 8 heures, avec toujours la menace de l’ennemi derrière nous. Aussitôt après avoir quitté ce bois, nous avons été attaqués par des bombardiers légers qui piquaient sur nous et nous bombardaient à outrance. Après ce bombardement, j’ai réussi, avec des conducteurs qui ne s’étaient pas sauvés, à ramener un chariot et à rejoindre la colonne qui s’était reformée parmi les véhicules civils et militaires qui avaient repris leur lente progression..
Dans un village situé à 6 ou 7 kilomètres de Gourgançon, je fis arrêter mon chariot dans une ferme abandonnée pour faire boire les chevaux et prendre un peu d’avoine. Au moment où les montures buvaient dans la cour de la ferme, les avions revenaient vers nous et recommençaient le même manège que précédemment. Le chariot a dû être repéré, car un des avions s’est dirigé vers nous, nous avons eu juste le temps, les conducteurs et moi, de nous camoufler dans les escaliers de la cave du bâtiment avant qu’il ait lâché ses bombes. Un des deux chevaux, encore attelés, a été tué, décapité par un obus, l’autre, blessé, nous avons été obligé de l’abattre. Les autres montures, dételées, s’étaient sauvées. On était recouverts de morceaux de briques et de débris de vitres ( mon casque était tout cabossé). N’ayant plus de chevaux, nous avons abandonné le chariot et sommes partis à travers champs à la rencontre de la batterie.
Après une marche éreintante de 8 heures, nous avons enfin rejoint la batterie à Arcis sur Aube. Nous avons traversé cette petite ville où plusieurs maisons avaient été démolies par les bombardements. Nous sommes passés sur un pont sur lequel se trouvait une torpille non éclatée ( le pont a sauté le lendemain matin, au dire des copains). Sur la place, il y avait encore un de ces horribles engins. Nous avons continué notre route vers Troyes. Un vieux coucou nous survola, ce n’était pas de bon présage...
Nous sommes arrivés à Troyes, le 14 juin, à 3 heures du matin. Dans la rue principale, beaucoup de maisons étaient encore en feu, la ville venait d’être bombardée. Nous progressions difficilement à travers les grabats. Il a fallu passer un pont à moitié démoli. Pour cela, nous avons été obligés de laisser le canon qui nous restait et trois chariots. Nous avons poursuivi notre route avec un fourgon, le caisson téléphonique et la roulante.
A la sortie de Troyes, nous fûmes encore bombardés. Nous nous sommes camouflés prés d’un lac. Après le bombardement, nous avons rejoint un petit bois, où nous ne nous sommes reposés que deux heures, car nous fûmes alertés par l’artillerie motorisée ennemie qui canonnait pas très loin de nous.
Nous avons démarré en vitesse et nous nous sommes dirigés vers Bar-sur-Seine. Pendant tout le trajet, nous avons été bombardés toutes les heures par des escadrilles de trente avions et plus. A chaque fois il fallait se camoufler dans les fossés ou dans des bosquets en bord de route. Nous n’avons pas eu de dégâts. Fait à signaler : pendant toute la retraite nous n’avons pas vu un seul avion français.
Nous sommes arrivés à Bar-sur-Seine où nous avons rejoint de nombreuses colonnes de réfugiés civils et de militaires en débandade (comme nous). Le spectacle était assez lamentable. Tout le monde était harassé, surtout ceux qui étaient à pied. Les vélos avaient du mal à se frayer un chemin, certains mettaient pied à terre. Véhicules civils et militaires progressaient au pas.
Nous nous sommes réfugiés encore dans un bois. Là, nous avons mangé quelques biscuits et bu un peu de champagne ( toute notre nourriture ). Nous nous sommes reposés deux ou trois heures, puis direction Châtillon-sur-Seine, abandonnant la nationale pour passer par Laignes. Là, la route était moins encombrée nous pûmes accélérer un peu plus notre progression.
le 15 juin vers 18 heures, nous approchions de l’entrée de la capitale du châtillonnais bourguignon quand une escadrille d’avions allemands fit son apparition. Nous nous sommes précipités dans les fossés bordant les murs d’un château, à l’entrée de la ville.
Ce furent plutôt le centre de la ville et la gare qui étaient visés. Les avions disparus, nous sortîmes du fossé et reprîmes notre route. Il nous a fallu plus de trois heures pour traverser la ville (environ 3km). Tout était en ruine sur, à peu près, une longueur de un kilomètre cinq cent et une largeur de cent à trois cent mètres. De nombreuses maisons étaient en feu, les rues obstruées par des grabats et embouteillées par les pompiers et la défense passive.
Nous avons mis la main à la patte pour aider à dégager le chemin. Mon camarade Monroziés, chef de pièce lui aussi, ne dérageait pas, il était à à peine 20km du village où il était, avant la guerre, garde forestier et ne pouvait pas voir sa famille…
Nous sortîmes de la ville vers 21 heure en prenant la direction du sud, toujours dans la foule de réfugiés et de militaires en déroute.

Le 16 juin à 7 heures, nous avons fait halte dans une grande ferme où nous avons pu faire un peu de toilette et manger un peu. Avant de partir de cette ferme, nous avons vu le patron qui rentrait chez lui. Il nous a dit qu’il avait vu des allemands et que l’armistice était signé.
Nous avons continué notre route, sans les bombardements, cette fois-ci. Vers midi, nous sommes arrivés à un carrefour où des militaires français nous faisaient signe de prendre la route sur notre gauche en direction d’Aignay-le-duc.

Mais vers 17 heures, nous fûmes coincés à un carrefour, nous n’avancions plus. Guidés par l’intuition du capitaine d’état-major de notre régiment qui suspectait les militaires qui nous ont orientés d’appartenir à la 5e colonne [1], nous avons rebroussé chemin et nous nous sommes réfugiés dans un bois situé à 1 kilomètre de là. Bien nous en a pris, car juste au moment où nous sommes entrés dans ce bois, une dizaine d’avions italiens vinrent bombarder avec acharnement le carrefour où étaient groupés de très nombreux militaires isolés.
Nous sommes restés là jusqu’à la tombée de la nuit, avons bu un peu de bouillon KUB, trouvé en cours de route. En reprenant notre route, nous sommes passés à l’endroit du bombardement, où nous pûmes apercevoir, sous le clair de lune, dans les fossés, des carcasses de véhicules civils et militaires parfois calcinées. Après 5 heures de route nous sommes arrivés à Courtivron, le 17 juin vers 4 heures du matin.
Nous nous sommes installés dans le parc du château du village. La comtesse DE COURTIVRON vint nous voir vers 7 heures et dit à notre capitaine d’état major que les allemands étaient passés dans le village avec leurs tanks.
Après cette nouvelle, nous avons fait notre toilette dans la rivière qui traversait le parc et nous nous sommes reposés. En milieu de matinée le capitaine nous a intimé de jeter nos armes dans ladite rivière, car d’après lui, l’heure de la capture n’allait pas tarder.
A midi, nous avons mangé des provisions données par des civils et partagé un pain de 1 kilo en 20 parts (première bouchée de pain depuis huit jours ).
Vers 14 heures, un officier allemand et quelques hommes de troupe sont venus nous cueillir…
Prisonniers de guerre à partir de ce moment là : le 17 juin 1940 »
Le vétéran de 1914.
« Je m’appelle Gabriel STOLL, en juin 1940 j’avais 58 ans. J’étais domicilié à Louesme en Côte d’or, dans le châtillonnais, où j’étais garde forestier aux Eaux et Forêts. En retraite depuis trois ans, j’ai dû reprendre du service quand mon remplaçant a été mobilisé.

A cette époque là, je vivais avec ma famille dans une maison au bout du village sur la route de Montigny-sur-aube. Nous demeurions dans une ancienne ferme dont le bâtiment principal était divisé en deux habitations, la nôtre et celle de la propriétaire, madame AUBRY.

C’est là qu’avec Lucie, ma femme, nous avons élevé nos quatre enfants ; Louis, Yvonne, Raymonde et Roger, le petit dernier. En 1940, il n’y avait que Raymonde et Roger qui vivaient avec nous. Louis habitait à l’autre bout du village, sur la route de Leugley, où sa femme tenait un café, lui était platrier-peintre à son compte. Yvonne, elle, habitait Troyes où elle était infirmière puéricultrice à la crèche de l’usine Michelin.
Dès la mi-mai 1940 nous pouvions voir passer devant la maison, quelques groupes de réfugiés qui venaient de Bar-sur-Aube par la route de Montigny. C’étaient, pour la plupart, des belges, des néerlandais et des picards qui fuyaient les combats qui avaient commencés, dans le nord, dès début mai.
A la mi-juin, les groupes devinrent plus nombreux. C’est dans la matinée du 14 juin que nous vîmes arriver dans notre cour une berline que nous n’avions jamais vue auparavant. Notre fille Yvonne en sortit et vint nous expliquer ce qu’il en était.
Elle était avec la famille NIEGARTEN, les gens qui lui louaient une chambre dans leur maison, à Troyes. Lui, était ingénieur chez Michelin, c’est comme ça qu’elle les avait connus. Elle nous expliqua qu’ils avaient quittés Troyes la veille au soir pour fuir l’avancée des troupes allemandes. Elle leur avait donc proposé de faire une halte à Louesme avant d’aller plus au sud.
Nous fîmes donc descendre de leur voiture toute la famille. Il y avait les deux parents et trois adolescentes dont deux jumelles. Nous les fîmes entrer dans la maison afin qu’ils se mettent à l’aise.
Là, ils nous racontèrent comment ils prirent la décision de partir de chez eux en emmenant le nécessaire. C’est le bombardement de Pont-Sainte-Marie, à 4 km de Troyes, qui les décida, redoutant le même sort pour leur ville.
Après manger, ils allèrent tous se reposer car ils avaient voyagé toute la nuit. Le soir, au dîner, après une longue discussion nous décidâmes la chose suivante : Lucie et nos trois enfants, Yvonne, Raymonde et Roger, partiraient, eux aussi, avec les troyens. Moi, je restais à Louesme ne voulant pas abandonner mon poste.
Le lendemain matin, je suis allé chez mon voisin et ami, Émile MASSON , cultivateur, pour lui annoncer notre décision. Là, il me tint ce langage de sa voix forte : « Tu as raison de rester, Gabriel, nous, ‘ceux de 14’, toi qui a fait Verdun et moi, les Dardanelles, nous n’allons quand même pas nous sauver comme des lapins devant les boches !... ».
Il attela un de ses chevaux à une charrette et me confia l’attelage. De retour à la maison, avec Lucie et les enfants, nous chargeâmes la carriole avec des provisions, des effets et quelques autres affaires. Au moment de partir, nous y installâmes madame AUBRY, notre voisine et propriétaire, ne pouvant plus marcher, sur son fauteuil Voltaire, son coffret à bijoux sur les genoux…

Quand tout le monde fut prêt, la charrette, conduite par Roger, suivie par la berline des troyens, au centre du village, quitta le flot des réfugiés qui continuait dans la direction de Leugley, en prenant le chemin de Vanvey pour aller dans la direction de Baigneux-les-Juifs, plus au sud-ouest.
Après leur départ, je suis parti au travail, en vélo, dans les bois de Lachaume où j’avais un chantier d’essartage à superviser. Le soir j’ai dîné chez les MASSON avant de rentrer à la maison où je me suis senti bien seul en me demandant si ma famille allait bien et si leur périple se passait sans encombre.
Le lendemain, le 16 juin, en fin d’après midi, mon travail terminé dans le bois de Lachaume, je rentrais, toujours à vélo, par la route de Leugley. Les groupes de réfugiés qui me croisaient étaient de moins en moins nombreux. Arrivé au village en allant à la maison, je passais devant la ferme des parents de ma belle fille, Madeleine. Je vis cette dernière, avec sa petite fille Monique, qui discutait dans la cour avec sa mère.
Je descendis de vélo et entrait dans la cour pour aller aux nouvelles. Nous discutions depuis un quart d’heure, peut-être, quand, à notre grande stupéfaction, un side-car allemand passa à allure modérée devant la ferme.
Nous l’entendîmes faire demi-tour puis il entra dans la cour. Les deux hommes descendirent de leur engin, le conducteur pointa son arme vers moi, instinctivement j’ai levé les bras. L’officier, lui, se dirigea vers moi et m’enleva avec force, sans un mot, mon arme de service que nous, les gardes forestiers portions depuis le début de la guerre, puis Il me plaqua brutalement contre le mur de la cour.
Je voyais mes derniers instants arrivés, quand madame BERNAERT, la mère de ma bru, leur cria en flamand, car elle était belge, que j’étais un civil, garde forestier, et que je n’avais rien à voir avec l’armée. Ils discutèrent un moment, moment qui me parût une éternité, puis l’officier me lâcha brusquement, l’autre rabaissa son fusil et ils repartirent sans dire un mot.
J’avoue être resté quelques instants, tout de suite après leur départ, dans un état second. Seuls les sanglots de ma petite fille Monique, âgée de 4 ans, résonnaient fortement dans ma tête. Mais je repris rapidement mes esprits quand madame BERNAERT m’apporta sur le champs un verre d’eau de vie de prune. Puis me vinrent à l’esprit les semblables moments passés dans les tranchées de Verdun.
Le soir j’ai dîné avec ma salvatrice et son époux, nous étions atterrés, les allemands étaient sur nos terres. Ce moment tant redouté venait d’arriver, quel avenir allait-on avoir ? Ensuite je suis rentré chez moi, envahi d’idées noires. Est-ce que Lucie et les enfants avaient, eux aussi, rencontré les allemands, où étaient-ils, étaient-ils en sécurité ?
C’est le lendemain que nous apprîmes, à Louesme, le bombardement, la veille, de Châtillon. Cela ne me rassura pas pour ma famille. Le soir, avec Émile MASSON, nous avons entendu, à la TSF, le discourt du maréchal Pétain. Il disait qu’il voulait l’armistice et qu’il fallait cesser le combat. Avec Émile, nous étions sidérés. Le héros de Verdun qui demandait de déposer les armes !?…
Le lendemain, le 18 juin, en rentrant des bois, j’eus la surprise de voir, dans la cour, la berline des troyens et les trois adolescentes qui jouaient à côté. Ils venaient d’arriver, il y avait une heure. Émile avait repris son cheval et sa charrette.
J’étais content de les voir tous, ma foi, fatigués mais en bonne forme. Je voulais tout savoir de leur épopée. C’est alors que mes deux filles, Yvonne et Raymonde me racontèrent leur périple.

En prenant le chemin de Vanvey, à la sortie du village, chemin de terre carrossable, ils traversèrent la forêt de Lugny pour aboutir au dit Vanvey. Puis ils longèrent la forêt de Châtillon entre Villiers-le-Duc et St-Germain-le-Rocheux.
Vers 15heures, ils entendirent un bruit sourd, comme un grondement de tonnerre, venant du nord-ouest. Ils apprirent plus tard qu’il s’agissait du premier bombardement subit par la ville de Châtillon-sur-Seine, située à une dizaine de kilomètres, à vol d’oiseaux, Là, ils firent une halte et se rassasiaient.
Ils dépassèrent St-Germain-le-Rocheux. Vers 18 heures, ils entendirent un autre grondement vers le nord , c’était une deuxième vague de stukas qui bombardait à nouveau Châtillon. Ils finirent par s’arrêter à Busseaut, dans une grange à foin où ils mangèrent et passèrent la nuit.
Le lendemain matin, le 16 juin, ils reprirent la route, ils n’avaient pas bien dormi. Ils étaient encore fatigués, surtout madame AUBRY affaiblie par son grand âge. Ils prirent la direction de Baigneux-les-Juifs, en passant par Origny, le village natal de Lucie.
Là, à Origny, ils prirent la N 32 qui mène à Dijon par Aignay-le-Duc. La route était encombrée par de nombreux militaires qui battaient retraite et de nombreux réfugiés, comme eux. A 5 kilomètres d’Aignay, ils prirent la D 954 en direction de Baigneux-les-Juifs. Là, ils retrouvèrent plus de calme.
Vers midi, ils s’arrêtèrent à Quemigny pour se restaurer. C’est dans ce village qu’ils apprirent les bombardements de Châtillon. Certains habitants disaient avoir vu des allemands filer vers Dijon. Des rumeurs de cessez-le-feu circulaient aussi dans le village. Après réflexion, vu la situation, ils décidèrent alors d’arrêter leur fuite devenue inutile.
Le lendemain, le 17 juin, après une nuit passée à Quémigny, ils prirent le chemin du retour. Quand ils repassèrent sur la N 32, ils rencontrèrent, dans l’autre sens, des colonnes de soldats français, prisonniers des allemands, se dirigeant vers Dijon.
Ils s’arrêtèrent à Origny où Lucie avait toujours de la famille. C’est là, le soir, qu’ils entendirent le discourt du maréchal Pétain. Après une nuit réparatrice dans ce village. Ils reprirent la route pour Louesme où ils arrivèrent en milieu d’après-midi, le 18 juin.
Entre-temps, ma bru, Madeleine, était entrée chez nous pour prendre des nouvelles des ex-réfugiés. Quand les filles eurent fini leur récit, elle leur raconta ce qu’il m’était arrivé l’avant veille. Tous furent émus et consternés.
Le lendemain, les NIEGARTEN reprirent la route pour Troyes, après avoir laissé, par sécurité, leurs deux jumelles, encore adolescentes, en pension chez nous. Yvonne, elle aussi, resta à Louesme avec nous. »
Ce que l’on peut retenir de ces récits
Ces trois récits nous montrent trois vécus différents de cette période tragique. D’abord, le jeune garçon qui fuit, avec sa famille, sa ville bombardée prête à être investie par les allemands, le jeune rappelé sous les drapeaux qui bat en retraite, avec son régiment, pourchassé par l’ennemi et, enfin, le fonctionnaire, vétéran de 1914, qui ne veut pas abandonner son poste malgré l’avancée allemande.
Ils nous montrent aussi l’étendue de ce phénomène d’exode qui aurait touché huit à dix millions de personnes. Son ampleur était due, certes, à la fuite des habitants des zones de combat, mais aussi à celle de populations plus éloignées, intoxiquées par de fausses nouvelles alarmantes diffusées par la 5e colonne. Le but de cette dernière étant d’encombrer les routes afin de gêner la retraite des troupes françaises de façon à mieux les décimer.
Georges, dans son récit, extrait de ses notes personnelles rédigées de 1939 à 1941, nous en donne un bon exemple lorsque le reliquat de son régiment est orienté, avec d’autres réfugiés et militaires, par, probablement des parachutistes allemands habillés en soldats français, vers une fausse direction afin de tomber dans un piège meurtrier.
Cet exode massif de populations a engendré chez les français plusieurs ressentiments :
• D’abord, un sentiment d’abandon. Les images de chaos, de désespoir et de désorganisation ont renforcé l’idée que le pays était en déroute et que la population ne pouvait pas compter sur ses institutions pour assurer sa sécurité.
• Cet évènement a aussi exacerbé les divisions sociales et régionales. Les tensions entre ceux qui fuyaient et ceux qui restaient, ainsi que les rivalités entre différentes régions de France, ont contribué à un climat général de méfiance et de désunion.
• Le traumatisme de l’exode a laissé des cicatrices psychologiques durables. La peur, l’incertitude et le sentiment d’impuissance ont marqué les esprits et ont eu des répercussions sur le moral collectif.
En somme, l’exode de juin 1940 a non seulement révélé des failles dans la défense nationale, mais a également engendré un climat de méfiance généralisé envers les autorités et une profonde désillusion parmi la population française.
Sources :
Le jeune garçon.
• Souvenirs de Maurice LEGENDRE.
• JARRIGEON, A. Les journées historiques de juin 1940 à Blois. Tours : Arrault, 1940.
• BARBEAU, Philippe. Peur sur la route. Nathan jeunesse. 2009.
• OGER, Lionel. Le Loir et Cher dans la tourmente. Nouvelle république du L & C.
Le jeune rappelé sous les drapeaux.
• Extrait du journal personnel de Georges THORET. 1939-1941.
• La France contemporaine. Les Années 40. Sous la direction de J Amouroux.
Le vétéran de 1914.
• Mémoire familiale.
• Châtillon sur seine sous les bombes. Châtillonnais en Bourgogne. 2008.











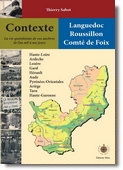















 Ils ont connu l’exode de juin 1940
Ils ont connu l’exode de juin 1940