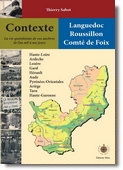Le docteur Léopold Murat avait vissé sa plaque à Belvès vers 1910. La Grande Guerre est arrivée mais il n’a pas été mobilisé : il était réformé pour somnambulisme ! C’est pour cela que les gens de Belvès et des environs ont eu le privilège d’avoir un médecin pendant la guerre.

Dans un cabriolet tiré par son cheval sur des chemins de terre, il parcourait son domaine. Ses clients vivaient dans des fermes isolées, blotties dans des clairières. Pour les visites rapprochées le vélo suffisait.
Le père Murat habitait, route de Monpazier, une maison au fond d’une cour, à gauche la partie professionnelle et à droite les pièces d’habitation. Dans un coin l’écurie. De l’autre côté de la route un grand jardin potager où il cultivait ses légumes. C’était un bon médecin qui traitait lui-même une grande partie des affections médicales et chirurgicales. Pour qu’il hospitalise ses malades, il fallait que ce soit très grave. Les assurances maladie n’existaient pas et l’hospitalisation était une ruine pour la famille. Bien sûr les accouchements se pratiquaient à domicile et comme ses confrères il savait se servir du forceps et d’un petit couteau, son bistouri personnel.
Monsieur Borde, le boulanger, ayant soulevé trop de sacs de farine, fit une hernie inguinale. Murat régla le problème tout seul, sans assistant, sans anesthésie. Il installa Borde sur la table de la cuisine, affuta le canif qu’il avait toujours avec lui et le désinfecta à la flamme. L’intervention se fit sans problème, en présence de sa femme et de Maurice son fils qui me l’a raconté.
Le praticien, large d’épaules, ne souriait pas souvent, son regard me terrifiait dans ma jeunesse. Après l’examen du malade, il ne donnait pas des conseils, mais des ordres. Si l’on ne suivait pas ses prescriptions, ça bardait dans les chaumières. Malgré son caractère ses clients l’estimaient : « Il est énergique et connait son métier. »
Il gardait les rabats au dos des enveloppes pour écrire ses prescriptions. Il en avait toujours, sauf une fois. Ses client habitaient un de ces endroits perdus dans la forêt de Fongalop et la fermière devait prendre ses médicaments sans tarder. Murat fouilla dans ses poches, dans sa sacoche, pas le moindre morceau de papier. Inutile d’en chercher dans la maison, il n’y avait que du papier à cigarettes Job, trop mince et trop petit. Murat reprit les recherches dans le capharnaüm de sa sacoche et trouva un morceau de craie blanche. Sur la grande porte d’un placard il écrivit l’ordonnance.
Le fermier mit la porte dans sa charrette et partit tout de suite à Belvès. Après sept à huit kilomètres de trotte, la jument s’arrête dans la Grand ’Rue. Monsieur Laporte, le pharmacien, voit la porte et lit l’ordonnance. Habitué des excentricités de Murat, il garde son sérieux et délivre les médicaments.
Murat s’exprimait en patois, langue explosive au riche vocabulaire. Le malade était fixé sur son sort sans ménagement. Le grand Marcou, bandit professionnel, avait reçu dans le ventre un coup de piquet d’acacia au bout pointu. Bourrier, de la Granjoune, avait vendu des vaches à la foire du Buisson et il se doutait que le grand Marcou le guettait. Quand Marcou s’est jeté sur lui, Bourrier n’a eu qu’à lever son piquet et l’autre s’est empalé dessus. Devant les énormes dégâts abdominaux, il n’y avait rien à faire qu’à dire au mourant la vérité, toute crue et en patois : « Aquel aqui to fa toun counte. To pas mounqua ! »
Le docteur Murat n’avait pas attendu ce jour pour faire connaissance avec Marcou. Une nuit, une main puissante arrêta son cheval, et retentit alors le cri rituel à l’époque : « La bourse ou la vie ! »
Murat ne donna pas sa bourse, mais une volée de jurons en patois.
« Excusez-moi, Monsieur Murat ; je ne vous avais pas reconnu ! »
A l’automne 1918, la grippe espagnole qui sévissait dans le monde entier est arrivée dans le canton de Belvès.
Murat, débordé, ne pouvait plus faire ses tournées à cheval. Il demanda à mon père Antoine et à mon oncle Lucien d’être ses chauffeurs, de nuit comme de jour. Souvent Murat ne se couchait pas du tout. Il fermait l’œil dans la Citroën pendant le parcours, malgré les secousses sur les mauvais chemins. Parfois, des hommes, prévenus on ne sait comment, étaient postés sur la route, armés de bâtons. Ils faisaient signe d’arrêter mais Murat criait :
« Fonce, ne t’arrête pas, s’ils ne se sortent pas, tant pis pour eux. »
Antoine et Lucien étaient d’excellents chauffeurs et mécaniciens, pas question de tomber en panne. Mais ils ne résistaient pas aussi bien à la fatigue et au manque de sommeil que le père Murat.
Il y avait trop de malades, Murat avait sa liste, sur quels critères avait-il fait son choix ? La maladie était la même pour tous : pleurésie. Du liquide purulent dans la plèvre.
Les malades étaient toujours assis dans leurs lits, jamais allongés, calés par des édredons. Ils faisaient de gros efforts pour respirer, la tête penchée sur un côté. La toux était rauque, sèche, très pénible, un peu soulagée par une infusion de tilleul et de miel.
Un fer à repasser chauffait sur des braises dans le cantou, Personne ne parlait, sauf pour l’essentiel. Les visages des bien-portants était sinistres. On sentait la mort. Murat, après avoir enlevé les vêtements, auscultait le cœur, tapotait la cage thoracique pour trouver avec la matité, le niveau du liquide dans la plèvre. Avec de l’eau de vie très forte il nettoyait le thorax pendant qu’une femme repassait un grand mouchoir.
Murat expliquait au malade ce qu’il allait faire, qu’il aurait un peu mal mais il savait qu’il était courageux et ne bougerait pas, que ses enfants l’aideraient en le soutenant par les bras ; s’il avait mal il pouvait crier, ça soulage. Le canif aiguisé et stérilisé contre une braise bien rouge, Murat l’enfonce entre deux côtes. Du liquide purulent jaillit sur un linge. Quand plus rien ne coule, Murat engage le mouchoir dans la brèche qu’il a créée, le fait avancer de la pointe du couteau.
« Le mouchoir va suer, mettez des linges propres et repassés pour recueillir le jus et changez-les souvent. Quand le mouchoir sera sec vous l’enlèverez doucement. »
Et il recommence parfois la même opération pour l’autre poumon.
Avant de partir il donne un petit flacon de pilules fabriquées par le pharmacien, pilules qui calmeront la toux. On le paye mais souvent il répond : « quoi ré. »
Il ne reviendra pas voir son malade, il n’a pas le temps, les autres l’attendent. « J’ai fait mon boulot, ils s’en sortent ou ils crèvent, c’est comme ça avec cette saloperie de grippe. »
En 1953 j’étais le médecin du Pasteur, un magnifique paquebot reconverti en transport de troupes. Chaque fois que je découvrais un endroit célèbre, la Mer Rouge, Aden, Singapour, la Baie d’Along, l’Océan Indien, je me disais : c’est bien beau mais ça ne vaut pas mon Périgord et sa Dordogne.
Au large de l’Indochine j’ai reçu un télégramme de mon père m’annonçant la mort du Docteur Murat. J’ai aussitôt démissionné et vissé ma plaque sur la maison familiale. Mon bureau se trouvait en-dessous de la chambre où j’étais né, moi qui voulait parcourir le monde.
J’avais fait mon apprentissage à l’hôpital et grâce aux remplacements dans les campagnes du Périgord méridional et de l’Agenais. J’étais un vrai médecin de campagne et aussi un médecin de famille.
Souvent on disait de moi : « Quoï un nouvel Murat ! »
Et j’en étais fier !
Le conseil d’Avicenne et des médecins du Moyen-Age pour échapper à la peste était :« Cito, longe fugeas, tarde redeas » que l’on peut traduire par : « Fuis vite, loin et reviens tard. ». Mais notre peste est partout, on ne peut fuir loin et d’ailleurs c’est interdit. Comme dans le Décaméron, renfermons-nous dans notre maison et racontons-nous des histoires !